Journal de l’année 2020
|
Dans les Vraies Richesses, j’ai marqué tout ce que j’avais gagné, véritablement ma richesse. La seule que je vous souhaite, camarades. Vous m’interrogiez sur la joie : à quoi servirait de vous répondre si vous ne saviez pas en même temps de quoi je suis riche, si vous ne saviez ce que je désire pour vous. A partir de ces champs dont je vais vous parler, mêlée à la sérénité des herbes et des vergers, dans la paix de ces maisons armurées de ruches, gronde chaque jour la loi de Dionysos qui fait lutter les hommes avec ivresse contre le travail. Mais, dès que vous entrerez dans ce monde, vous trouverez tout de suite une joie : celle des gestes naturels.
L’autre, continuons à la chercher. Rien n’est têtu comme un paysan. Tout est détruit, il recommence ; tout s’effondre, il reconstruit ; il n’a plus rien, ses mains sont vides. Ah ! cette fois, plus d’espoir ? Non. D’où sont venues ces graines qui germent déjà entre ses doigts, ces semences qu’il semble s’arracher de son corps et qui ruissellent déjà sur les champs « au-dessus desquels – dit-il – est la mauvaise fortune du ciel, mais aussi la bonne ». Alors, s’il y a tant de ressources en nous quand nous n’avons plus rien, de quoi ne serons-nous pas capables quand nous avons quelque chose ? Je donne ce que j’aime à ceux que j’aime. Pour que nous ayons des sacs également chargés sur la route. Vers la joie.
Jean GIONO. Manosque, janvier 1936. Giono, Jean. Les vraies richesses : (*) (Les Cahiers Rouges) (French Edition). Grasset. Édition du Kindle.
|
Septembre 2020
|
« J’ignore ce que je vais vous raconter. Tout ce que je sais, c’est que le jour baisse et qu’on n’écrit un livre que pour la lumière qu’il pourra nous apporter. À quoi servirait-il de l’écrire si on le portait déjà tout entier conçu et programmé ? On écrit pour y voir clair en soi-même, pour ouvrir un chemin, pour orienter une pensée qui cherche son étoile. Ce serait se méprendre que croire cette orientation prédéterminée. Le chemin ouvert par la plume ne figure sur aucune carte routière, il n’est pas non plus la projection d’un projet réfléchi, il s’ouvre sous les pas de celui qui chemine dans l’ignorance de ses étapes et de sa destination, disputant son tracé à l’effort du marcheur et à la difficulté du terrain. La trace peu à peu se précise sous les pas ; un jour elle fera sens, mais nul n’en saurait préjuger ; le chemin ne vient pas de l’initiative de l’homme, il l’initie à son aventure. […]
Je n’ai jamais usé de ma plume que comme d’une baguette de sourcier qui puisse, par son frémissement, me révéler la présence cachée d’une eau vive. C’est dire qu’aucun itinéraire balisé jamais n’a pu conduire mes pas, ni voie royale, ni grand’route, rien que le chemin des écoliers, ayant le sentiment, par atavisme familial, que la vérité sourit toujours au rebelle pour finir par échoir, comme par miracle, à la bonne encontre de quelque traîne-savate en maraude. […]
De la vérité Pascal disait que Dieu l’avait couverte d’un voile et qu’elle errait inconnue parmi les hommes. C’est laisser entendre qu’elle ne se trouve pas là où ses détenteurs patentés ont prétendu l’abriter et qu’il faut laisser ses amoureux s’aventurer aux quatre vents de l’esprit. […]
Je m’étais promis de ne point revenir à l’écriture, ayant perdu avec mon épouse celle avec qui j’avais pu, ma vie durant, faire preuve de sincérité. Si j’y reviens, c’est parce qu’il n’est meilleur exercice pour ajuster notre présence tant à nous-mêmes qu’à nos familiers. La page d’écriture règle la journée du laïc comme la pagina sacra celle du moine bénédictin ; elle est l’indispensable discipline qui nous accorde à l’univers tout en assurant notre harmonie intérieure. Sur quoi exercer alors untel règlement ? À un âge où l’on n’a plus la moindre espérance de vie et si peu de présence au monde, il ne nous reste que notre passé… » Pierre MAGNARD, Penser c’est rendre grâce, «Ouverture », L’Appel du chemin |
9 & 10 septembre 2020
Ce portrait fait partie de ceux de quinze femmes d’exception, il résulte d’une de mes plus récentes rencontres.
Arlette Couder, l’épopée du bien-être
Malgré l’avancée des droits des femmes, même si c’est une honte de devoir le conceptualiser ainsi au XXIe siècle, seule une femme exceptionnelle est un peu mieux considérée par la gent masculine qui cultive, trop souvent encore, un scepticisme insultant.
Celle que je souhaite évoquer est bien entendu dans le cadre de l’inhabituel, puisque malgré nos habitudes grotesques de pseudo-supériorité masculine, chacun doit reconnaître sa maestria et surtout son charisme que l’on voudrait souhaiter à tous les chefs d’entreprise.
Sans doute – et j’en ai connu – il existe des femmes ambitieuses, hystériques, garces, et même dangereuses, comme cela existe chez pas mal de mâles, mais que l’on s’est plu à considérer comme naturel chez l’animal masculin. Moins facilement, nous leur concédons des qualités positives que l’on admire chez les meneurs d’hommes. Loin de moi de faire l’éloge global du beau sexe, chez lequel j’ai observé ou côtoyé, en dehors des cas précités, d’authentiques courges ou de parfaites nullités et déjà dans ma vie professionnelle, mais comment ne pas vouloir reconnaître l’égalité des potentiels des deux sexes ?
 |
| Arlette Couder |
Je doute qu’Arlette, puisque c’est son prénom, se soit préoccupée de considérations sexistes, pour mener ses actions et construire son projet de vie. Je crois plus au dynamisme, à la passion, à la détermination d’une personnalité investigatrice qui a trouvé son épanouissement dans sa quête du bien-être.
Je ne l’ai sérieusement connu, qu’entre 1996 et 2006, au temps où elle était pharmacienne aux Catalpas à Chancelade et parallèlement conseillère à Bio-Périgord, une épicerie bio avec des extensions évolutives et significatives, géographiquement mitoyenne de la pharmacie.
C’est d’abord une très charmante femme, petite, mince, ravissante, donnant l’impression d’une éternelle adolescente, ce qui évidemment, n’est pas pour me déplaire, à beaucoup d’autre je me doute tout autant, mais au demeurant fort insuffisant pour définir une nature d’exception. C’est dans ses traits de caractère et sa manière d’être avec les autres que l’on découvre une personnalité magistrale, a la fois bienveillante, généreuse, ferme et convaincante.
 |
 |
|
| La pharmacie des Catalpas, chancelade | Une des spécialités de la pharmacie | |
La pharmacie et Bio-Périgord formaient un tout cohérent, salutaire et très avenant pour qui voulait vivre juste et bien. J’adorais cet endroit, pour les conseils, les plats préparés toujours délicieux, le choix des produits, le sérieux et l’esprit amical. C’était comme une famille, conviviale, chaleureuse et où régnait la bonne humeur. Je crois qu’exception faite de Christiane Jensen fondatrice de Tupperware-Dordogne, je n’ai jamais rencontré une personnalité aussi fédératrice, consensuelle, estimée et appréciée de tous, sauf bien sûr des jaloux, et il y en avait, justement mécontents d’être aussi ridicules, par comparaison.
Par exemple, je me souviens d’un entretien avec mon médecin, qui fut de bon conseil pour moi à la fin des années 70, mais qui avait des rigidités de concepts, que certes, il remit parfois en cause ; ainsi d’hostile à l’homéopathie, il en devint un des praticiens convaincus, allant au-delà de mes propres réticences. Je n’étais pas trop enclin à devoir avaler sa dose de Thuya 7 CH après un rappel de vaccination contre le tétanos qu’il me prescrivit. La douleur se manifestant, je fus bien inspiré d’avoir ce tube sous la main, la douleur ankylosante de l’épaule disparut en moins d’une heure, à mon grand soulagement !
Cependant, il m’agaçait lors de mes rares consultations en me demandant ce que j’avais et ce que je voulais pour le traiter. J’avais une réponse assez provocante : « Docteur si je dois faire le diagnostic et la prescription, c’est donc vous qui allez me payer la visite ! » Il en était plus ou moins vert devant mon toupet !
Un jour, il fut question de Madame Couder, et là, lui qui était assez placide, la moutarde lui monta au nez au sujet de ses conseils en teintures mères, compléments alimentaires et homéopathie. Il me déclara : « Celle-ci mériterait que l’ordre des médecins lui fasse un procès pour exercice illégal de la médecine ! ». Ce à quoi, avec ma franchise, si peu aimable, je lui rétorquais : « Sauf que contrairement à vous docteur, dont je paye la consultation et qui me prescrivez des remèdes qui ne résolvent rien, les conseils gracieux de madame Couder apportent une solution pérenne à mes ennuis ! » Alors que ma réponse lui fit l’effet d’une lame de rasoir, il dut penser « oh ! Le con ! ». Il en resta muet. Son successeur, très sympathique, au demeurant, se méfie de moi, et ne fait que des propositions qui pourraient m’agréer, ne prenant aucun risque inutile.
Lorsque cet heureux temps, qui perdura dix années, avec madame Couder, les charmantes Pascale, Florine, Christiane et l’équipe de la pharmacie s’acheva, j’avoue que j’étais parmi les plus contrariés ; j’avais bien raison, car le successeur, bien qu’étant un loustic prétentieux, ruina tout l’édifice construit avec tant de patience et de talent par cette petite femme. J’étais fou de rage et c’est en ces moments que les armes d’un fonctionnaire aimeraient pouvoir s’appliquer, mais il n’y a pas de sanction pour les crétins. Quand l’homme se montre le subalterne de la femme et incarne même la caricature de ce qu’on tente toujours de reprocher au genre féminin ! Pour Bio-Périgord, après l’immense succès de ce concept moderne, ce fut pire, l’incompétence et la prétention se mêlaient à une sorte de dérangement cérébral et il fallut l’arrivée d’Hélène, que l’on pourrait qualifier cependant de béotienne, pour sauver ces lieux où progressivement une horde d’ « échaudés », dont j’étais, mais moins irascible que certains qui ne voulurent plus y mettre les pieds, réapparaissent. La Vie Claire, aujourd’hui, englobe tout l’espace à la fois de la pharmacie et de Bio-Périgord. C’est la grande Vie Claire de Périgueux, puisque celle du centre-ville avait été ruinée par la mégère qui fit fiasco à Chancelade.
Il fallait, deux femmes courageuses, volontaires, à des années de distances, pour construire puis réinventer ces lieux.
Il fut un temps où cette pharmacie avait un rayonnement qui dépassait de beaucoup Chancelade et Marsac, nous venions d’un peu partout, c’était mon cas, puisque j’habitais à 20 kilomètres de Périgueux. Nous n’en connaissions pas le fonctionnement interne, mais Pascale me confia que la «directrice» terme qui ne lui sied guère, je dirais mieux «l’inspiratrice» s’assurait que chacune de ses salariées puisse acquérir au moins une partie de ses propres connaissances, cependant difficiles à égaler. L’organisation du fonctionnement de la pharmacie, permettait avec libéralité, de ne pas rester une simple potiche derrière un comptoir. Pascale par son charme, son écoute, sa gentillesse, était devenue une suppléante recherchée de madame Couder, et vers laquelle nous allions en toute confiance. Je pense d’ailleurs que c’est pour elle que ce fut le plus délicat et triste, de devoir finir son temps professionnel dans le déclin de ce qu’elle avait connu.
 |
|
Déjeuner à Château l’Evêque. L’Équipe de choc, de gauche à droite : Arlette, Josiane, Cécile, Christine, Marie-Laure, Jacqueline, Françoise, Pascale |
La nouvelle pharmacie de Chancelade synthèse ubuesque des deux préexistantes, ressemble davantage à un univers carcéral sinon à une succursale des établissements funéraires Virgo. Le personnel aligné, raboté, laissant au vestiaire sa personnalité, incarne une hideuse robotisation, faisant penser à des films de science-fiction qui n’ont pas ma faveur. Après un unique passage, déconfit, je me rendis à celle de Saint-Léon-sur-L’Isle, y trouvant visage humain, pour mes rares incursions dans cet univers.
Les regrets ne changent rien. Sur la photo qui réunissait au restaurant le couple Couder et le personnel de la pharmacie, au moment de la vente, on sent bien la tristesse de la fondatrice de ces lieux uniques qui proposaient la panoplie des soins naturels, souvent très efficaces et moins toxiques que la chimie galvanisée par les laboratoires pharmaceutiques. Il faut simplement reconnaître qu’un tel succès est lié à une personnalité qui allie intelligence, rigueur, bienveillance, communication, pédagogie et promotion. Sans ce charisme fait de réflexion, d’études, de volonté, de partage, rien n’existe plus !
 |
| Daniel et Arlette Couder |
Pour conclure cet hommage plus que mérité, à celle qui nous aura offert de si belles années, je veux associer un homme, Daniel Couder, son heureux époux, qui la soutenait et dirigeait avec bienveillance Bio-Périgord dont il était l’instigateur et le manager. Il me faut y associer également, selon sa formule épatante, « l’équipe féminine de choc » qui animait la pharmacie et celle qui faisaient de Bio-Périgord un havre de ressourcement et de convivialité, Florine, Christiane et Pascale qui possédait le double talent de pharmacienne et de conseillère en nutrition saine. Je tiens à y associer, Hélène, qui avec détermination aura redonné à ces lieux la destination qu’Arlette Couder avait dessiné si heureusement pour lui, soit être au service du bien-être de tous, salariés et clientèle. ♦
Les femmes remarquables de ma vie
Au cours des mois qui viennent, je vais tracer quelques portraits de femmes (environ quinze) qui m’ont impressionnées, soutenues, enchantées. Je commence par la première de toutes qui était aussi ma marraine.
Vendredi 4 septembre 2020
Ma grand-mère Marie Rosalie, tout un art de vivre
D’un temps ancien où j’étais sous protectorat maternel, enfermé dans toutes les craintes et peurs pour ma santé, qui, il est vrai, n’était pas idéale, il y avait Marie Rosalie, mère de mon père et ma marraine. Mon père, qu’elle avait conçu incognito lors de ses activités de louage dans une famille bourgeoise. Cette Marie Rosalie n’avait pas tout donné à son fils et en éprouvait sans doute du remords. Aussi, son petit-fils bénéficia de toutes ses attentions et de sa tendresse. Elle était simple, peut-être même un peu primaire, mais généreuse, positive, courageuse et joyeuse.
 |
|
Thenon, Marie Rosalie jeune-fille et Jean, fils de son frère Adrien Geoffre et de Marthe |
La famille était installée à ‟Vaujean”, commune de Thenon. Mes arrière-grands-parents Céline (en réalité Marie Bussière) et Philippe Geoffre (de son véritable prénom, Jean) étaient métayers et vivaient de peu. Leur descendance fut pourtant moins modeste : Adrien, Marie Rose (née en 1896 et disparue en 1897), Arthur (rebaptisé Marcel), Angèle, Marie Rosalie, Louise et Nanie (de son vrai prénom Adrienne).
 |
| Céline & Philippe Geoffre, parents de Marie Rosalie |
Marie Rosalie épousa Gabriel Joubert, avec lequel ils eurent un fils, Michel, qui disparut enfant. Gabriel adopta notre père et toute sa famille nous adopta tous, principalement ses soeurs Aimée Joubert et Germaine Lacoste et ses enfants. Gabriel disparaissait à 39 ans. Ma grand-mère veuve, continua à bénéficier de l’affection de sa belle-famille, dont il nous reste une adorable cousine : Annie Siozard.
 |
|
De gauche à droire, Marie Rosalie Gabriel & Aimée Joubert |
Marie Rosalie se remaria plus tard. Elle éleva les deux derniers enfants de Roger dont l’épouse s’était montrée indigne durant la dernière guerre. La jeune fille était fort séduisante et fut ravie un peu plus tard de changer de classe sociale, se trouvant des compétences et de l’autorité sur les autres avec le diplôme de « Revanche sur la vie ». Le garçon était plus goguenard et sympathique, il n’eut pas malheureusement une aussi longue vie que sa sœur. C’était un véritable orfèvre dans le domaine manuel, ce qui suppose une vraie intelligence, il fut un des pionniers du froid (les fameux frigidaires remplaçaient nos glacières un peu aléatoires) lorsqu’il en fut l’heure. Il aimait les jolies filles, il en épousa une avec laquelle il eut deux filles fort charmantes. Il chantait aussi magnifiquement que Luis Mariano. Durant son service militaire, il rencontra, me semble-t-il à Toulouse, Édith Piaf qui s’enticha de lui, avant qu’elle ne succombe aux charmes du beau Théo Sarapo qu’elle épousa en 1962.
 |
|
Pâques 1953, baptême de Françoise debout à gauche Mamie, Christian, Roger, Colette, Mémé, Pépé de chaque côté du landau Christine, mes parents et moi. |
Je l’aimais bien, il était naturel, joyeux, ce qui fait qu’il était bien apprécié de tous, pas uniquement de son entourage direct. Il surnommait tout le monde de manière fort amusante. Ma grand-mère Rosalie était “La Cadix” à qui, il chantait bien évidemment « La belle de Cadix a des yeux de velours… », son père “Le Brège”, sa sœur “La Cagna”, notre cousine Colette “Trotinette”, son cousin Vergnolle “Cocotte”, je dois avoir oublié le mien ! Il y avait dans la modestie de ce foyer, une bonne humeur contagieuse, à l’inverse des grimaces qui trop souvent s’exprimaient inutilement chez nous. Or, même si cela m’étonnait beaucoup, par contraste, cela me plaisait. Sans doute, trouvais-je plus convaincante cette conception, peut-être un peu écervelée de la vie. Autour de cette table, il était aussi naturel de bien manger que de rire beaucoup, voire de chanter ! Ma grand-mère excellente cuisinière, descendait la route de Paris à pied, l’été ou pendant les vacances, moi à ses côtés, mercredi et samedi matin, pour se rendre sur le marché du centre-ville, place de La Clautre…
 |
|
Villa Élina, rue Jeanne d’Arc La famille réunie pour une fête, début des années 60 |
Les sacs au retour étaient lourds de provisions pour de copieux et savoureux repas. L’ascension de la route de Paris jusqu’à la rue Jeanne d’Arc se faisait plus religieuse, processionnaire même, cependant que mijotaient les prochaines recettes dans la tête de “La Cadix”. Parfois, le bus rendait cette escalade plus sereine et légère, surtout pour ma pauvre grand-mère.
On la taquinait beaucoup, son éducation était sommaire comme dans ces familles où « on apprend à se débrouiller » depuis l’enfance, car la pauvreté était sous-jacente. Elle était coutumière de confusions de vocabulaire qui généraient des rires, auxquels d’ailleurs, et de grand cœur, elle s’associait. Ce n’était pas une susceptible terrorisée par la moindre remarque, mais une bonne vivante. Par exemple, lorsque Renée venait depuis le Béarn et qu’elle souhaitait descendre à Périgueux pour aller faire du lèche vitrines, elle constatait dépitée : « Renée est allée en ville, il y avait tant de monde qu’elle n’a pas pu s’égarer ! » ou encore lorsqu’on lui racontait des choses surprenantes, elle s’exclamait : « Je crois que madame Puybonnieux perd maboule ! »
Elle faisait confusion entre les termes « perdre la boule » et « devenir maboule ». Christian la provoquait : « Allez Cadix, dit Pschitt », car c’était la vogue, en été, de ce soda apparu en 1955 (Groupe Perrier-Vittel) : pschitt citron ou pschitt orange. Ma pauvre grand-mère n’arrivait qu’à dire « peuchit » à la grande hilarité générale ; elle savait que ce n’était pas comme cela qu’il fallait prononcer, mais ne pouvait pas y parvenir, tout en riant tout autant que nous. Cependant, elle me dépêchait pour aller à l’épicerie du bas de la rue Jeanne d’Arc, pour récupérer ce breuvage qu’elle adorait, mais qu’elle avait honte de réclamer en public. Si elle était avec moi, elle me soufflait : « Dis-le, toi ! »
Devenue veuve pour la seconde fois, elle alla habiter en dessous de chez sa sœur Louise, dans une pièce unique, fort modestement, entre la route de Lyon et la voie ferrée. Les dimanches, lorsqu’elle ne déjeunait pas, en face, chez Christian et Cosette, mon père allait la chercher pour passer la journée à la maison, à Chamiers. Souvent, le samedi, je partageais son repas de midi, où je passais un bon moment avec elle, ma grand-tante Louise… Nulle plainte, juste de la bonne humeur ! J’aimais faire des farces. J’avais acheté un petit transistor qui faisait fort discrètement enregistreur de cassettes audio. Debout il semblait être uniquement un petit transistor. Souvent, une voisine, ‘la Angèle’, venait prendre le café avec nous et discuter. Discrètement, pendant leur bavardage du style commère, j’avais enclenché l’enregistrement, puis rembobiné la bande. Au bout d’un bon moment, je leur dis : « n’aimeriez-vous pas écouter mon nouveau transistor ? » ; comme elles étaient toujours prêtes à faire plaisir, elles en furent immédiatement d’accord, c’est ainsi que je mis la bande en lecture. Angèle : « Ah oui, je reconnais, c’est l’émission de France Inter où ils font parler les petits vieux », « Oui, dit ma grand-mère, je l’écoute parfois ! », puis : « Non, mais c’est nous ça, tout à l’heure, on parlait de madame x ! » Et alors c’était le fou rire et la joie assurés.
 |
|
Mamie, route de Lyon dans les dernières années de sa vie |
Elle avait une petite chienne, Rita, qu’elle adorait ; elle l’avait amené avec elle de la rue Jeanne d’Arc à la route de Lyon, elles ne se quittaient pas et d’ailleurs même pas pour les séjours chez Renée ou Christian. Lorsque sa petite chienne est morte de vieillesse, elle eut ces paroles : « Bientôt, ce sera mon tour » et effectivement après s’être chamaillée avec Louise sur qui partirait la première, elle due quitter la route de Lyon pour l’hôpital de Trélissac, en cardiologie. Je l’accompagnais avec mon père. En fermant le portail, elle eut cette phrase inattendue : « Je ne reviendrais jamais ici ! » Suffoqué, je lui dis : « Ça Mamie c’est une phrase de maman ». Elle répondit sans pleurer, ni maudire : « Non, c’est ainsi, c’est la vie ! »
Et effectivement, son œdème pulmonaire la malmenait. Lors d’une de mes dernières visites, lorsqu’elle me vit, elle me dit : « Demande à la Dame d’à côté ce qu’elle a fait cette nuit ? » Sa coquinerie malgré son teint empourpré et violacé qui montrait assez son état alarmant, la poussait à rire. Je lui disais : « Mamie, calme-toi ! », « Mais non, répondit-elle, je sais que je vais mourir, mais on va rire quand même ! ». Pour moi habitué aux plaintes et simulacres de morts, c’était proprement hallucinant.
Mais le 17 février 1980, alors que je m’apprêtais à me rendre à Couze Saint Front où mon ami Jean-Jacques était de passage, mon père me recommanda plutôt d’aller voir ma grand-mère en me disant qu’elle allait nous quitter bientôt. Contrarié dans mes projets, je me rendis à Trélissac, ma grand-mère ne m’avait pas entendu, elle était déjà figée… c’est la seule fois où je ne l’ai pas entendue m’inviter à rire.
Elle avait une manière de vivre en toute simplicité, comme un simple élément de la planète, acceptant les épreuves, les deuils répétés dont un fils Michel décédé jeune, de sérieux problèmes de santé, elle eut toujours cette belle humeur et un goût immodéré de la vie. Voilà peut-être la plus grande leçon terrestre que j’ai vécue.
Trois mois après, nous accompagnions sa sœur Louise à sa dernière demeure. Elles étaient donc bien malades routes les deux, mais jusqu’au bout une vitalité fondamentale les anima.
 |
| Chamiers, Valérie, Christine, Mamie et sa Rita |
J’achève ce texte le jour même de son anniversaire de naissance, 4 septembre 1903, et à l’heure ou Annie Cordy, qu’une joie communicative animait en permanence, nous quitte, non sans laisser le même message que ma grand-mère. Nous sommes tous mortels, tristes ou joyeux, nous devrons tirer, un jour, notre révérence, alors pourquoi ne pas décider de vivre avec grâce ? ♦
AOÛT 2020
Samedi 28 août 2020
Pèlerinage, doute & peur
En dehors de faire la sieste par un temps aussi maussade, il reste à prendre son crayon ou de jongler sur les touches de son clavier pour raconter.
Pourquoi ai-je choisie cette destination, pour la première balade de cette année tellement altérée ? Un post sur le mur du Facebook de Corinne m’incita à revenir sur mes pas.
Notre première halte sous un ciel changeant, se rafraîchissant même, fut de trouver ‟Vaujean” ou naquit et vécu mon père, durant les premières années de sa vie. Mais aussi où vécurent Philippe et Céline Geoffre, les parents de ma grand-mère paternelle Marie Rosalie, ses deux frères Marcel (Arthur), Adrien, et ses trois sœurs : Angèle, Louise et Nanie (Adrienne). Nous abordions les lieux par un hameau dont le nom était souvent évoqué dans les conversations d’autrefois : ‟Le Jarripigier”. Quelle signification peut bien avoir ce nom de lieu ? On entre alors dans la forêt Barade, qui était autrefois un lieu idéal pour se perdre. C’est encore l’extrême pointe sud de la commune de Thenon. L’école était à proximité, dans le petit village de Bars, nom que j’ai si souvent entendu prononcer. Nous l’avons un peu investi, la petite église où mon père, mais aussi ma grand-mère, mes grands-oncles et mes grands-tantes furent probablement baptisés… La mairie actuelle, est-elle l’ancienne école ou notre père apprit a si bien à compter ? Il était la fierté de son institutrice, sans doute à juste titre, madame Delibie, qu’il revit ému bien plus tard, probablement le jour de l’enterrement de Marcel, le frère de ma grand-mère, le père de Marcelle, Marissou, André et Yvette.
 |
 |
 |
||
| Au Hameau du Jarripigier | Lieu mythique des premières années de mon père |
Sur le chemin de randonnée de la forêt Barade La petite maison effondrée |
||
Le clocher comporte quatre emplacements pour les cloches, mais n’en possède que deux, une grosse et une petite, qui sans doute devait servir pour sonner le tocsin. Je suggérais donc à Jean-Michel que nous comblions les espaces laissés vacants !
 |
 |
|
| Village de Bars et son église | Carte de la commune de Bars | |
Il ne fut pas possible de savoir où se situait la maison des arrière-grands-parents et de leurs enfants. La dame installée en ces lieux sauvages et vallonnés ne savait rien de l’histoire de ce temps ancien. Il tombait quelques gouttes et le ciel était menaçant. Nous vîmes bien, sur le chemin que nous parcourûmes à pied, aller et retour, une bâtisse écroulée et envahie par un arbre et un roncier. Ce chemin de la forêt Barade rejoint une route goudronnée, qui à droite nous ramènerait au ‟Jarripigier” et à gauche au village de Bars où en face à Vaujean où nous rencontrâmes dans un autre petit hameau une dame Monribot fort aimable. Sans doute pas de ces Monribot issus de la mère de la grand-tante Thérèse, d’un second mariage, qui ne fit point obstacle à beaucoup d’affection entre les enfants issus de deux pères successifs, le premier, disparaissant à 24 ans ! Quel fut le berceau de mon père ? Lorsqu’il nous y menait lui-même, je n’y prêtais qu’une faible attention pour n’en n’avoir conservé pas le moindre souvenir. Quelle tristesse ce devait être pour lui, mais il est vrai que cela est si loin ! Jeune, on vote pour l’émancipation, une vie plus confortable, le mythe américain. On ne revient à nos racines que bien plus tard, lorsque la vie s’étire et va finir.
* * *
Et puis, il faut bien se décider à partir pour Saint-Léon-sur-Vézère, notre destination majeure. Je n’ai pourtant là aucune attache connue, mais le secteur par contre, entre Plazac et Le Moustier parle à mes souvenirs, le temps de Lune-Soleil que j’évoquais dans mon hommage à Maurice Claude disparu cette année, dans ce même journal à la date du 24 au 31 mars 2020.
Nous laissons tout droit la direction de Fanlac ; la petite route qui mène à Plazac, après avoir tourné à droite est relativement étroite et les rencontres avec les véhicules venant en sens inverse, sont parfois emblématiques. J’ai toujours un peu d’émotion en traversant le village de Plazac, j’y ai eu des relations dans le style ‟baba-cool”, ce qui n’est pas exactement dans mes habitudes. On trouvait étonnamment là le premier supermarché bio de Dordogne, Le Mille-feuille, et encore et surtout Lune-soleil avec sa bibliothèque, ses Croissants de lune, ses rencontres, ses forums… et de sympathiques relations dont Suzanne et Maurice Claude. Oui, tout cela fut aussi un temps de ma vie autour de mes cinquante ans, temps intéressant, instructif autant qu’utopique.
L’arrivée à Saint-Léon-sur-Vézère me sidéra par les véhicules et la foule qui circulaient dans le village dont je n’avais pas souvenir de son centre, qui, il y a trente ans ou plus, n’était qu’un petit bourg de campagne. Je fis la traversée complète et revins par la route principale à la recherche d’un parking. Et enfin, bien que très généreusement pourvu de véhicules, un de ces lieux, aménagés sommairement pour la saison touristique, me laissa une place spacieuse, royale même, qui aurait mieux convenu à une voiture américaine, sinon à une Mercedes 190, comme j’en fus, jusqu’en 2018, l’heureux propriétaire !
 |
 |
|
|
Saint-Léon-sur-Vézère En arrivant sur le Martin pêcheur |
La Guinguette de Sidonie, Le Martin pêcheur | |
Avant l’exploration des lieux, nous questionnâmes une rare payse disponible, peu enthousiaste de cette envahissante horde estivale, afin de connaître l’emplacement du ‟ Martin pêcheur”, l’heure avançant. Il fallut passer sous le pont métallique étroit qui rejoint Peyzac-le-Moustier, La Roque Saint-Christophe, Tursac, en passant au-dessus de la rivière, et nous aperçûmes cette charmante guinguette en bordure ou presque de la Vézère, avec ses baigneurs, ses canoës. Nous n’étions pas loin de l’église et du château. Les piétons sillonnaient le village. Sidonie nous laissa choisir notre table, nous étions parmi les premiers, mais très vite, il y eut saturation des tables. Après que nous eûmes choisi notre menu, nous nous installâmes pour siroter une petite bouteille d’eau minérale ! Nos assiettes annoncées et emportées, nous nous jetions sur nos aiguillettes de canard accompagnées de frites maison. Pendant que les lieux se remplissaient, nous fûmes assaillis par une nuée de guêpes dont Jean-Michel devint, plus que moi, la victime ! Venue à notre secours, une serveuse vint allumer du café moulu sur chaque table, ce qui s’avéra d’une réelle efficacité.
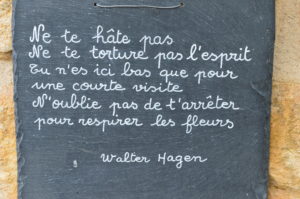 |
 |
|
|
À proximité d’un rosier rouge pourpre très parfumé, « Papa Meilland » |
L’église romane de Saint-Léon-sur-Vézère | |
Nous jouâmes ensuite aux touristes, donnant un œil aux boutiques et aux ruelles charmantes de cette bourgade, devenue ville d’eau pour quelques semaines. Il y avait quelques autres lieux de restauration populaire ou un peu moins dans la rue principale, et même plus loin en retournant vers la route qui relie Les Eyzies à Montignac, un restaurant pour capitalistes face au château moderne, son parc, ou s’élève des cèdres du Liban qui doivent être témoins des activités humaines, tellement évolutives, depuis au moins trois siècles !
 |
 |
 |
||
| Le Manoir de la Salle | Cèdre du Liban, tricentenaire | Rue principale de Saint-Léon-sur-Vézère | ||
Nous revînmes vers l’entrée routière de la passerelle. Un premier glacier attira mon regard, mais ce fut à l’opposé de la route, chez une demoiselle qui proposait du même maître, nous dirons même artiste glacier de Saint-Genies, Roland Manouvrier, des parfums rares et subtils, que nous fîmes halte : myrtille, mandarine ou ananas. Un délice que nous disputèrent une nuée de guêpes à qui je laissais la liberté de s’en donner à cœur joie !
 |
 |
 |
||
| Les sorbets et glaces de Roland Manouvrier | Jean-Michel a choisi le parfum myrtille | Les guêpes amatrices de sorbet ananas | ||
Nous prîmes la passerelle où je fis quelques belles photos, puis le chemin au-dessus de la Vézère face au ‟ Martin pêcheur”, ce qui m’autorisa quelques autres prises de vue.
 |
|
Le Martin pêcheur, tours du château de Clérans, l’église romane |
Retour sur la route des Eyzies d’où nous étions arrivés, la traversant pour aborder juste en face l’ascension de la Côte de Jor. De lacets en lacets, une de mes détestations, nous arrivions au sommet avec ses vues panoramiques sur la vaste plaine de la Vézère. Il nous fallut redescendre, pour atteindre Dhagpo, le monastère Bouddhiste tibétain. Pas mal de véhicules étaient stationnés aux abords du nouveau temple où il y avait dans le respect des règles sanitaires, une sorte d’École du dimanche. On arrive sur une grande salle de pleins pieds qui surmonte d’autres pièces. L’entrée est clôturée dans le style général du monument. Devant la salle principale, rangées avec soin une impressionnante collection de chaussures, de sport pour la majorité. Ma première idée fut d’en jeter à droite et à gauche de cette sorte de pont-levis fixe, pour voir si quelques miracles assomptionnistes pourraient avoir lieu au moment de la sortie des fidèles. L’idée de Jean-Michel se voulait plus pratique : « tu devrais te choisir assez de baskets pour toute la saison de marche ! » Sans doute, mais avant de trouver la bonne taille cela aurait pu être un peu long, complexe et humant !
 |
 |
|
| Vue de la vallée depuis la Côte de Jor | Dhagpo, temple Bouddhiste Tibétain | |
Ayant épuisé nos idées polissonnes, nous reprîmes la route vers Plazac, manquant la direction de ‟Guilme”, pour pouvoir saluer des lieux où nous vînmes quelques fois, du temps de Maurice et Suzanne, non sans faire le tour d’une habitation dont la propriétaire resta aimable malgré notre intrusion et sa surprise ! Ce fut alors le retour sous une température ascensionnelle et un peu épuisante.
* * *
J’ai aimé Antonio Tabucchi pour sa fidélité affective, quasi-amoureuse, pour Fernando Pessoa, j’ai lu plusieurs de ses livres avec beaucoup de plaisir, y recherchant les traces, qui souvent se manifestent, du poète lisboète. Mais la philosophie de Tabucchi est admirable et remet en question mes habitudes de recherche, non plus d’un héros, comme autrefois, mais au moins d’un exemple inspirant. La réponse qu’il fait à Catherine Argand pour la revue Lire (no 237, été 1995) renverse toutes mes convictions et je dois en admettre la pertinence incontournable :
« Je préfère les gens qui doutent, qui écoutent, qui évoluent plutôt que ceux qui imposent leurs idées et leurs croyances. L’univers est rempli de gens sans peur, des gens sûrs d’eux, de leur bon droit et de leur manière de voir le monde. Ces individus me laissent perplexes. Il faut avoir peur, c’est salutaire. La peur, aujourd’hui, est bonne conseillère : elle fait voler en éclats les idées reçues, les conditionnements de masse, le culte du chef. On a suffisamment connu de gens pétris de convictions autoritaires au XXe siècle pour savoir qu’ils n’apportent que des désastres. C’est pour cela que je n’aime pas les héros. Ils donnent des ordres ou bien exécutent sans discuter. »
Extrait d’un texte d’Albert Camus pour le journal Combat, en 1948, Le siècle de la peur, dresse un portait d’une situation, qui à mon sens n’aura fait qu’empirer et laisser présager le pire :
« Aujourd’hui, personne ne parle plus (sauf ceux qui se répètent), parce que le monde nous paraît mené par des forces aveugles et sourdes qui n’entendront pas les cris d’avertissements, ni les conseils, ni les supplications. Quelque chose en nous a été détruit par le spectacle des années que nous venons de passer. Et ce quelque chose est cette éternelle confiance de l’homme, qui lui a toujours fait croire qu’on pouvait tirer d’un autre homme des réactions humaines en lui parlant le langage de l’humanité. Nous avons vu mentir, avilir, tuer, déporter, torturer, et à chaque fois il n’était pas possible de persuader ceux qui le faisaient, de ne pas le faire, parce qu’ils étaient sûrs d’eux et parce qu’on ne persuade pas une abstraction, c’est-à-dire le représentant d’une idéologie. Le long dialogue des hommes vient de s’arrêter. Et, bien entendu, un homme qu’on ne peut persuader est un homme qui fait peur. » ♦
Du samedi 22 au vendredi 28 août 2020
Entre musique et philosophie
Samedi matin : neuf millimètres au pluviomètre, cumul de la soirée et de la nuit. Il faudra bien deux mois (et encore !) pour réduire la sécheresse d’un été cuisant.
Étienne arrivé jeudi en fin de journée, repartait hier en milieu de matinée, pour la Charente-Maritime où il donnait un spectacle, avec une amie pianiste, autour de la vie de Chopin. Unique prestation de l’année 2020 !
 |
||
| Le musicologue Étienne Kippelen | ||
Avant son départ, nous étions allés rendre visite aux quatre propriétaires du Domaine d’Angueur. La saison est à son apogée, pas une seule location de libre ! Étienne a ainsi vu les lieux où notre assemblée générale des Amis de la musique française aurait dû se tenir, en l’absence des grèves SNCF de novembre 2019. Il semblait être totalement conquis.
 |
||
Il m’offrit son dernier ouvrage, Chanson française & musique contemporaine[1], avec cette délicate dédicace : « Mon Cher Alain, quelques mots sur la musique contemporaine en souvenir de cette soirée remarquable au jardin des Rolphies. Avec toute mon amitié. »
La citation en exergue de l’ouvrage est signée de Michel Serre : « Nos voix viennent du vent et de ses grains vibrants, par les poumons du Monde et les nôtres ; de nos vaisseaux sanguins et du murmure énorme de la mer ; des vivants du sol et des oiseaux de l’air ; […] mille épines, issues de ces signes, traversent nos corps, saignants et douloureux, avant de se changer en voix. »[2]
Ce jeune maître de conférence, compositeur et rédacteur en chef de la revue Euterpe[3], dont il me remet un exemplaire du numéro 35, de juillet 2020, est le plus parfait gentleman que je côtoie actuellement.
* * *
Un autre parfait gentleman, Éric Rouyer, m’adressait récemment le nouvel enregistrement du Quatuor Béla, publication du Palais des dégustateurs. Ce disque remarquable nous propose les quatuors d’Albéric Magnard et de Claude Debussy. Accompagnant cet album trois grands entretiens radiophoniques passionnants avec le Professeur Pierre Magnard[4].
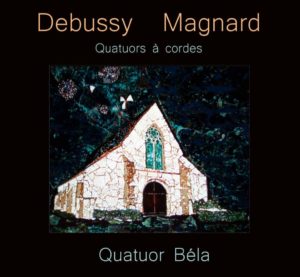 |
 |
||
Penser c’est rendre grâce de Pierre Magnard, n’est pas un ouvrage facile pour celui qui n’a pas étudié un peu sérieusement la philosophie, ce qui est mon cas. Un autre nonagénaire, presque centenaire, Marcel Conche[5], m’a beaucoup intéressé, après m’avoir été conseillé par un collègue de jeunesse devenu un ponte au Ministère du Travail. Ils sont tous les deux Corréziens d’origine. Dans l’oeuvre vaste et plurielle de Conche, philosophique et littéraire, je retiens un ouvrage qui m’a particulièrement intéressé Épicure en Corrèze (Éditions Stock, 2014) et désormais disponible chez Gallimard/Folio, depuis 2016.
Le penseur qui m’aura le plus influencé est Jiddu Krishnamurti. La nécessité que j’eus dans ma jeunesse de me libérer du connu, à me libérer de bien des traditions, idées reçues, conditionnements, qui s’avèrent être davantage des superstitions que des vérités immuables, des pièges utiles pour maintenir l’exploitation humaine, la plus anti-chrétienne manifestation de l’égoïsme humain (le Christ chassant les marchands du Temple).
Comme Doris Lessing, je constate « qu’à l’intolérance religieuse succéda celle du communisme, son miroir fidèle, lequel prépara le terrain pour le politiquement correct. Quelle sera la prochaine calamité ? Que devrions-nous tenter de prévoir et d’éviter ? »[6]
L’appel du chemin qui correspond au premier chapitre de ce livre ou à son ‟Ouverture” (comme en musique) m’a vivement interpellé sur la nécessité d’écrire, j’y ai trouvé bien des échos à ma propre démarche, même si mon objectif est bien davantage au travers de mon regard sur ma famille, mes relations et amitiés de témoigner d’un temps qui fut plus le mien et qui reste encore pour un peu de temps mon actualité.
Nous écoutons Pierre Magnard :
« J’ignore ce que je vais vous raconter. Tout ce que je sais, c’est que le jour baisse et qu’on n’écrit un livre que pour la lumière qu’il pourra nous apporter. À quoi servirait-il de l’écrire si on le portait déjà tout entier conçu et programmé ? On écrit pour y voir clair en soi-même, pour ouvrir un chemin, pour orienter une pensée qui cherche son étoile. Ce serait se méprendre que croire cette orientation prédéterminée. Le chemin ouvert par la plume ne figure sur aucune carte routière, il n’est pas non plus la projection d’un projet réfléchi, il s’ouvre sous les pas de celui qui chemine dans l’ignorance de ses étapes et de sa destination, disputant son tracé à l’effort du marcheur et à la difficulté du terrain. La trace peu à peu se précise sous les pas ; un jour, elle fera sens, mais nul n’en saurait préjuger ; le chemin ne vient pas de l’initiative de l’homme, il l’initie à son aventure. […]
Je n’ai jamais usé de ma plume que comme d’une baguette de sourcier qui puisse, par son frémissement, me révéler la présence cachée d’une eau vive. C’est dire qu’aucun itinéraire balisé jamais n’a pu conduire mes pas, ni voie royale, ni grand’route, rien que le chemin des écoliers, ayant le sentiment, par atavisme familial, que la vérité sourit toujours au rebelle pour finir par échoir, comme par miracle, à la bonne encontre de quelque traîne-savate en maraude. […]
De la vérité Pascal disait que Dieu l’avait couverte d’un voile et qu’elle errait inconnue parmi les hommes. C’est laisser entendre qu’elle ne se trouve pas là où ses détenteurs patentés ont prétendu l’abriter et qu’il faut laisser ses amoureux s’aventurer aux quatre vents de l’esprit. […]
Je m’étais promis de ne point revenir à l’écriture, ayant perdu avec mon épouse celle avec qui j’avais pu, ma vie durant, faire preuve de sincérité. Si j’y reviens, c’est parce qu’il n’est meilleur exercice pour ajuster notre présence tant à nous-mêmes qu’à nos familiers. La page d’écriture règle la journée du laïc comme la pagina sacra celle du moine bénédictin ; elle est l’indispensable discipline qui nous accorde à l’univers tout en assurant notre harmonie intérieure. Sur quoi exercer alors untel règlement ? À un âge où l’on n’a plus la moindre espérance de vie et si peu de présence au monde, il ne nous reste que notre passé… »[7]
Dans la seconde partie de son ouvrage, intitulée « Le mal du pays en son propre pays », Pierre Magnard évoque certains de ses professeurs, dont Jean Beaufret[8] qui rencontra à plusieurs reprises et correspondit avec Martin Heidegger[9]. On sait les polémiques qui ont troublé l’image du philosophe. Le compositeur Richard Strauss connu, entre autre, les réticences de l’écrivain Hermann Hesse qui fit en sorte de ne jamais le rencontrer, alors qu’il venait de composer, en 1948, Vier letzte Lieder (Quatre derniers lieder), op. 150, un cycle de lieder pour soprano et orchestre dont les textes des trois premiers poèmes sont de l’auteur du Loup des steppes, opposant de la première heure à l’idéologie nazie[10].
Heidegger fut et demeure au cœur de nombreuses polémiques et controverses. Parmi ses défenseurs, il faut compter Marcel Conche auteur d’un Heidegger résistant (éditions de Mégare, 1996). Conche se refuse à voir en Heidegger un nazi. Dans un ouvrage publié au Livre de Poche (biblio essais), en 2011, Vivre et philosopher (réponses de Marcel Conche aux questions de Lucile Laveggi), le philosophe en réponse à la dix-septième question, Heidegger et le nazisme. Quel est votre jugement ?, actualise, étaye et confirme sa conviction du désaveu du philosophe allemand à la philosophie barbare et inhumaine du nazisme.
De toute évidence, Pierre Magnard partage cette vision du philosophe allemand, il se peut sans que je puisse le vérifier, avec des arguments différant quelque peu de ceux de Marcel Conche.
Le compositeur Albéric Magnard, Martin Heidegger, Pierre Magnard ont cette même vision de la noblesse du travail artisanal, quintessence de la main qui pense. Le charpentier, l’artisan, l’artiste pensent avec la main, les réunissent dans un même constat que je ne cesse de promouvoir.
Écoutons à nouveau Pierre Magnard :
« Le premier point est une redéfinition de la pensée : Heidegger va, en effet, répétant sans cesse, « la science ne pense pas » et d’opposer à la pensée calculante qui se résout dans la science et la technique, ce qu’il appelle la pensée méditante ou instinctive, décrite en analogie avec l’activité artisanale. « Penser c’est peut-être simplement du même ordre que de travailler à un coffre », dit-il dans Qu’appelle-t-on penser[11] ? Déjà dans Sein und Zeit, on trouve une très belle page consacrée à la définition de la pensée, non pas celle d’un intellectuel, mais celle du fils du charpentier, qui pense avec la main, car c’est la main qui va à la recherche des formes qui dorment dans le bois et qui sera capable de les réveiller. Il se souvient également que le menuisier était fils d’un maître cordonnier qui pensait lui aussi avec la main, mais alors armé d’un tranchet qui découpait empeignes et trépointes, pour pouvoir les ajuster sur le mode de la chaussure. Penser, c’était le fait de cette main ouvrière, de cette main artiste et Heidegger ne voyait pas d’autre expression plus élevée de la pensée. L’artisan pense avec la main. « La main, écrit Heidegger ; ne fait pas que saisir et attraper, ne fait pas que serrer et pousser, la main offre et reçoit, et non seulement des choses, car elle-même s’offre et se reçoit dans l’autre, la main garde, la main porte, la main trace des signes, la main montre, les mains se joignent quand ce geste doit conduire l’homme à la grande simplicité : tout cela c’est la main, c’est le travail propre de la main[12]. » On n’en finirait pas de relever toutes les notations que Heidegger consacre à ce souvenir de l’artisanat paternel, pensée artisanale, pensée artiste aussi, pensée qui prie, puisque les deux mains se joignent, pensée qui réconcilie et qui bénit, pensée qui remercie. Parfois, Heidegger va jouer sur la consonance qui n’est point étymologique, Denken-Danken, penser-remercier : penser, c’est rendre grâce. Étendue au monde du travail, la pensée fait grandir, elle élève […] Or, comme le répète Heidegger, le premier à effectuer cette confrontation et à vivre dans ses mains, dans ses bras, dans son corps, dans sa chair, c’est l’artiste, c’est l’artisan, c’est l’ouvrier. Et de mettre en avant cette façon qu’à l’homme d’aller à ses risques et périls face à ce qui advient pour le connaître et le découvrir, car le Dasein, comme l’écrit Henri Birault[13], est « un être toujours déjà jeté dans l’existence, c’est-à-dire incapable d’être à lui-même le principe de son être[14]». Voilà comment il fallait entendre le Dasein non plus comme une subjectivité abstraite, mais comme une existence immergée dans le monde et dans les forces qui l’animent. […] Heidegger allait plaider pour un existant rudis, fruste, naturel, spontané, qui n’a pour toute culture que le savoir de sa main, puisqu’il est fils de l’artisan. »[15]
[1] Étienne KIPPELEN, Chanson française & musique contemporaine, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2020.
[2] Michel SERRES, Musique, Paris, Le Pommier, 2011, p. 11.
[3] Euterpe 35, juillet 2020, publication des Amis de la musique française, avec au sommaire Le Groupe Jeune France de 1936 à l’après-guerre.
[4] Pierre MAGNARD, d’origine ardéchoise est né le 24 août 1927, il est Professeur émérite de l’Université Paris-Sorbonne, lauréat du Grand Prix de Philosophie de l’Académie française. Il fit ses études à Paris en Khâgne aux lycées Henri-IV et Louis-le-Grand, puis à la Sorbonne. Il eut comme principaux professeurs : Henri Gouhier, Ferdinand Alquié, Maurice Merleau-Ponty, Gaston Bachelard, Jean Beaufret, Henri Birault. Certifié, puis agrégé en 1957, il enseigne au Lycée de Moulins où il succède à Pierre Bourdieu, puis en Khâgne au Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Maître-assistant à l’université de Dijon, il soutient en 1974 sa thèse de doctorat d’État, Nature et Histoire dans l’apologétique de Pascal, ouvrage maintes fois réédité qui est devenu un classique. Il est nommé Professeur à l’Université de Poitiers en 1978, puis à l’Université de Paris-Sorbonne en 1988. Il a notamment contribué à faire connaître à la communauté savante, après Ernst Cassirer et Jean-Claude Margolin, l’importance de l’œuvre du philosophe renaissant, Charles de Bovelles. Pierre Magnard enseigna plus de cinquante ans, au cours desquels il encadra cent quatre-vingts thèses. Il fut chargé de trois mandatures au Conseil national de l’université (CNU), présida le Comité national du CNRS de 1985 à 1991, et fut chargé de mission auprès du ministère des Universités, ensemble qui fait de lui une importante figure du monde de l’enseignement et de la recherche. Il est l’auteur ou le co-auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont Penser c’est rendre grâce, le dernier publié. (d’après Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Magnard)
[5] Marcel CONCHE, fils de modeste cultivateur, est né le 27 mars à Altillac (Corrèze), philosophe, spécialiste de métaphysique et de philosophie antique. Il commence ses études à Beaulieu-sur-Dordogne qu’il poursuivit à Tulle, puis Limoges et à la Faculté des lettres de Paris, où Gaston Bachelard fut l’un de ses professeurs. Il obtient successivement la licence en philosophie (1946) et le diplôme d’études supérieures de philosophie (1947). Après avoir passé avec succès le concours de l’agrégation de philosophie en 1950. Marcel Conche enseigne successivement aux lycées de Cherbourg, d’Évreux et de Versailles. Assistant puis maître-assistant de philosophie à la faculté des lettres de Lille et enfin professeur (1978-1988) à l’Université de Paris I. Il y a dirigé l’Unité de formation et de recherche. Depuis 1988, il y est Professeur émérite. Agrégé de philosophie et docteur ès lettres, Marcel Conche a produit une œuvre à la fois abondante et variée, qui traite de nombreuses questions de métaphysique. Dans ses premiers ouvrages, il a développé une métaphysique générale et vaste, avec des études sur la mort (La Mort et la Pensée, 1975), le temps et le destin (Temps et destin, 1980), Dieu, la religion (Nietzsche et le bouddhisme, 1987) et les croyances, la nature, le hasard, (L’Aléatoire, 1989), la liberté enfin. Dès son plus jeune âge, la notion de Dieu perdit toute espèce de consistance aux yeux de Marcel Conche : « L’expérience initiale à partir de laquelle s’est formée ma philosophie fut liée à la prise de conscience de la souffrance de l’enfant à Auschwitz ou à Hiroshima comme mal absolu, c’est-à-dire comme ne pouvant être justifié en aucun point de vue. » Bien qu’élevé dans le christianisme, Conche a très tôt rejeté l’explication théologique du monde. Sa philosophie ne conçoit pas l’existence de Dieu ; en cela, il est philosophe athée. Néanmoins, si la philosophie se coupe par essence de la théologie, elle ne doit pas se constituer en science ni prétendre vouloir le faire. Conche soutient (en prenant pour base son expérience personnelle) que le questionnement philosophique naît « par l’essor spontané de la raison » : « La philosophie, c’est l’œuvre de la raison humaine et elle ne peut pas rencontrer Dieu. » C’est pourquoi il s’est toujours senti proche de la philosophie grecque qui commence avec Anaximandre, « le premier écrivain philosophe ». Selon Conche, les grands penseurs modernes (Descartes, Kant, Hegel) ne sont pas des philosophes authentiques, car ils ont voulu utiliser « la raison pour retrouver une foi pré donnée ». Ils n’ont pas compris ce qu’est la philosophie comme métaphysique, mais ont tenté d’en faire une science, ce qui apparaît à Conche comme une erreur fondamentale : « La philosophie comme métaphysique, c’est-à-dire comme tentative de trouver la vérité au sujet du tout de la réalité, ne peut pas être de la même nature qu’une science. Elle est de la nature d’un essai, non d’une possession : il y a plusieurs métaphysiques possibles, parce qu’on ne peut trancher quant à ce qui est la vérité au sujet de la façon de concevoir la totalité du réel. La métaphysique n’est donc pas affaire de démonstration, mais de méditation. » Le vrai philosophe de l’époque moderne serait Montaigne (Montaigne et la philosophie, 1987), car il a réussi, de l’avis de Conche, à écrire son œuvre indépendamment des croyances collectives de son époque (tout à la fin des Essais, Montaigne recommande non son âme, mais la vieillesse, non au dieu chrétien mais à Apollon). Dans son Naturalisme, Conche soutient la phusis grecque, la nature au sens le plus englobant du terme : « L’absolu pour moi, c’est la nature. La notion de matière me paraît insuffisante. Elle a d’ailleurs été élaborée par les idéalistes et c’est hors de l’idéalisme que je trouve ma voie. Il est très difficile de penser la créativité de la matière. […] La nature est à comprendre non comme enchaînement ou concaténation de causes, mais comme improvisation ; elle est poète. » Il retrouve sur ce point la pensée des présocratiques, avec lesquels il ne cesse de dialoguer sur le tout de la réalité (en particulier dans Présence de la nature, 2001) : « L’homme est une production de la nature et la nature se dépasse elle-même dans l’homme. En donnant des aperçus sur la nature qui se complètent, les présocratiques sont tout à fait différents des philosophes de l’époque moderne qui, eux, construisent des systèmes qui s’annulent. Parménide nous révèle l’être éternel, Héraclite, le devenir éternel, Empédocle, les cycles éternels. Il y a une complémentarité entre eux. De la même façon, les poètes se complètent. La physis grecque ne s’oppose pas à autre chose qu’elle-même, alors qu’au sens moderne la nature s’oppose à l’histoire, à l’esprit, à la culture, à la liberté. La physis est omni-englobante. » Soucieux du devenir de la planète, il se revendique « en faveur de ce que l’on appelle la décroissance ». La pensée de Conche sur ce sujet a évolué au fil de sa vie et de ses lectures de philosophes grecs tels que Pyrrhon, Héraclite et Parménide. Longtemps, Conche a été sensible au « caractère transitoire de toute chose, au caractère évanouissant des êtres finis », donnant une interprétation neuve du pyrrhonisme : le scepticisme de Pyrrhon consiste à affirmer qu’on ne peut connaître le fond des choses (l’être) ; on ne peut être certain que de la façon dont elles nous apparaissent. Conche a montré que cette distinction fondamentale entre être et apparence est dépassée chez Pyrrhon : en définitive, il n’y a plus d’être ; tout apparaît en un éclair puis s’évanouit, intuition que l’on retrouve chez Montaigne : « Car pourquoy prenons-nous titre d’estre, de cet instant qui n’est qu’une eloise [un éclair] dans le cours infini d’une nuict eternelle ? » Cette métaphysique de l’être débouchait sur ce que Conche appelle un « nihilisme ontologique ». Cette première conception a évolué avec la prise de conscience d’une distinction entre « temps immense et temps rétréci », soit le temps de la nature et le temps dans lequel nous pensons. Le « tout s’écoule » d’Héraclite apparaît alors intemporel : « Mais en définitive, il m’est apparu que le « tout s’écoule » est éternel, que le devenir est éternel. Donc la nature est éternelle : c’est ce qu’avait dit Parménide. » Ses travaux en histoire de la philosophie font autorité, par exemple ses éditions de Lucrèce ou d’Épicure. Il a consacré de nombreux commentaires, traductions, et études sur les auteurs de l’Antiquité, notamment Pyrrhon et surtout les présocratiques, à savoir Héraclite, Anaximandre et Parménide, ainsi que des auteurs asiatiques tels que Lao-Tseu (auteur du Tao Te King). Conche a également effectué des études critiques sur Hegel et Bergson. Il s’est fait le défenseur de Heidegger en refusant de voir en lui un nazi et a publié en 1996, aux Éditions de Mégare, un Heidegger résistant. Ses réflexions sur la morale s’articulent autour des thèmes suivants : fondement de la morale et distinction essentielle entre la morale et l’éthique. La morale traverse toute son œuvre, depuis Orientation philosophique (1974), et ses réflexions atteignent une densité particulièrement forte dans Le Fondement de la morale (1982). Conche a résumé sa position sur la morale ainsi : « [elle se fondera] sur le simple fait que vous et moi pouvons dialoguer, et nous nous reconnaissons par là même comme également capables de vérité et ayant la même dignité d’êtres raisonnables et libres. Et une telle morale, impliquée dans tout dialogue, différente aussi bien des morales collectives que des éthiques particulières, a bien un caractère universel, puisque le dialogue avec n’importe quel homme est toujours possible, en droit. » Marcel Conche se revendique également pacifiste (il a dénoncé le conflit engagé en 2003 par les États-Unis en Irak) : « Personnellement, je reste pacifiste. Ma position universalisable, mais ne pouvant être universalisée, reste abstraite, contradictoire. Fondamentalement, pour moi, le rôle de l’homme politique consiste à établir la paix, ce que de Gaulle a très bien compris. Vouloir réaliser la démocratie en l’exportant par la guerre, c’est criminel. » D’après Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Conche)
[6] Doris LESSING, Le temps mord (French Edition). Flammarion. Édition du Kindle.
[7] Pierre MAGNARD, Penser c’est rendre grâce, Paris, Le Centurion, 2020, p. 15-18.
[8] Jean BEAUFRET (22 mai 1907-7 août 1982) est un philosophe français, connu pour son amitié avec Martin Heidegger. Il fut un représentant éminent de la pensée du philosophe allemand en France. Élève de l’école primaire des Mars (canton d’Auzances) où ses parents sont instituteurs, Jean Beaufret fait ses études secondaires au lycée de Montluçon. Il entre en Khâgne au lycée Louis-le-Grand et assiste de temps en temps aux cours d’Alain au Lycée Henri IV. Il réussit le concours de l’École normale supérieure en 1928, effectue son service militaire, puis est reçu à l’agrégation de philosophie en 1933, après avoir passé sept mois à Berlin au moment de la prise de pouvoir de Hitler. Il rédige cette année-là un mémoire sur l’État chez Fichte, entame une thèse, qu’il n’achève pas, sous la direction de Jean Wahl, puis de Jean Guitton. Il rencontre alors Maurice Merleau-Ponty, Paul Eluard, Paul Valéry, André Breton. Il étudie la philosophie allemande, en particulier Fichte, Hegel, Marx. Fait prisonnier en 1939, il s’évade d’un train en route pour les camps et recommence à enseigner à Grenoble en 1940. Après l’assassinat de Victor Basch, il s’engage dans un réseau de la Résistance, le Service Périclès, qui fabrique de faux papiers. En même temps, il découvre Martin Heidegger en lisant Être et Temps avec Joseph Rovan qui est d’origine allemande et travaille dans le même réseau. La rencontre entre Jean Beaufret et Martin Heidegger est le fait de Frédéric de Towarnicki, qui rend visite à Heidegger à l’automne 1945. Cette rencontre entre Heidegger et Towarnicki, alors attaché auprès des forces d’occupation françaises, a lieu au beau milieu du procès de dénazification de Heidegger (juillet-décembre 1945), conduit par les autorités françaises et qui aboutit à la condamnation du philosophe (interdiction d’enseigner de 1946 à 1951). Towarnicki apporte à Heidegger une série de quatre articles de Beaufret intitulée « À propos de l’existentialisme », parue dans la revue Confluences. Heidegger voit dans ces textes une lecture pleine de finesse de Être et Temps. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois en septembre 1946. À dater de ce jour, outre son enseignement, Beaufret se consacre à faire connaître la pensée du philosophe allemand en France. À Paris, après guerre, il habite d’abord passage Stendhal, dans le XXe arrondissement, où passent de nombreux élèves et amis (dont le poète Paul Celan), et en 1955, il reçoit un soir d’été, René Char et Martin Heidegger, qui se rencontrent là pour la première fois. D’après Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Beaufret
[9] Martin HEIDEGGER, 26 septembre 1889-26 mai 1976, est un philosophe allemand. D’abord étudiant auprès d’Edmund Husserl et immergé dans le projet phénoménologique de son maître, son intérêt se porte rapidement sur la question du « sens de l’être ». Elle le guidera ensuite tout au long de son chemin de pensée et c’est en tentant de répondre à celle-ci, à l’occasion de la publication de son ouvrage Être et Temps (Sein und Zeit) en 1927, qu’il rencontre une immense notoriété internationale débordant largement le milieu de la philosophie. Dans les années 1930 à lieu ce qu’il appelle le « tournant » de sa pensée au moment de l’écriture de l’Introduction à la métaphysique. Il cherche à préparer un nouveau commencement de pensée, qui éviterait l’enfermement de la métaphysique – celle-ci étant devenue, pour lui, un mot qui rassemblait, selon Hans-Georg Gadamer « toutes les contre-propositions contre lesquelles Heidegger cherchait à développer ses propres tentatives philosophiques ». La Heidegger Gesamtausgabe, édition complète des oeuvres, en cours de publication, comprend plus de cent volumes, dont les ouvrages majeurs sont Être et Temps (Sein und Zeit, 1927) et Apports à la philosophie : De l’Avenance [Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)], ouvrage publié de manière posthume (1989 pour l’édition allemande et 2013 pour la traduction française). Heidegger est considéré comme l’un des philosophes les plus importants et influents du XXe siècle : sa démarche a influencé la phénoménologie et toute la philosophie européenne contemporaine ; elle a eu un impact bien au-delà de la philosophie, notamment sur la théorie architecturale, la critique littéraire, la théologie et les sciences cognitives. L’influence de Heidegger sur la philosophie française a été particulièrement importante. Elle s’est notamment exercée par le truchement des philosophes Jean-Paul Sartre, Jean Beaufret, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Maurice Merleau-Ponty… Il est également l’un des philosophes dont la personnalité et l’œuvre sont les plus controversées en raison de son attitude durant la période 1933-1934, où il fut recteur de l’Université de Fribourg après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, puis de 1933 à 1944 où il est resté adhérent au Parti national-socialiste. Plusieurs ouvrages ont paru pour analyser les rapports entre Heidegger et le nazisme. La publication, en 2014, de ses Cahiers noirs a déclenché une polémique concernant l’antisémitisme de certains passages. D’après Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
[10] Dans son Journal, à la date du 17 septembre 1933, Romain Rolland, proche ami de Hesse, évoque la visite qu’il lui fit à Montagnola (canton du Tessin, Suisse) et note parmi les états d’âme de Hesse, un certain détachement vis-à-vis des événements qui touchent l’Allemagne et en même temps : « Au reste, il ressent, au fond de lui-même, un mépris écrasant pour les Führer – notamment Hitler, qu’il voit médiocre, bien accordé à la médiocre sensibilité allemande, et choisi pour cela par ceux qui mènent l’affaire. Mais il se dit maintenant tout à fait détaché de la patrie allemande (ce que, ajoute-t-il, il n’eût pas dit, ni senti, pendant la guerre de 1914). » (Rolland, Romain. D’une rive à l’autre – Romain Rolland et Hermann Hesse : Correspondance fragments du Journal et textes divers – Cahier 21 (A.M. POESIE HC) (French Edition). Albin Michel. Édition du Kindle.)
[11] Martin HEIDEGGER, Qu’appelle-t-on penser ?, trad. par A. Becker et G. Granel, P.U.F., 1959, p. 89.
[12] Ibid, p. 90.
[13] Henri BIRAULT (18 mars 1918-16 avril 1990) philosophe français. Normalien, élève du métaphysicien Louis Lavelle et du philosophe moraliste Jean Nabert avant sa découverte de l’œuvre de Martin Heidegger dont il devient avec Jean Beaufret un de commentateurs français. Il fut professeur à Khâgne d’Henri-IV, assistant et professeur à la Sorbonne puis à Paris IV. Il a donné un grand nombre de conférences dans des cercles et universités du monde entier. Sa réflexion menée principalement à partir des œuvres de Pascal, Kant, Nietzsche et Heidegger. Michel Guérin écrit : « Henri Birault était un lecteur et un commentateur comme il n’y en a pas beaucoup. Le texte était lu, tâté, dans sa langue d’origine (l’allemand, le français, le latin ou le grec), et la traduction/interprétation s’ensuivait, qui reprenait, décortiquait, relançait enfin la prosodie afin qu’on entendît bien ce que ce mouvement voulait dire. […] Birault était respecté et admiré de la communauté philosophique (Deleuze, de Gandillac, Alquié, Wahl, Boehm, Heimsoeth…), et pourtant, il n’a publié, de son vivant, qu’un seul (gros) livre, Heidegger et l’expérience de la pensée. » Sa pensée se conclut par une approche de la contemplation. Ses travaux, outre de très nombreux articles et participations à des ouvrages collectifs ont fait l’objet d’une réécriture constante. (D’après Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Birault)
[14] Henri BIRAULT, Heidegger et l’expérience de la pensée, Paris, Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 1978, p. 601.
[15] Pierre MAGNARD, Penser c’est rendre grâce, « Le mal du pays en son propre pays », op. cit., p. 32-37.
Dimanche 16 août 2020
Déjeuner sur l’herbe
« Au plus fort de l’orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C’est l’oiseau inconnu, il chante avant de s’envoler.»[1]
Il y a dans l’imprévisible, un côté intemporel et magique.
Nous étions onze au jardin, ce 15 août 2020, en un lieu assez inhabituel, sous le cerisier du japon Mount Fuji, certes un peu distant de la maison !
 |
 |
|
| Le déjeuner sur l’herbe | La table de Jean-Michel | |
Je ne pus m’empêcher d’avoir une pensée pour le cher Père Pommarède qui nous quittait, en 2010, un mois après Gabriel Combeaud et Yolande Dougnac, un mois avant notre mère, en ce jour particulier pour lui qui avait une dévotion pour la Vierge.
 |
 |
|
| Nathalie, ma nièce | Laurent & Jean-Michel | |
Nathalie est fidèle à son vieil oncle et comme elle a épousé un garçon intelligent, tout est possible au cœur de ce foyer, ainsi que dans leurs relations empreintes d’intégrité humaniste et d’authenticité écologique. Laurent possède une lucidité hors norme, sans qu’elle soit agressive, comme je peux parfois, excédé par l’ignorance et la stupidité, l’exprimer. Nathalie avait sollicité de faire un pique-nique au jardin avant de laisser ses deux enfants, Coline et Guilhem, chez leur grand-père pour un séjour d’une semaine.
Le lendemain, elle me dit que sa sœur Muriel et son compagnon Sébastien, déjà en séjour avec leur fille Romane, chez le grand-père, aimeraient se joindre à nous.
 |
 |
|
| Muriel, ma nièce | Sébastien & Romy | |
Jean-Michel vint volontiers m’aider pour sortir de leur long sommeil, tables et chaises de jardin quelque peu dégradés, qui furent de haute actualité entre 1997 et 2007 ; et encore m’aider pour l’installation des tables, des couverts et le service. Non pas m’aider, mais me supplanter, l’inhabitude prise depuis des années et l’âge, désormais, me desservant !
Mes cousines Pierrette et Jackie ne se firent pas prier pour se joindre à la bande du déjeuner sur l’herbe, qui avec mes anciennes pratiques, en l’absence même de fleuve coulant dans le creux du chemin de randonnée, devint une sorte de déjeuner des canotiers si merveilleusement peint par Auguste Renoir. Ombres et lumières.
 |
 |
|
| Romy | Romy et son tigre | |
Comment est-il possible de concevoir une petite demoiselle aussi ravissante que Romane ou Romy ? À un peu plus de deux ans, elle incarne la joie, le bonheur de vivre et possède un charme absolument irrésistible.
 |
 |
 |
||
| Guilhem et Coline | Guilhem | Dessins : Guilhem & Coline | ||
Son petit cousin de 4 ans, Guilhem, poète en herbe, ne s’y trompe pas ; ils sillonnèrent les coins et recoins du jardin, jouant, s’extasiant, jubilant… un si vaste territoire pour les jeux, n’est-ce pas fantastique ? Je les imaginais en trio avec Yann Rivière créant un tourbillon apte à épuiser les plus de 30 ans !
 |
 |
 |
||
| Coline & Nathalie | Pierrette et Coline | Coline entre Jacky et Pierrette | ||
Coline, sept ans et demi, quant à elle, grande, jolie, rêveuse, une vraie Demoiselle à la magnifique chevelure de Mélisande, trouva vite auprès de Pierrette, une mamie d’adoption.
 |
| Avec mes cousines Pierrette & Jacky |
Avec Jacky et Pierrette, nous sommes cousins seconds, leur grand-père commun Marcel Rivière était l’aîné de six enfants. Marcel et ma grand-mère maternelle Clotilde, étaient frère et sœur. Et c’est par le sang des Rivière et des Parcelier (Françoise Parcelier, épouse de Jean Rivière) que nous sommes liés.
Mes deux nièces, filles seconde et troisième de ma sœur Françoise, sont épanouies. Elles ont trouvé l’une et l’autre le compagnon idéal. Je n’aurais pas pu me choisir moi-même de plus parfaits neveux, si attentivement paternels, intelligents, bienveillants, totalement heureux d’avoir engendré de si beaux enfants !
On pourrait imaginer la fratrie Rivière : Marcel, Clotilde, Mathilde, Gaston, Henri, André, jouer aux ‟Volves” sur la commune de Biras, un jour d’été, vers 1910.
Avec l’éternel retour des beaux jours, les générations se suivent, ayant ces mêmes jeux, si simples, émoustillants : « Tu te caches, je te cherche, je te trouve » on rit beaucoup et puis « À toi, maintenant ! » Les heures, les mois, les ans, les décennies défilent, mais ce sont presque toujours les mêmes enfants qui jouent, rient et exultent de bonheur.
La valeur des choses
n’est pas dans la durée, mais
dans l’intensité où elles arrivent.
C’est pour cela qu’il existe
des moments inoubliables,
des choses inexplicables
et des personnes incomparables.[2]
[1] René Char, « Rougeur des matinaux », Les Matinaux, 1950.
[2] Fernando Pessoa, Le Livre de l’intranquillité.
7 août 2020
Premier bilan 2020
Ce matin, comme j’achevais ma marche sur la Voie Verte de Saint-Astier, deux ouvriers sur les trois, qui travaillent à débroussailler les ronciers touffus et à rafraîchir les arbustes sur les pentes à 70° du canal, un travail d’enfer, discutaient de l’exploitation des contrats aidés sous Mitterrand, de la pénibilité de leur travail et de leurs salaires modestes. Ils ont entendu le reste ! Ceux qui font le travail le plus difficile, le plus dangereux, le travail essentiel pour la vie collective, sont ceux qui gagnent le moins dans notre système. Nos politiciens inefficaces, souvent corrompus, un bon nombre de fonctionnaires, valetaille d’un pouvoir dominateur et exploiteur se sucrent pendant que les utiles, les indispensables, les nécessaires y laissent la peau.
J’ai tant vu de collègues argumenter sans agir, être parfaitement incapables de prendre une décision même simple, directeur y compris, de branleurs impénitents, bénéficier de rémunérations confortables sans avoir à en justifier. La précarisation des travailleurs, de ceux qui produisent la richesse d’un pays, montre la subordination entretenue, un peu à la manière dont on traitait les autochtones des pays colonisés et certainement de nos jours encore sous des régimes post-coloniaux où des enfants très jeunes travaillent durement dans des conditions honteuses et même criminelles.
Des hommes, des femmes, des enfants en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, dans les pays de l’Est ou en Grèce touchent pour un travail intense, hors contrôle de toutes règles de dignité au travail, des sommes dérisoires (moins de 25 € mensuels), pendant que les capitaines du capitalisme engrangent des sommes folles (on parle de 800 € à la seconde pour certains). Cette forme, aménagée de l’esclavage et de la misère, est-elle acceptable ?
* * *
Que dire d’une année où les disparitions de relations proches n’ont pas cessé d’advenir, d’une sorte d’état grippal qui s’incrusta sur quatre semaines en février, puis de cette pandémie et de ses conséquences paralysantes ? Et désormais s’y ajoutent canicule et sécheresse… Il y a vraiment de quoi ne pas vouloir aimer 2020. En même temps, tous mes efforts pour changer une courge terrorisée et capricante en princesse, furent vains, je n’avais pas la bonne baguette magique. Je partage assez cette réflexion de Charles Bukowski, sur la gent féminine : « Il y a toujours une femme pour vous sauver d’une autre ! »
D’évidence, les reprises des marchés de Manzac et de Neuvic, la découverte de Lo Comin bio de Bourrou m’auront tiré d’une maussaderie insidieuse. Deux fêtes très réussies, bon enfant, à Manzac pour le 14 juillet et le 1er août m’ont parues propices à retisser du lien social et à regarder la vie positivement ! Le marché de Manzac ne va pas sans soubresauts du type enfantillages ; il y faut toute l’énergie positive, la fermeté, la gentillesse de Claire Vertongen pour y faire face avec intelligence, mais elle n’est pas à l’abri de quelques orages. Le nouveau maire semble être actionnaire du principe du bien vivre ensemble au cœur de nos villages ; il est peut-être temps d’en revenir à la simplicité pastorale de nos riantes et paisibles campagnes.
Il nous faut garder les distances depuis si longtemps que l’on s’habitue à cette sorte de rudesse dans les relations humaines, moins nombreuses par précaution, toujours un peu frileuses.
* * *
La visite surprise de ma sœur Christine, de sa fille Sophie accompagnée de ses deux fils, Rodrigue et Lorenzo, m’aura fait grand plaisir. Ce moment de retrouvailles familiales au jardin fut bien apprécié par tous, me semble-t-il !
 |
 |
 |
||
| Sophie, ma nièce | Sophie et son fils Lorenzo | Christine Dougnac, ma soeur | ||
 |
 |
 |
||
| Lorenzo | Le vieux tonton content et ses petits-neveux | Le très sage Rodrigue | ||
Nous nous sommes tous embrassés, sans créer de cluster. Le repas du 2 août, à Lamonzie Saint-Martin, chez Annick et Jeantou fut sans doute le plus heureux temps de l’année. Jacky, arrivant de Brantôme, me conduisit jusqu’à chez Pierrette à Lembras ; Jean-Pierre au volant nous fit contourner Bergerac jusqu’à destination.
 |
| La famille Rivière, Annick, David, Alexandre, Jeantou |
La famille Rivière est belle, elle est représentée par deux fils solides, Alexandre et David qui sont les continuateurs du label ! Les parents, Annick et Jeantou ont bien de la chance avec ces deux garçons sérieux, travailleurs, particulièrement doués.
David est là avec Julie et leurs deux fils. Yann le plus jeune (pas encore 2 ans) est plein de vie, joyeux, vibrant d’intérêt pour tout ce qu’il découvre. Quant à Tom, l’aîné (4 ans), il ressemble au Petit Prince de Saint-Exupéry. C’est le plus bel enfant qu’il m’ait été de voir, une absolue beauté, qui possède un univers magique bien à lui, qui parfois se connecte à notre monde très prosaïque. Je suis fasciné par cet enfant, qui semble, derrière son silence qui s’émaille de plus en plus de mots appropriés, doté d’une intelligence hors norme. Julie est une fleur et heureux celui à qui l’existence fait un tel don. Ravissante, investie, elle est l’âme de ce foyer exemplaire.
 |
 |
|
| Orane, Céline et Alexandre Rivière, le maître de maison | Pierre Rivière, Jacky Clément, Pierrette Martinet, Annick Rivière | |
L’unique enfant d’Alexandre, plus réservé que son frère, c’est sa maison, toute récente et superbe, aménagée avec un goût et un soin parfaits : espace et sobriété, pour un mode de vie limpide. C’est un pâtissier hors pair, en réalité très professionnel, bien que ce ne soit pas son métier.
 |
 |
|
|
Mariage d’Henri Rivière. Jean Rivière le fondateur de la dynastie et Françoise Parcellier-Rivière, en haut Marcel Rivière et son épouse, André Rivière, Clotilde Rivière-Lamaud, Léopold Lamaud, notre mère, Yvonne Lamaud-Joubert |
Baptême de Jeantou Rivière à Saint Crépin de Richemont, propriété de la belle Élina Paul et Christiane Rivière, le frère et la soeur de Christiane, André Joubert, Henri Rivière, Léopold Lamaud et Christine Joubert, Arlette Rivière-Lavit, ses filles, Janine et Jacqueline (dites Jacky) |
|
 |
 |
||||
|
Christiane Rivière et son premier fils, Jeantou Rivière le nouveau patriarche de la dynastie Rivière |
Alexandre, le grand pâtissier de la famille Rivière | ||||
Mes précédents textes ont déjà évoqué Pierrette, Jean-Pierre et Jacky, ils sont au cœur de ces retrouvailles d’une importance inespérée, une des très grandes et belles surprises que peut nous réserver la vie. C’est le trésor familial caché que nos aïeux, dont je ranime si souvent le souvenir, avec émotion, m’auront fait, au seuil du grand voyage. Les enfants de Paul et Christiane Rivière furent élevés au Prat d’Eyvirat puis dans le bergeracois, à la dure, de bonne heure habitués aux travaux des champs, à la vie rustique, ce qui leur confère une solidité rare de nos jours.
Pierre est aussi réservé que son frère Jeantou, aussi quelle heureuse surprise de le trouver là, autour d’une bonne table, par une journée d’été respirable ! Peu loquace, il s’ouvrira à moi comme à Jacky. Pierre est un Rivière qui fait honneur à cette lignée chez qui le courage et la vaillance sont les fers de lance d’une vie d’honneur. J’étais très heureux de le revoir et il semble qu’il en fût de même pour lui.
La table s’élargissait pour les très savoureux desserts, réalisés avec grande classe par Alexandre. Céline, fille de Pierrette et Jean-Pierre, Damien, son époux, se joignirent à nous avec leurs deux filles, Ilana (qui s’applique à une personnalité particulièrement active, volontariste, entreprenante, audacieuse et combative) et Orane (un prénom qui signifie passionnée et déterminée).
 |
| Pierrette Martinet, née Rivière, le Grand Coeur qui rassemble |
Dans ces familles, ce sont les femmes qui éduquent essentiellement leur progéniture et participent à celle de leurs petits-enfants. Nous sommes dans des nids.
Mon travail professionnel qui m’a tant appris, m’avait conduit à vouloir protéger les exploités. L’observation de la France salvatrice au travail pendant le pic de la pandémie, l’ardeur de cette jeunesse qui tient un stand sur les marchés, cette expérience familiale, m’enseignent que les travailleurs sont les seuls humains utiles et nécessaires à la vie en société. Il y a beaucoup de rapaces et de prédateurs pour tirer profit de ces seuls indispensables. L’oligarchie, souvent incapable, se goinfre et se vautre dans le gain généré par le travail de beaucoup d’autres.
Comment ne pas observer la simplicité des classes laborieuses, habituées au travail, au service, à la générosité ?
Entendu à la télévision, la déclaration d’un footballeur amateur marseillais : « On n’a pas besoin d’un doctorat pour s’entraider. » ♦
| « Et chaque individu croit qu’il sera heureux demain, s’il est plus riche, plus considéré, plus aimé, s’il change de partenaire sexuel, de voiture, de cravate ou de soutien-gorge. Chacun, chacune attend de l’avenir des conditions meilleures, qui lui permettront, enfin, d’atteindre le bonheur. Cette conviction, cette attente, ou le combat que l’homme mène pour un bonheur futur, l’empêchent d’être heureux aujourd’hui. Le bonheur de demain n’existe pas. Le bonheur, c’est tout de suite ou jamais. Ce n’est pas organiser, enrichir, dorer, capitonner la vie, mais savoir la goûter à tout instant. C’est la joie de vivre, quelles que soient l’organisation et les circonstances. C’est la joie de boire l’univers par tous ses sens, de goûter, sentir, entendre, le soleil et la pluie, le vent et le sang, l’air dans les poumons, le sein dans la main, l’outil dans le poing, dans l’oeil le ciel et la marguerite. Si tu ne sais pas que tu es vivant, tout cela tourne autour de toi sans que tu y goûtes, la vie te traverse sans que tu ne retiennes rien des joies ininterrompues qu’elle t’offre[1]. » |
[1] René Barjavel, Si j’étais Dieu.
JUILLET 2020
Vendredi 31 juillet 2020
Lawrence Ransom
Début 2020, les deuils se sont succédés : Meg Jones, Claudine, Pierre Jouin, Maurice Claude, Madeleine Marcoux, Françoise Decroix, Josette de La Barbacana… Mais sans que le Covid-19 y soit vraiment pour quelque chose, sauf peut-être pour Pierre.
Et au-delà de ces tristesses continuelles de l’actualité des six premiers mois de l’année, il y a les méchantes nouvelles qu’incidemment, j’apprends avec beaucoup de retard. C’est le cas de la disparition de Lawrence Alexis Ransom, hybrideur d’iris, que je rencontrais au moment de la création la plus intense de mon propre jardin au début des années 90, un peu après avoir rencontré madame Françoise Decroix, en 1987. Cette dernière habitait à Monflanquin, Lawrence, était installé à Hautefage-la-Tour. Je retrouve les traces d’une visite mémorable du samedi 8 mai 1993 où je fis sous sa direction mes quatre premières hybridations qui n’eurent pas le moindre intérêt. J’étais en compagnie de Philippe Basque, botaniste, qui travaillait chez Desmartis à Bergerac, et nous nous rendîmes ensuite, dans l’après-midi, à Rastel, chez Georges Gallier, qui était le président de l’association La Salicaire, sise à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Notre retour à Bergerac se fit, en fin d’après-midi, par Hautefage-La-Tour.
 |
 |
 |
||
| Visite du 25 avril 1993, Iris au Trescols, Hautefage-la-Tour | ||||
Comment ai-je connu Lawrence Ransom ? Était-ce par Françoise Decroix, ou la résultante de rencontres lors des bourses des plantes soit à Casteljaloux, soit celles de la Salicaire. Ainsi, le dimanche 25 avril 1993, nous fîmes la route par Laroque-Timbaut jusqu’à Saint Arnaud, Bajamont ; il me semble que c’était chez Claude-Louis Gayrard. Il y avait là Georges Gallier, Clive Jones, et bien d’autres ; nous eûmes droit à un orage et à des trombes d’eau !
Mais la plus grande probabilité demeure la recommandation de Claude-Louis Gayrard, alors trésorier me semble-t-il, de la SFIB (Société Françaises des Iris et Bulbeuses), un garçon affable et généreux, dont la disparition précoce nous aura tous atterrés.
C’est en parcourant le site Iris en Périgord de Christine Cosi, que j’ai su qu’elle avait côtoyé Lawrence durant vingt années, avant de cultiver et hybrider des iris à Biron, au sud de la Dordogne, en limite du Lot-et-Garonne. Lorsque j’ai lu sur sa page d’accueil l’origine de sa passion, on peut imaginer combien je fus troublé en découvrant que Lawrence, de sept ans plus jeune que moi, avait disparu le 31 juillet 2016. Ce fut un choc et une profonde tristesse, d’autant que j’apprenais, début juin, la disparition de madame Françoise Decroix.
« Le 31 juillet de cette année, le monde des iris a appris avec tristesse le décès subit de Lawrence RANSOM, un des plus talentueux hybrideurs de notre génération. C’était surtout un ami pour moi et nous avons vécu à quelques kilomètres l’un de l’autre pendant des années. Il fut mon maître et m’a beaucoup appris. Sans lui, je n’aurais sans doute pas osé me lancer dans l’aventure de l’hybridation. Ne ménageant ni ses conseils ni ses appréciations, il a toujours été présent pour m’aider dans mes choix.
Son frère, Martin, a décidé de faire don de sa collection à la SFIB afin qu’elle ne disparaisse pas. Il m’a également fait don de certains iris de Lawrence qui manquaient à ma collection afin que je puisse perpétuer dans mon jardin cette passion commune qui nous animait.
Aussi, dès l’an prochain (2017), vous pourrez admirer ses plus récentes obtentions et, en 2018, vous promener dans l’espace qui sera dédié à ses divers iris. »
Dans un message qu’elle m’adressait le 22 mai dernier, Christine Cosi joignait une photo d’une de ses créations : ‟Lawrence Ransom”, résultat de l’hybridation d’‟Armagnac” par ‟Decadence”. Un hommage a son ami et inspirateur disparu.
La photo de Lawrence Ransom, a été prise par son frère Martin quelques heures avant son décès brutal, lors d’une réunion de famille. Christine Cosi a obtenu auprès de Martin cet ultime portrait. Qu’ils en soient vivement remerciés tous les deux. Souvenir, certes douloureux, d’un artiste que nous avons tous apprécié et profondément admiré.
 |
|
Lawrence Ransom Photo©Martin Ransom, 31 juillet 2016 |
* * *
Comme beaucoup d’amateurs passionnés, j’ai voulu tout avoir : cinq cent rosiers (botaniques, anciens, modernes), quatre-vingts variétés d’obtentions récentes d’iris trouvées chez Lawrence Ransom, mais aussi en feuilletant les catalogues Cayeux, Bourdillon, Iris en Provence… Ici, le terrain siliceux, très sec l’été, sur lequel l’ombre s’étend, ne fut pas propice aux magnifiques floraisons du départ. Elles régressèrent de plus en plus, me conduisant à offrir les rhizomes restant à des amis qui possédaient des espaces ensoleillés.
Il fut une période où je passais voir la collection et les nouvelles obtentions de Lawrence et sur mon insistance il avait, un peu à contrecœur, accepté de me laisser emporter une variété, non encore enregistrée, contournant ainsi les règles de la profession comme celle de l’extrême rigueur du personnage qu’il incarnait.
Peut-être, l’interrogation inquiète de Sylvain Ruault contenait-elle l’intuition de ce qui est advenu en 2016. Elle fut publiée initialement sur son site, le 5 juillet 2013, réitérée et augmentée le 18 juillet 2014, au retour du Concours d’iris de Florence : « ‟Pas de catalogue Iris au Trescols cette année. Je ne connais pas la raison de cette absence, mais j’espère qu’il ne s’agit que d’une interruption sabbatique. Et j’ai hâte de voir les nouveautés que Lawrence Ransom nous réserve pour 2014”. Aujourd’hui, il n’y a toujours pas de catalogue Iris au Trescols. Celui que je considère comme le plus doué des hybrideurs français est en plein doute. Doute sur l’intérêt pour lui de continuer la vente d’iris ; doute sur sa capacité physique, les années passant, de cultiver seul ses chers iris qui lui brisent le dos ; doute sur l’évolution actuelle du monde des iris… Mais toujours autant de passion pour l’hybridation. Cette passion, sera-t-elle suffisante pour le conduire à reprendre le travail ? Tous ceux qui l’apprécient, et tous les amis des iris l’espèrent et le souhaitent. »
Ce post suscita pas mal de réactions, car Lawrence avait ses fidèles, ce qui est bien légitime lorsqu’on connaît son travail et ses incontournables réussites. Dans sa réponse du 30 juillet 2014, Lawrence Ransom, parle d’un malaise sur la difficulté du métier, certes inspiré sur une passion artistique, mais qui s’avère pesant lorsque les années avancent : « Je peux vous assurer que mon retrait sabbatique en 2013 et de cette année n’a rien à voir avec de quelconques raisons commerciales, même s’il est indéniable que cette activité ‘ne paye pas’ les heures de travail fourni, sauf pour celui qui a, contrairement à moi, une superficie importante avec tracteur, gros matériel et main d’œuvre et, en plus des clients particuliers, un important réseau de jardineries revendeurs. Mais cela n’a jamais été mon cas, ni mon désir. Non, la raison de mon retrait est principalement due à un malaise ressenti vis-à-vis d’une partie du Monde de l’iris actuel. Malgré cela, j’espère pouvoir vous présenter quelques nouveautés en 2015 ! »
* * *
Pour celui qui voudrait étudier l’œuvre de ce créateur, il faudrait, en un premier temps, lire toutes les chroniques de Sylvain Ruault sur son passionnant et très documenté blog irisenligne. Il faudrait encore observer les recherches et les croisements de Christine Cosi qui ayant longuement côtoyé Lawrence Ransom, possède probablement quelques-unes des clés des nombreuses réussites de ce dernier. Nous nous bornerons donc, en parfait incompétent, à examiner certaines analyses de Monsieur Sylvain Ruault.
 |
| ‘Samsara’, Ransom, 1996, ‘Caroline Penvenon’ X ‘Catalyst’ |
Sur son site, le 2 février de l’année 2002, il évoque l’iris ‘Samsara’ qui « n’est pas le seul iris de qualité obtenu par Lawrence Ransom. Cet obtenteur discret, plus attiré par le travail d’hybridation que les honneurs ou l’argent, nous a donné des merveilles depuis ‘Opéra bouffe’ (1992), jusqu’à ‘Ultimatum’ (1994), ‘Desiris’(1994), ‘Claude Louis Gayrard’ (1996), ‘Damoiselle’ (1997), ‘Nebolio’ et ‘Gladys F. Clarke’ (2000), pour n’en citer que quelques-uns.
Cependant, ce ne sont pas les grands iris qui retiennent le plus son attention, mais les iris nains pour lesquels il a créé des variétés extrêmement originales, et les croisements interspécifiques à base d’arils, avec qui il a obtenu des résultats stupéfiants. Il est certainement dommage que le travail de Lawrence Ransom ne soit pas plus connu. Cela provient du caractère exclusivement artisanal qu’il entend conserver à son entreprise, et de son désir de se consacrer intensément à l’hybridation, sans se soucier du reste. Connaissez-vous un hybrideur qui refuse de faire visiter son exploitation au moment de la floraison, pour ne pas être dérangé par ceux qui prendraient un peu trop de son temps au moment où il donne sans répit de la pince à étamines ? »
Le 5 juillet 2003, la chronique de Sylvain Ruault s’intitule Un mariage heureux.
« On les a mariés, et ils ont eu beaucoup d’enfants, tous beaux. Si j’en crois la lettre de présentation de son catalogue 2003, Lawrence Ransom a connu ce conte de fée. « Avec le croisement ‘Violet Lulu’ X ‘Couture Star’, il a obtenu « une quantité embarrassante de plantes dont les fleurs sont aussi intéressantes les unes que les autres ! » L’une des qualités principales, c’est « une jolie forme de fleur aux sépales larges et plus ou moins horizontaux », « ce qui est préférable pour les iris nains qui sont vus habituellement du dessus. […] Avec un tel panel de variétés intéressantes, il n’est pas tellement surprenant que le croisement réalisé par Lawrence Ransom ait donné d’aussi brillants résultats. Cependant, comme toujours en la matière, une part de chance s’ajoute à la pertinence des choix de géniteurs. Le croisement ‘Violet Lulu’ X ‘Couture Star’ va nous permettre, dès le printemps prochain de faire la connaissance de quatre de ses rejetons, ‘Ange Bleu’ (Ransom 2003), ‘Joujou’ (Ransom, 2003), ‘Merci’ (Ransom 2003) et ‘Zinzin’ (Ransom 2003), tous dans les tons de bleu, avec des différences dans la disposition des couleurs, et l’omniprésence du blanc qui valorise le reste. Il paraît qu’autant d’autres variétés sont en attente pour les années à venir. Tant mieux ! Et bravo ! »
 |
| ‘Ange bleu’, Ransom, 2003 |
Le 4 octobre 2007, dans la chronique intitulée « Tout petit petit » au sujet des iris nains miniatures (MDB), Sylvain Ruault précise qu’ « Ils sont défendus avec enthousiasme par la Dwarf Iris Society, fondée en 1950 par des amateurs passionnés par leur caractère hâtif, leur forme délicate, leurs couleurs fraîches et leur résistance aux intempéries et aux aléas du climat… En France, les défenseurs des MDB sont peu nombreux. Les catalogues des principaux producteurs ne les commercialisent pas. Ce n’est donc pas facile de faire leur connaissance […]. Pour donner une idée, les curieux peuvent se tourner vers le seul catalogue français où se trouvent ces iris, celui de Lawrence Ransom – Iris au Trescols – qui, avec son ami Jean Peyrard, obtient des MDB. ‘Voie Lactée’ (Peyrard 92), ‘Dekho’ (Ransom 93), ‘À Gogo’ (Ransom 93), ‘Passion Bleue’ (Peyrard 95), ‘Bisou’ (Ransom 94), ‘Punk’ (Ransom 98), ‘Zarbi’ (Ransom 2002) et ‘Guilli-Guilli’ (Ransom 2007) constituent toute la panoplie de leurs obtentions. C’est suffisamment étendu pour être signalé et mériter que l’on félicite ces deux audacieux pour leur éclectisme. »
 |
| ‘Tainà Ransom’ (‘Sensuelle’ X ‘Poetic’), Ransom, 2010 |
Dans « Échos du monde des iris », la chronique du 29 juin 2012 s’intitule Ransom 2012. Sylvain Ruault fait la part belle à cet artiste d’origine anglaise venu exercer sa passion et son art chez nous : « Lawrence Ransom vient de rouvrir son site et d’y faire son offre pour 2012. Les variétés de grands iris ne sont que trois, mais ce sont de pures merveilles. Avec le temps, le travail de Lawrence Ransom s’épure et tend vraiment vers la perfection. Les variétés ‘Chloe Ransom’ (‘Edith Bubbles’ X ‘Claude Louis Gayrard’), en bleu lavande pastel, et ‘Tainà Ransom’ (‘Sensuelle’ X ‘Poetic’), en abricot crémeux, sont des chefs d’œuvre de délicatesse et de bon goût. »
 |
| ‘One Eighth’, Ransom, 2015 |
Le 7 avril 2017, il est question de : « ‘One Eighth’ (Ransom, 2015) (‘Refosco’ X ‘High Master’). C’est la dernière variété enregistrée par Lawrence Ransom et rien qu’à ce titre elle mériterait une mise en lumière, mais cela n’est pas son seul titre de gloire. Elle fait partie du dernier lot de plantes que j’ai reçu de Lawrence (ou, plus exactement, de son frère lorsque celui-ci a liquidé les iris cultivés par Lawrence), et je vais la voir fleurie en ce printemps 2017 pour la première fois dans ce qui fut ma collection et qui fait désormais partie de celle de la commune de Champigny, cité de l’iris. […] Lawrence Ransom s’est toujours intéressé à ces fleurs délicates et rares que sont les iris d’Asie Centrale. En vingt ans de carrière, de 1995 à 2015, il a enregistré 43 variétés d’arilbreds et 3 variétés de purs arils. Ce qui fait de lui un véritable spécialiste de ces fleurs. Avec son compère Jean Peyrard qui pour sa part à enregistré trois arilbreds, ils constituent une exception européenne qui n’est pas assez reconnue.
On ne saura jamais si Lawrence Ransom avait l’intention de poursuivre dans la voie de ‘One Eighth’ et de mettre au point un nouveau modèle d’iris barbu dans lequel les traits caractéristiques des arils viendraient compléter la palette des hybrideurs. Des tentatives ont déjà eu lieu, mais elles ont échoué. […] Peut-être que Ransom avait trouvé une solution. Sa disparition prématurée a mis un terme à tous ces espoirs. »
Enfin, le 22 décembre 2017, Sylvain Ruault publiait ces lignes sous le titre « Audace et sensibilité » :
« L’hybrideur avec lequel, jusqu’à ce jour, j’ai eu le plus de contacts, c’est Lawrence Ransom, qui nous a quitté il y a un peu plus d’un an. De ces échanges nombreux, il me reste le souvenir d’un homme d’abord difficile mais profondément sensible et chaleureux. « Droit dans ses bottes » (comme certains ont dit), il a suivi sans dévier un chemin rocailleux dont étaient bannis compromission et esprit mercantile. Il en a résulté une oeuvre d’obtenteur exigeant ; et ce qui est remarquable, c’est combien les variétés qu’il a obtenues et enregistrées sont l’exact reflet de son personnage et l’expression de son bon goût. Dans sa terre du Sud-Ouest, il a obtenu des iris splendides et rares par leur élégance et leur chic. Des fleurs qu’il désirait «dainty» et que l’on peut qualifier de «glamour». Il ne s’est pas contenté de la culture, facile, des grands iris, ni même de celle moins galvaudée des variétés naines, mais il s’est aussi consacré à celle, délicate, des iris arils et des croisements inter spécifiques inédits. C’est en ce domaine qu’il a fait preuve d’audace et contribué de la meilleure façon à sa renommée dans le petit monde des iris. Sensibilité et audace sont donc, à mon avis, les termes qui qualifient le mieux ce personnage peu commun.
Pour ce qui est de la sensibilité, elle apparaît particulièrement dans ses grands iris de jardin (TB). J’ai cultivé plus de la moitié de ses obtentions (grands iris et iris nains standards) et je ne m’en suis jamais lassé. ‘Opera Bouffe’ (1991), ‘Claude Louis Gayrard’ (1995), ‘Samsara’ (1996), et surtout ‘Désiris’ (1993) font partie des variétés que j’aimerais emporter sur mon île déserte. Ce sont des iris qui n’ont pas obtenu la diffusion qu’ils auraient méritée, mais à mes yeux le fait que leur distribution ait été aussi confidentielle ne fait qu’ajouter à leur valeur. ‘Opéra Bouffe’ date de 1991, au tout début de sa carrière. Il est de (‘Debby Rairdon’ X ‘Spirit Of Memphis’ ), un croisement qui n’a rien de révolutionnaire, mais le produit affirme déjà la spécificité de son auteur : une fleur parfaitement proportionnée, délicatement ondulée, avec une matière charnue assurant une longue tenue, le tout sur une plante saine et vigoureuse. ‘Claude Louis Gayrard’, quatre ans plus tard, démontre que Lawrence a parfaitement assimilé les règles de base de l’horticulture. Son iris allie le modèle amoena inversé à un «self» prestigieux (‘Edge Of Winter’ X ‘Mystique’). Le résultat est un délice de perfection formelle et de délicatesse des couleurs… ». [Pour les amateurs, les passionnés, j’ai souhaité mettre la suite de cette longue analyse en note de bas de page[1].]
Un obtenteur d’iris, de roses… est à comparer à un écrivain, un compositeur, un artiste peintre… c’est un créateur qui apporte une richesse nouvelle à nos jardins et contribue à notre plaisir. J’avais une grande estime pour le personnage peu bavard et pour l’obtenteur qui possédait du génie. En lisant les pages que lui consacre Sylvain Ruault, je me demande comment il a pu faire preuve d’autant de patience avec moi, m’accueillant et m’autorisant même à jouer à l’hybrideur hasardeux, ne possédant aucune connaissance m’autorisant à concevoir un croisement fructueux.
Lawrence n’est plus là pour nous enchanter, pour autant, il est impossible d’oublier sa merveilleuse contribution à l’univers des iris. Christine Cosi veille avec une admirable et très sincère gratitude sur sa collection, en lui réservant tout un espace dans sa pépinière. La poursuite des croisements va perpétuer son souvenir. Son génie si particulier, fait d’une très grande rigueur et subtile inventivité, assurera la pérennité de ses longues années de réflexion et de création.
|
|
|
Iris ‘Lawrence Ransom’ Obtention Christine Cosi, 2018, ‘Armagnac’x’Decadence’ |
Pour clore cet hommage et cette rétrospective sur l’oeuvre d’un authentique créateur, je ferais de nouveau appel à Sylvain Ruault : « La disparition prématurée de Lawrence Ransom a privé le monde des iris de l’un de ses membres les plus originaux. Anglais de naissance, français d’adoption, il a su marier les deux cultures ; imaginatif et perfectionniste, il nous a donné des fleurs parmi les plus belles qu’on puisse trouver[2] ». « Chaque printemps, Lawrence Ransom adresse à ses amis et clients sa lettre annuelle, qui est aussi son catalogue. Cela fait onze ans qu’ainsi il nous écrit, racontant sobrement les heurs et malheurs de son exploitation, et présentant à la vente ses propres obtentions et quelques autres variétés, notamment des iris remontants et des iris botaniques. Lawrence Ransom est un passionné. Rien ne l’intéresse que de créer de nouvelles variétés, d’entreprendre de nouvelles recherches avec des hybrides très particuliers. Pour « Iris & Bulbeuses », j’avais recueilli de lui une interview où il se livrait avec une sincérité touchante, décrivant son parcours atypique et expliquant pourquoi il ne recherchait ni la réussite commerciale, ni la course aux honneurs. Sa passion, hybrider les iris, suffit à nourrir son enthousiasme. Il y consacre toute sa vie, avec, comme il le dit lui-même, ‟beaucoup de travail, de patience… et d’optimisme”. Son bonheur, c’est de voir naître une nouvelle fleur. Il peut, pour cela passer une nuit à attendre l’éclosion d’un nouveau bouton[3]. » ♦
[1] Suite de l’article de Monsieur Sylvain Ruault, publié le 22 décembre 2017 sur son site Irisenligne, sous le titre « Audace et sensibilité » : « ‘Samsara’ (1996) (‘Caroline Penvenon’ X ‘Catalyst’) a retenu l’attention des juges du premier concours Franciris. Il y a obtenu le premier prix : une récompense parfaitement méritée pour ce joli jaune clair florifère et prolifique. ‘Desiris’ (1993) (‘Beverly Sills’ X ‘Soap Opera’) est l’exemple parfait d’un iris totalement réussi. Taille de la fleur, coloris, ondulations, frisures, tout est là en justes proportions. C’est pour une fleur comme celle-là qu’on regrette que la Médaille de Dykes ne soit pas accessible aux variétés non américaines. Jusqu’à la fin, le travail de Lawrence Ransom a été de cette qualité. Prenez ‘Chloé Ransom’ (2010), ce descendant de ‘Clause-Louis Gayrard’ a conservé le chic de son « père » et en adoucit encore le coloris. Et ‘Manon Anna’ (2015), qui fait partie de sa dernière sélection, maintient ses choix en matière de couleur et d’ondulations. Je vois dans ces iris les qualités que j’ai appréciées précédemment chez Joë Gatty et que je découvre aujourd’hui dans les premières obtentions enregistrées d’une hybrideuse française, Bénédicte Habert (plus connue sous le pseudonyme de Lisa Héméra). Mais Lawrence Ransom ne s’est pas contenté de produire des grands iris magnifiques. Il a, plus encore, travaillé sur d’autres catégories d’iris barbus (MDB, SDB, MTB, IB), ce qu’il est le seul obtenteur français à avoir fait et, bien plus difficile, sur les arils, arilbreds et species issus d’oncocyclus et Regelias. Tout cela avec la même exigence de perfection. Pour ce travail exceptionnel, la BIS, dont il fut membre, s’honorerait de lui attribuer sa plus prestigieuse médaille, la « Foster Memorial Plaque » qui distingue les plus remarquables personnages de l’irisdom. Ses recherches dans le domaine des arilbreds nous valent aujourd’hui de pouvoir admirer ses obtentions issues de ‘Vera’, un cultivar brun-rouge et violacé issu d’un croisement de deux espèces du groupe des Regelias, I. korolkowii et I. stolonifera. À partir de 1996 et jusqu’à sa disparition Ransom a croisé et recroisé les descendants de ‘Vera’, avec des résultats qui devaient le combler. Depuis ‘Eastern Dusk’ (2010) jusqu’à ‘Refosco’ (2010) et ‘Sleazy’ (2012) il y a une dizaine de variétés qui réjouissent les amateurs de ces iris à la subtile beauté.
La disparition prématurée de Lawrence Ransom a privé le monde des iris de l’un de ses membres les plus originaux. Anglais de naissance, français d’adoption, il a su marier les deux cultures ; imaginatif et perfectionniste, il nous a donné des fleurs parmi les plus belles qu’on puisse trouver. »
[2] Ibid., dernier § de la note 1.
[3] Sylvain Ruault, Irisenligne, « Lettre d’un passionné », 24 mai 2002.
Mercredi 15, jeudi 16 juillet 2020
Un 14 juillet républicain et populaire
Trois averses, non déclarées en douanes du ciel, vinrent jeter un froid sur l’ambitieux projet d’un marché gourmand sur la grande place du village de Manzac sur Vern, mardi avant 19h00.
Je craignais d’avoir à m’asseoir pour dîner en public en ces temps de récidive de la Covid 19.
 |
||
Dès mon arrivée, j’observais un grand nombre de véhicules jusque sur le parking saturé du garage Virol, où je logeais le mien dans un petit recoin proche de l’entrée de l’église.
J’avais proposé à Claire de faire des photos… Je n’en ferais seulement que 150 !
 |
||
| L’organisatrice, Claire Vertongen | ||
 |
||
| Affluence et chaude ambiance | ||
Le public arrivait nettement plus dense que pour les marchés habituels du mardi, et ce fut la marée haute entre 19h30 et 20h00. Première surprise ! Aussitôt suivie par l’heureux constat de la rigueur de l’organisation, le nombre de commerçants, dont deux m’étaient inconnus. La foule se densifiant, les tables trouvèrent toutes des convives. Commencèrent alors, aussitôt, à se constituer des queues devant les stands où l’on trouvait, selon ses goûts, de quoi se sustenter généreusement et savoureusement. Le stand de Gérard Pouyade, déclinaison de viandes de canards et ses frites fut pris d’assaut deux heures durant. Rouge écarlate, j’eus peur qu’il nous fasse une apoplexie.
 |
 |
|||
| Y’a d’là joie ! | Siège du stand de Gérard Pouyade | |||
Les grillades de viandes de la ferme de Josette, soutenue par son époux, eurent leur indéniable succès. Les tartines de fromages d’Issigeac, les plats cuisinés et les pâtisseries du Maghreb de « Vergt pas cher », ceux de Magali et de son époux, eurent tous leurs fans. La boulangère de Coursac ne resta pas les bras croisés, alors que les jus de légumes, herbes et fruits du Jardin d’Hivers épuisèrent leur centrifugeuse professionnelle heureusement relayée par sa sœur, le temps qu’elle puisse refroidir ! Les fruits rouges de Corinne enfin venue rejoindre son époux firent des heureux pour le dessert. Et notre ami Matthieu Prouillac fit la joie des amateurs de ses excellentes bières qui lui valent une renommée croissante.
 |
 |
||
| Matthieu Prouillac, La Plume et l’épi | Marie & Jordan, les dégustateurs | ||
Simone a été sommée de réaliser des masques avec fermeture éclair afin d’autoriser à manger et à boire en toute sécurité !
 |
||
| Delphine Labails et ses amies | ||
Delphine Labails, nouvelle maire de Périgueux, avait rejoint, le maire de Manzac, Yannick Rolland et leurs amis, ce qui m’autorisa à lui adresser quelques mots sous les saules au bord du ruisseau. En comparaison avec Audi, le rageur, quel charme !
J’y retrouvais bien des connaissances, bien que n’étant pas de Manzac : Gisèle Chastanet, première adjointe, Claire Vertongen, Jérôme Limoges qui avait trouvé la panne de ma veille Mercedes sable, la famille Bonnet, Claire et Alain Bacou, Fabiola et son mari animateurs de l’Hôtel Restaurant étoilé du Lion d’Or, bien entendu les commerçants habituels du marché et le camarade Matthieu Prouillac… Mais regrettablement pas Brigitte Jeannin incidemment mordue avant 19h00 par un chien, ni Lucette qui nous ramènera sa maman et ses petits-fils, la semaine prochaine ! Je fis la connaissance de Daniel Hivers, l’heureux papa de notre maraîcher préféré, David, qui était venu avec sa princesse, Airelle, qui le seconda très efficacement.
 |
 |
||
| David et Daniel Hivers | Airelle & David | ||
L’orchestre rock/jazz, sa chanteuse, assurèrent l’ambiance populaire des jours de fête. Quelques uns cependant se laissèrent aller à danser malgré les restrictions. Daniel ne résista pas à danser un rock endiablé avec Magali qui ne demandait que çà ! D’autres encore… Mais je resterai discret !
 |
||
| Big Band des Potes | ||
Un visiteur un peu chagrin m’écrivait au lendemain de cette joyeuse fête populaire : « Chaque fois que je suis venu à une soirée manzacoise, je ne voyais que ‟ripailles” et ‟balluche”. Ne pensez-vous pas qu’il serait temps (vous qui, m’avez dit aimer la musique classique) d’élargir le champ de vision et d’écoute des manzacois ? Il ne s’agit pas pour moi, de violenter le monde culturel de la campagne, mais de le faire évoluer… »
Cette observation est loin d’être ridicule, cependant, je lui ai fait cette réponse sans doute un peu déroutante : « Je dois admettre que j’étais et reste d’une certaine façon très élitiste, vivant non pas dans une maison, mais dans une médiathèque, ce que l’on peut vouloir me reprocher. De par mon activité professionnelle, la confrontation avec de rares personnes qui étaient des exemples, je me suis rapproché de ce que je suis, un simple petit-fils de paysan, même pas capable de l’être moi-même ! J’aime cette simplicité cordiale, fraternelle, je passe de merveilleux moments avec ces gens qui valent tellement plus que moi. Ils m’enseignent l’humilité, l’art de vivre en toute simplicité et m’évitent de me hisser au-dessus de ce que je suis, pour tomber de haut, au jour ultime, dans la fosse. Tout ce que je propose qui relèverait dit-on le niveau d’intérêt culturel, n’a eut que très rarement d’écho. Alors, je regarde ce que peuvent m’apporter ceux qui n’ont pas fouillé les guides de l’élite intellectuelle et culturelle qui parfois n’a pas la richesse d’un regard fraternel et une franche poignée de main.
 |
 |
|||
| Être Heureux à Beauregard et Bassac | Monsieur le Maire et l’Attaché parlementaire | |||
Il m’incombe d’apprendre et non d’enseigner. Il me faut retrouver ce regard qui ressemble à celui de l’enfant, capable de m’offrir, à un âge avancé maintenant, une fraîcheur inespérée. Lorsque je m’assois avec ce cantonnier trentenaire de Beauregard et Bassac, Jean-Baptiste, possédant Bac plus 5 années en Science Politique, qui fut Attaché parlementaire en région parisienne, mais a choisi de partager sa vie avec une jeune femme qui l’adore, d’être papa d’un bébé qui vit dans un nid d’amour, j’apprends des choses essentielles. Et ce cantonnier – tel que le fut, sur Coulounieix, il y a bien des années, mon adorable grand-père – hyper diplômé, brillant et joyeux, distille tout l’or du monde. J’ai fréquenté aux Rolphies du beau monde, des habillés de l’éclat des réussites sociales et des titres… Or, mes jardiniers m’apprennent plus qu’aucun d’eux. Si on observe Jordan Laferté – qui viendra travailler la semaine prochaine –, arborant en permanence un superbe sourire, on s’interroge. Les temps présents sont assez maussades pour réussir à entraver l’expression d’un regard lumineux. Sa ravissante compagne, Marie (Monnereau, sosie de Marilyne Monroe) presque aussi blonde que lui, m’explique : « Jordan est heureux de son choix de vie, de son travail »… Sans doute aussi de la tendresse qui les unit ! »
 |
 |
|||
| Merci à la Relève ! | Merci Claire et Yannick | |||
Fin 2008, je terminais vingt années de contrôle des demandeurs d’emploi indemnisés. Ma réflexion et mon investissement essentiels furent d’inviter les jeunes, non pas à se suffire de petits boulots successifs, se laissant abuser par le système, mais de rechercher ce qui leur plaisait vraiment, ce qu’ils aimeraient faire de leur vie professionnelle et ensuite s’investir pour réaliser leurs objectifs qui doivent être liés à de nouveaux choix de vie. L’économie mondiale impose des transformations brutales, privatives d’emploi pérennes pour tous, sauf à privilégier la précarité par des emplois dévalorisants où l’exploitation est bien souvent de mise. J’ai bien conscience aussi que la période des ‟Trente Glorieuses” que j’ai vécu, s’achève. L’exploitation éhontée des colonies, d’Asie, d’Outremer et d’Afrique si elle n’est pas vraiment forclose, n’est plus cette main mise prédatrice qui expropriait et condamnait à la pauvreté, souvent à la misère, des pays auxquels nous spoliions leurs richesses ce qui fit que même les classes modestes d’Europe ont profité de cette manne, injuste, criminelle, qui fut une sorte de mirage écœurant. Les nouvelles générations contestent à juste titre cette vision du monde et doivent trouver des alternatives sérieuses au système capitaliste pour tenter de construire un monde qui puisse être vivable, si toutefois, la survie de la planète l’autorise. Lors de ce 14 juillet, la veille à Bourrou, auparavant bien sûr, j’ai observé une jeunesse qui se démarque d’une société qui n’a plus de sens. Par la pertinence de leur choix, leur enthousiasme et leur vaillance, ils tracent des voies alternatives. J’observe cela aussi sur France 3 qui soutient l’idée qu’une autre société est possible, si des acteurs riches de projets innovants parviennent à les réaliser.
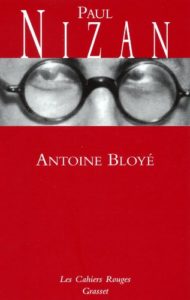 |
||
C’est un jeune inspecteur du travail, arrivé à 24 ans chez nous en 2004 qui m’a offert un extraordinaire roman biographique de Paul Nizan intitulé Antoine Bloyé, qui m’a permis de comprendre qu’en fréquentant ceux qui semblaient être l’élite, je finirais méprisé de tous. Une partie de cet ouvrage se passe à Périgueux, où la bourgeoisie de la ville méprisait totalement ce fils de petit cheminot devenu chef des Ateliers du Toulon, et qui poursuivit son ascension professionnelle aboutissant à une absolue solitude. Antoine Bloyé (nom sous lequel se dissimule l’identité du père de l’auteur, Pierre Nizan) avait débuté comme ajusteur à la Compagnie d’Orléans ; il gravit tous les échelons jusqu’à occuper celui d’ingénieur. « Tous les mouvements concertés de l’industrie et des fleuves, des voies ferrées et des grandes lignes maritimes achevaient d’arracher Antoine au sillon terrien où il avait germé, et d’où il avait été ébranlé avant l’âge. Il se sentait pauvre, il connaissait de bonne heure cette ambition douloureuse des fils d’ouvriers qui voient s’entrouvrir devant eux les portes d’une nouvelle vie. Comment se refuseraient-ils à abandonner le monde sans joie où leurs pères n’ont pas eu leur content de respiration, de nourriture, le content de leur loisir, de leurs amours, de leur sécurité ? Le malheur, c’est qu’ils oublieront ce monde promptement et se feront les ennemis de leurs pères[1]… »
La grande aventure de l’existence, c’est de trouver là où on est bien.
Sylvain Tesson
Alors, s’il y a tant de ressources en nous quand nous n’avons plus rien,
de quoi ne serons-nous pas capables quand nous avons quelque chose ?
Jean Giono, Les vraies richesses
[1] Paul NIZAN, Antoine Bloyé, Paris, Les Cahiers Rouges, Bernard Grasset, 2008, p. 64.
1er & 2 juillet 2020
La ronde des jours
Hier, mardi 30 juin, c’était le troisième marché auquel je participais, organisé à Manzac-sur-Vern, depuis le déconfinement. Ce marché mise plus, aujourd’hui, sur les manzacois que sur le passage de l’axe routier entre Saint-Astier, Périgueux et les territoires au-delà de Manzac, entre 17h00 et 19h00. Le nouveau maire Yannick Rolland et le Conseil municipal sont convaincus, contrairement au précédent, de l’intérêt de ce marché de fin de journée. Leurs présences et participations systématiques lui donnent une impulsion évidente. La très charmante Lucette n’a pas eu cette chance. C’est désormais Claire Vertongen, ma presque voisine, qui assure son intendance avec une heureuse efficacité. Elle allie détermination, charme, disponibilité, trouvant de nouveaux exposants, semaines après semaines.
 |
 |
|||
| Isabelle Tavarès | Au temps d’Isabelle, confitures à l’ancienne | |||
Pour la seconde fois, Isabelle Tavarès de Saint-Astier, sous l’enseigne « Au temps d’Isabelle » nous propose ses confitures à l’ancienne, cuites de longues heures en chaudron de cuivre (quelle patience !), réalisées avec une majorité de fruits, plantes et aromates. La confiture de cerises est préparée avec 73 % de fruits, parfumée avec parcimonie aux cinq baies (3 poivres : noir, blanc et vert, coriandre, baies roses, piment de la Jamaïque). On voudra goûter, entre autres, la confiture de fraise-chocolat noir, pour savoir si elle est aussi savoureuse que celle que nous eûmes le privilège de déguster chez Annie Bailargeau, Couette et potager d’antan, à Pouffonds dans les Deux-Sèvres, village situé à proximité de Melle et de son ‟Chemin de la découverte”. Chemin que nous visitions, il y a bien des années, avec La Société botanique du Périgord. Immense rencontre que celle de Jean Bellot, qui fut longuement son maire, charcutier et botaniste. De grands et merveilleux souvenirs. Marie Annick me dit, ce dont il me semblait avoir le souvenir, que la confiture d’Annie Bailargeau était un miraculeux mélange de chocolat noir et de framboise et non de fraise !
 |
 |
 |
||
| Lothar et ses vins de Bergerac | Josette et son camion avec Claire Vertongen | David Hivers, le maraîcher bio | ||
Lothar avec sa cave d’Obelix est de retour après des ennuis de véhicule, puis de santé. C’est à Neuvic que je le revis et Claire Vertongen le conviât tout aussitôt, selon ses vœux à nous rejoindre. Les fidèles de toujours, Josette et son camion richement pourvu, David et ses légumes bios avec des tomates approchant le kilo. On se lance du coup dans les farcis en début de saison.
 |
 |
||
| Bruno Corré de Grignols | Les produits de la ruche | ||
En l’absence de l’Happycultrice, Claire Lamargot, se préparant pour un heureux événement, les miels et produits de la ruche sont représentés par Emmanuelle Vacher ou son compagnon, Bruno Corré, que je voyais sur le marché de Saint-Astier, non loin de Françoise David-Testut et dans la rue où la jolie Marjolaine déploie son étal. Ils sont apiculteurs récoltants à Grignols. Ce village qui possède une Cagette gérée par notre excellent camarade Matthieu Prouillac.
 |
| Gérard Pouyade, La Ferme de Fontroubade |
Troisième semaine, pour Gérard Pouyade, ‟La Ferme de Fontroubade” sise à Manzac-sur-Vern qui propose toutes les déclinaisons de la viande de canard dont un des plus fabuleux foies gras du pays, dit Nicolas de ‟Fromages et terroirs”.
 |
 |
 |
||
| La collection de masques | Simone Rollet et sa magnifique collection |
Le masque du nouveau maire Yannick Rolland |
||
Madame Simone Rollet, couturière, propose un vaste choix de masques pour femmes, hommes et enfants. Ce n’est presque plus une protection, mais le dernier chic, la nouvelle mode des années 20. Le mien arbore la croix occitane et celui de Monsieur le Maire, les couleurs de la République !
Pour la seconde fois, un stand iconoclaste propose un large éventail de fruits, mais aussi des bouées, ballons et articles de plage dispensant sur cette vaste place un air de grandes vacances, tout en connaissant un réel succès auprès des visiteurs !
 |
 |
|
| Les fruits & articles de plages | Si vous aimez les olives et l’apéritif | |
Dernière arrivée, la marchande d’olives variées, Marjorie, se trouve à proximité de Lothar, inspirant une idée nettement apéritive, lorsque approche les 19h00 ! Et d’autant que le boulodrome – qui longe le ruisseau des Chabannes parfois débordant d’enthousiasme – vient d’être refait à neuf…
Claire va chercher à Coursac des baguettes bios qu’elle confie à la belle Isabelle (la belle confiturière), et ainsi chacun peut repartir avec tout ce qu’il faut pour dîner idéalement. Pour ma part, ayant longuement fui le pain pour des questions digestives, j’ai repris l’habitude d’en consommer avec Laura sur le marché de Saint-Astier ou à Neuvic le samedi matin, vendu par Alaric. Il y a aussi le pain de Clément et Manon de Beleymas que Fabrice nous procurait autrefois… Alors nous avions le bonheur de voir furtivement venir livrer son pain, la plus jolie boulangère au monde. On les retrouve l’un ou l’autre, le samedi matin, sur le marché de Mussidan. Il y a aussi la Vie Claire à Chancelade avec d’excellents pains moulés, mais encore un paysan boulanger, l’excellence même, David Dupuy, qui lui vend ses pains sur le marché de Sainte-Alvère et à Bourrou le lundi soir à 18h30, sous condition de pré commande… Je vais tenter d’y faire un tour lundi prochain !
On ne peut qu’admirer l’intendance de Claire qui accueille et doit gérer défaillances, petites jalousies… mais qui sait y remédier avec classe, élégance, fermeté. Le marché a trouvé sa reine ! Nous n’oublions cependant pas la jolie Princesse Lucette à qui nous devons cette initiative et ce lieu de convivialité, au cœur de nos campagnes.
 |
 |
|
|
Claire Vertongen, troisième adjointe Commission vie associative et action culturelle. |
Lucette Rabut fondatrice du marché | |
Dimanche, alors que je m’entretenais au téléphone avec Marie Annick, j’eu l’heureuse surprise d’apercevoir devant la porte deux de mes cousines, Annick Rivière et Pierrette Martinet. Évidemment, les bras chargés de cadeaux comestibles exceptés pour les plans de Gaura, une vivace étoilée et gracieuse, absolument magnifique. Pour ne rien laisser perdre de cette récolte de saison, il me fallut partager avec Sophie et Jérémy, mes jeunes voisins, qui en furent ravis. C’est toujours un plaisir de retrouver mes si dynamiques cousines du côté de ma mère et de ma grand-mère Clotilde, elle-même née Rivière. Pourtant bien que née Rivière, elle ne fut pas pour Jean Léopold Lamaud, mon adorable grand-père, un long fleuve tranquille. Les anecdotes savoureuses abondent ! Nous avons passé un long moment fraternel et chaleureux, ce qui n’est pas de trop en un temps où mon environnement s’effrite et où les rapports sociaux sont nettement amenuisés, en raison de la pandémie. C’était une bonne idée de venir me surprendre ; la solitude qui s’imposait depuis tant de mois fomentant une insidieuse inquiétude. Pierrette, qui a quatre sœurs, a beaucoup plus d’affinités avec sa belle-sœur qui en retour en a mille fois plus avec elle qu’avec sa propre sœur. Les affinités ne sont pas forcément réservées aux liens du sang. L’important est de trouver des résonances chez quelques personnes autorisant la confiance et d’heureux moments de partage, ce qui est le cas pour moi avec Annick comme avec Pierrette et Jacky, un trio de cousines en or !
 |
| La Gaura, pleine de charme |
Facebook offre parfois des rencontres insolites, imprévisibles, qui sinon n’auraient jamais existées. C’est manifestement le cas pour moi avec Laurent Bessiere et ses réflexions sur le cours de la vie comme sa passion pour la photographie en milieu naturel, de l’éphémère beauté des choses, que ce soient fleurs, insectes, en particulier les abeilles sont un terrain de concordance qui insuffle l’espoir en la vie. Une vraie poésie transparaît derrière tout ce qu’il observe avec minutie, car il possède le don de capter le fragile instant qui transfigure ce monde hideux qui trop souvent nous opprime, nous emprisonne. La beauté existe, il faut aller à sa rencontre et savoir la saisir, la pérenniser pour le bonheur des regards moins investigateurs ou attentifs.
 |
 |
|
| Laurent Bessière©photographe | Laurent Bessière©photographe | |
Avec Pierre-Yves Besse, Facebook ne fait que confirmer une relation de jeunesse, perdue longuement et retrouvée à l’orée de la vieillesse. Tout récemment, il éveillait ma curiosité en invoquant un écrivain qui m’était totalement inconnu, René Frégni. Mon insatiable curiosité, qui n’ignore pas que Pierre-Yves est particulièrement doué pour l’écriture, m’engage alors dans des recherches qui me laissent sidérées. Comment ai-je pu ignorer un talent aussi patent de l’écriture, orfèvre du verbe comme le furent Léon-Paul Fargue, Paul Morand, Julien Gracq, et aujourd’hui, avec une absolue rigueur, Pierre Bergougnioux… L’action de René Frégni auprès des prisonniers est inaccoutumée ‒ peut-être notre chère Annie Delpérier s’en était-elle inspirée pour ses interventions à la prison de Mauzac. Ému, de lire ce qu’il leur proposait en lieu et place des armes, de la violence : « …Prendre un stylo, c’est comme prendre un bateau, c’est le début d’un grand voyage[1]. »
J’en sais un peu quelque chose de ce grand voyage immobile, mais s’ouvrant sur l’immensité de l’univers. Nous reparlerons de René Frégni et de ses nombreux ouvrages empreints de tant de poésie, de sensations, de frémissements.
« Si l’amour cessait d’exister du jour au lendemain notre planète s’éteindrait.
L’amour, toutes les folies de l’amour, rien que l’amour,
le reste n’est qu’inutile poussière de vanité.[2] »
[1] René FRÉGNI, (2017-05-31T23:58:59). Le chat qui tombe (Regards croisés) (French Edition). Aube (De l’). Édition du Kindle.
[2] René FRÉGNI, Elle danse dans le noir (French Edition) (p. 14). Editions Gallimard. Édition du Kindle.
JUIN 2020
Samedi 20 juin 2020
Et puis vint un sourire
Sous le soleil du matin, un grand bonheur se balance dans l’espace.[1]
Albert Camus, Noces.
Depuis le mercredi 15 avril nous est proposée sur les antennes de France Télévisions, une miniature littéraire intitulée ‟La p’tite librairie”. Une des récentes diffusions était consacrée à la publication en Folio de Noces (1958) et L’été (1954) d’Albert Camus. L’enthousiasme de François Busnel m’invita à y goûter. Je viens de terminer la lecture de ‟Noces à Tipasa”, premier chapitre de Noces qui en comprend quatre. Il y a en ces lignes une jubilation qui m’a fait songer à celle que j’éprouvais lors de ma découverte dans les années 90 du Colosse de Maroussi d’Henry Miller et, à la fin des années 70, de Feuilles d’herbe de Walt Whitman. On ressent à la lecture de ces pages une exaltation des sens et en définitive une adéquation avec le monde environnant, une quasi fusion avec l’univers. Sensation qui ne devrait jamais nous quitter. Elle est conforme à notre place dans le cosmos, et c’est plus que souvent que nous l’oublions. Les civilisations et ethnies qui vivent en harmonie avec la nature sont toujours plus épanouies que la nôtre qui est en rupture avec notre milieu naturel. On note la joie des enfants, des adultes après le long confinement de ce printemps, de se retrouver à la campagne au milieu des animaux, de la végétation. La séparation fallacieuse qu’ont autorisée les villes, les cités, sont une totale aberration, mais qui sert l’industrie, le commerce et le capital, elle s’affirme telle une nouvelle aliénation qui nous met en rupture avec ce qui nous est vital, avec pour objectif de servir des intérêts privés.
 |
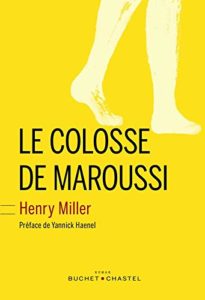 |
 |
|||
Ce premier jour de l’été 2020 ressemble à ce que furent les autres jours en amont de cette pandémie paralysante en ses conséquences et la peur qu’elle suscite. C’est par ailleurs le 201ème anniversaire de la naissance de Jacques Offenbach, romantique, mais qui avait le talent de faire surgir subrepticement la joie, la gaîté !
Première visite de longue durée aux Rolphies de l’année 2020 ! J’ai de l’espace, un contact permanent avec la nature, mais ne voir personne est assez frustrant. Ma charmante cousine Jacky est venue de Brantôme de bon matin, passer un long moment avec moi.
Vers 8h20 nous étions sur le marché de Neuvic où je mis injustement le pauvre Nicolas à l’épreuve avec la note de la semaine passée, qui réunissait sur une seule ligne deux de mes achats (un saucisson et un fromage de chèvre). Ses fromages qu’il va quérir chez les producteurs dans les Alpes sont une vraie merveille de goût et de saveur. Ils sont de toute évidence, avec sa compagne, passionnés par cette activité. On retrouve leur stand au Bugue le mardi matin où Nicolas rencontre Josette, à Périgueux le mercredi sur la place de la Clautre devant la cathédrale Saint-Front, à Saint-Astier le jeudi matin le long de la halle et le samedi matin à Neuvic sur le côté de l’église. Je ne connais pas la vendeuse, mais on doit attribuer la mention « tout sourire » au vendeur, qui n’a pas raté sa vocation !
 |
||
À ses côtés le stand poisson où j’avais découvert la semaine précédente une succulente brandade de morue, comme celles que confectionnaient ma mère ou ma grand-mère Rosalie. Nous en prenons pour notre repas de midi. Et comme la semaine précédente, des moules ! En s’avançant sur la place centrale face au café du village je rencontre Lothar et sa Cave d’Obélix que nous n’avions plus vu depuis des mois à Manzac et qui souhaite y revenir ! Toujours joyeux malgré de sérieux soucis de santé, Obélix reviendra vendre ses vins, y compris bios, sur la place de Manzac. Il y a là aussi sur un large étal le couple Plaçot et les merveilleux bouquets de madame Plaçot, face à celui de François Roussel, né en 1947, qui tente de sauver ses fesses comme maire « à vie » de Neuvic ! L’affluence n’y est pas… malgré le café offert ; le vide devant les tréteaux fait injure à l’effervescence de ses « groupies » venues d’une longue marche entreprise au siècle passé !
Puis c’est un autre fromager muni de meules géantes à des prix tout aussi gigantesques : 4,99 € les 100 gr, voire davantage. Lorsqu’il m’interroge, achevant une transaction dévastatrice avec une jolie cliente, je lui déclare : « Je n’achète jamais un fromage dont le prix est inférieur à mille euros le kilo ». Il a pu penser, sans d’ailleurs faire erreur, que je me foutais de lui ! C’est une honte, si on confronte ces prix à ceux des meilleurs fromages disponibles sur le stand de Nicolas, qui n’excèdent jamais 38 € du kilo.
Un passage rapide au stand d’Alaric pour y prendre un pain aux graines et des courgettes en coloris variés afin d’étrenner un de mes nouveaux sacs alimentaires en maille, espérant ainsi pouvoir renoncer aux poches papier dont je suis un impressionnant receleur.
Notre marche dans la fraîcheur matinale fut fort agréable, même si selon mes habitudes je monologue souvent ! Nous longeons d’abord le vaste parc du Caviar de Neuvic, dont je n’achète pas les productions réservées aux prolétaires (de 69,00 € à 128,00 € la boite de 30 gr). On peut préférer, je le concède, la boite de « Caviar Osciètre Réserve » de 500gr pour 2100,00 € ! Les SDF feront, par mesure de restriction, l’acquisition des Oeufs de saumon (caviar rouge) pour 9,50 € la boite de 50 gr ou les Oeufs de saumon de fontaine, jaunes, pour 9,90 €. Les œufs noirs sont nettement plus prisés, un peu comme les tableaux de Pierre Soulages, dont j’ignore cependant le prix au mètre carré !
Et c’est déjà le charmant petit pont qui enjambe le Vern qui se jette dans les bras de l’Isle.
Deux pêcheurs et demi (il y avait un enfant de 7 ans environ qui pêchait avec deux adultes) patientent, leurs lignes en main. Je leur déclare : « vous faites mentir Victor Hugo qui disait que les hommes chassaient et les femmes pêchaient ! ». Comme ils avaient de l’humour, ils ne m’ont pas donné à manger aux silures gargantuesques qui sillonnent nos rivières !
 |
||
Nous apercevons les tours du château de Mauriac[2] sur notre droite. À gauche s’élève un beau séchoir à tabac qui n’aura guère servi, des allées de grands peupliers qui ombragent un lieu équipé de tables et de bancs propices aux pique-niques. Nous apprenons sur des panneaux que ce château appartenait à la famille Dumoncel[3], père et fils.
Après avoir traversé sur une écluse refermée d’une section de canal qui autorisait, autrefois, la navigation partout où il y avait des barrages – celui-ci est particulièrement conséquent –, comme Victor Hugo, après Napoléon 1er, nous nous exilons sur une petite île où les bambous exigent de l’acharnement pour que soit libéré un peu d’espace !
De retour à la maison, après une course éclair et un petit tour dans Saint-Astier, nous nous installons au jardin pour un repas d’une grande simplicité, dans la bonne humeur et cette grâce propre à Jacky qui est une cousine d’excellente compagnie. Voici le premier repas au jardin de l’année 2020 ! Les années se sont effacées durant cet espace de calme et de convivialité, nous autorisant à oublier tous les désagréments des mois précédents.
Les peurs incessantes, malfaisantes, nous immobilisent, nous carencent et nous empêchent de vivre pleinement. La recherche de sécurité nous amène à choisir le mode ‟survie”, qui déjà se conjugue comme une petite mort ; pourquoi alors avoir tellement peur de la mort si nous la pratiquons quotidiennement comme moyen d’existence ?
Mais aujourd’hui l’imbécile est roi, et j’appelle imbécile celui qui a peur de jouir.
[…] Il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre. Il y a aussi un temps pour créer, ce qui est moins naturel.[4]
[1] Albert CAMUS, Œuvres, Noces, ‟Noces à Tipasa”, Paris, Quarto Gallimard, p. 143.
[2] Le château de Mauriac s’élève à deux kilomètres du bourg de Douzillac. Il est sur le territoire de cette commune. Il surplombe la ligne de chemin de fer Bordeaux-Périgueux-Tulle et la rivière l’Isle, se trouve à l’aplomb du barrage de Mauriac qui, après avoir actionné un moulin a fourni son énergie à une manufacture de meubles transformée maintenant en une petite centrale hydro-électrique. C’est une propriété privée où est autorisée la visite des jardins et de la terrasse. Bâti aux XVe et XVIe siècles, il succède à un repaire médiéval, lui-même établi à l’emplacement d’une ancienne demeure gallo-romaine. De retour d’Italie, Montaigne fit halte au château en 1581. Il est inscrit au titre des monuments historiques – d’après Wikipédia.
[3] Maurice DUMONCEL (1919-2013) était le fils de Rémy DUMONCEL né en 1888, Résistant, mort en déportation en 1945, Juste parmi les Nations, qui avait épousé Germaine Tallandier, fille de Jules Tallandier fondateur des éditions du même nom, dont il fut le directeur littéraire. En 1963, son fils Maurice Dumoncel épouse Constance de Toulouse-Lautrec-Montfa (1934-2017) fille de Mapie de Toulouse-Lautrec, petite-nièce du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Après une licence de lettres et un diplôme à l’École libre des sciences politiques de Paris, Maurice Dumoncel entre au ministère des Affaires étrangères en tant que chargé de mission (1944-48) avant de rejoindre les Éditions Tallandier, entreprise familiale fondée par son grand-père maternel, Jules Tallandier. Il aura chez Tallandier l’une des plus belles carrières de l’édition française en tant qu’éditeur et directeur littéraire (1945) gérant-directeur général (1959-69) et président-directeur général (1969-81) faisant de la société l’un des éditeurs nationaux les plus renommés dans le domaine historique. Dès 1946, il relance la publication d’Historia dont la parution fut interrompue pendant la seconde guerre mondiale, revue qui devient le leader de la presse historique française. Au fil des décennies, Maurice Dumoncel crée de nombreuses collections à succès de livres et de magazines historiques, éditant les œuvres de son ami René de La croix de Castries, dit le duc de Castries, d’Alain Decaux, d’André Castelot ou les séries en fascicules illustrés Le Journal de la France, La Seconde guerre mondiale, Les Années 40, La Guerre d’Algérie, L’Encyclopédie des fleurs et des jardins. Après son départ en 1981, Tallandier amorce un déclin. Mais parallèlement aux Éditions Tallandier qu’il dirige pendant près de 40 ans, Maurice Dumoncel occupe les postes d’administrateur et directeur littéraire de la Société d’éditions, publications et industries annexes (1945-50), d’administrateur du Conservatoire américain de Fontainebleau (1949-96) de la Société européenne d’éditions familiales (1952-64) de la SA Femmes d’aujourd’hui à Bruxelles (1954-76), des éditions Plon (1958-64), des éditions Grasset (1961-65), de directeur général (1961-65) et administrateur (1980-96) des éditions Fayard, de président de l’Office international de documentation et librairie (1977-93) et d’administrateur des éditions Belles Lettres (1980-90). Figure emblématique de l’édition française, proche des familles Hachette et Gallimard, Maurice Dumoncel conserve la présidence d’honneur des Éditions Tallandier jusqu’à son décès, survenu en décembre 2013, à l’âge de 94 ans. – D’après Wikipédia.
[4] Albert CAMUS, Œuvres, Noces, ‟Noces à Tipasa”, Paris, Quarto Gallimard, p. 144-145.
Jeudi 18 juin 2020
Les jours maussades et leurs éclaircies
Cette zone d’ombre sur nos vies.
Toutes les vies[1].
Albert Camus, Carnets III
Avons-nous un dieu étourdi ou liquéfié devant la folie du monde ?
Les jours se suivent et s’écoulent dans une parfaite morosité : fraîcheur et averses diluviennes enchantent nos jours qui s’égrènent tel un chapelet malfaisant.
Lancerons-nous un appel, celui du retour à la raison, des jours printaniers et du soleil ?
Où sont les beaux jours du Mélia Azedarach[2] à la suave floraison couleur et parfum lilas ?
Jean Chalon passe ses étés rituellement en Espagne, à l’intérieur des terres, non loin de la côte est. Dans les toutes dernières pages de son dernier journal publié, intitulé Journal d’un ours, 2008 à 2011 (Éditions du Tourneciel, collection Le Chant du merle), à la date du lundi 22 août 2011, il note : « Petite promenade à Rascana dans les vergers à l’abandon. Puis nous allons à Valencia rencontrer une religieuse, une sainte, Maria Teresa Unzu, 87 ans, resplendissante, elle a passé 58 ans en Inde au service des pauvres. Elle donne à manger à ceux qui ont faim. Cet homme qui porte une croix et qui tombe à chaque pas, ce n’est pas le Christ. Cet homme qui porte sa croix et qui tombe à chaque pas, cet homme, c’est toi, c’est moi[3]. »
Hier, mercredi 16 juin c’était l’anniversaire de mon jeune compagnon missionnaire, Randall K. Bennett, né en 1955, dont je ne cache pas que c’est un absolu chrétien, un être pur, limpide, lumineux et qui n’est que bonté, un apôtre moderne, tel qu’on peut le concevoir. Voici sa réponse à mes vœux : « Cher Alain, Merci pour les voeux d’anniversaire aimables et généreux ! Shelley et moi, nous espérons en famille et prions pour que vous soyez en sécurité, en bonne santé et heureux en cette période de coronavirus difficile dans le monde. Nous avons prié pour tout le monde en France et nous prions pour vous spécifiquement chaque jour en couple. Avec amour et admiration, Rand et Shelley et famille. » Nous voyons qu’un authentique saint des derniers jours, cela existe véritablement ! Et seuls ces êtres là sont susceptibles de me toucher. Quel immense privilège de l’avoir rencontré et de pouvoir reprendre le dialogue. Si un être nous inspire le respect, il sera écouté et entendu. Il faut pour cela être un exemple, ce qui est sans doute le plus difficile. Mais, en 1975, il était déjà l’être le plus fusionnel avec Dieu que j’ai connu. D’ailleurs Président Waite, comme Président Broschinsky n’ont jamais eu le moindre doute à son égard ; ils savaient que ce n’était pas un être ordinaire, et moi-même qui n’étais pas en bonne santé, j’en avais claire conscience. Si bien que son parcours exemplaire aujourd’hui dans l’Église n’est pas une surprise, mais une bénédiction… déjà celle d’avoir croisé sa route quelques mois durant.
 |
||
| Hydrangea © Laurent Bessiere | ||
Ces derniers jours la rubrique nécrologique m’apporta des nouvelles particulièrement attristantes, la disparition de Françoise Decroix, le 9 juin, fut suivie par celle de Joséphine, que nous appelâmes toujours Josette, de La Barbacana. La cérémonie d’inhumation de cette dernière eut lieu au moment où j’en fus informé, le 12 juin, à 14.00. Josette, ses parents, ses frères et sœurs furent nos voisins mitoyens, rue John Kennedy, à La Familiale de Chamiers. J’étais adolescent et nous venions de quitter la rue des Américains à La cité bel Air (Boulazac). Nos premiers voisins furent les membres de la famille Merry rapatriée d’Algérie dont l’éducation avait, me semble-t-il, quelques failles. La mère élevait seule ses enfants, certains étant assez turbulents. Il me reste un seul souvenir : celui du gros matou de Madame Lascaud – une autre de nos voisines, institutrice – chat chapardeur et intrépide, que j’ai vu un jour, vers midi, prestement sortir de chez Merry, ayant entre les dents un énorme beefsteak. Il fallut se suffire des frites et des cris de la mère justement horrifiée par ce forfait.
 |
||
|
|
||
|
Chamiers, La Familiale, accroupi avec le chien, Lucien, le plus grand à côté, son frère Jean-Luc de La Barbacana |
||
Un peu plus tard, c’est la famille de La Barbacana, elle aussi rapatriée d’Algérie, qui vint s’installer dans cette maison. Il y avait un fils aîné, Michel, qui habitait à Nice, Jacqueline qui se maria très vite et partit aux Jalots sur Trélissac devenant mère de deux enfants (Valérie et Bruno), puis Josette, Jean-luc et un petit dernier, Lucien qui était adorable. Les parents étaient vraiment sympathiques, chaleureux. Nous fûmes tout de suite à l’aise et en fraternité avec eux tous. Mon permis de conduire en poche, je me souviens avoir accompagné à deux reprises le papa à Biarritz dans sa famille, dans un quartier qui ne devait pas être trop éloigné de celui où vécut, dans les années 1921-1924, Igor Stravinsky et sa famille. J’adorais le choix des tuiles vernies jaune soleil, bleu océan, vertes… de cette ville.
Notre autre voyage, grande découverte pour moi, se fit à Toulouse où Monsieur de La Barbacana rendait visite à d’anciens voisins, fraternels, du temps de l’Algérie française. Il n’y eut jamais la moindre brouille entre nos deux familles et ce fut un plaisir que cette mitoyenneté ! Je revoyais Jean-Luc de temps à autre au bureau, c’est ainsi que lors de sa dernière visite il m’apprit le décès de son jeune frère, Lucien. J’étais bouleversé, incrédule.
Le 9 juin saluait la reprise du marché de Manzac, après l’élection d’une nouvelle équipe municipale. Je pressens que Manzac vient d’élire un maire qui va marquer ce village. Il est déterminé, actif et engagé. Á 32 ans, on a l’ambition de faire du bon travail et d’impulser des idées nouvelles. L’écologie est une dimension essentielle aujourd’hui, une dimension déterminante pour la survie de la planète et de ses habitants. Son équipe rapprochée est éminemment sympathique. Et voici Josette première à prendre place, toujours guillerette qui dit avoir très bien travaillé durant tout le confinement, Corinne en pleine expansion et ses myrtilles, David frisé comme un beatnik ou faisant songer au David de Michel-Ange à Florence ; on n’en était pas trop loin puisqu’il nous apportait ses conquêtes, une montagne de romaines ! La révélation fut la très charmante Claire qui va gérer l’animation culturelle de Manzac et le marché. La souriante Lucette n’a pas déserté pour autant. Vite, on retrouve tous les habitués et l’ambiance s’affirme joyeuse et bon enfant !
 |
||
Le mardi suivant, 16 juin, bien que non résident à Manzac, je bénéficie d’un paquet de graines « Des fleurs pour les abeilles » [www.flowersforbees.com] afin de réaliser une prairie fleurie. Je les sèmerai à la volée le mercredi matin profitant du régime d’averses pour les inviter à la germination ! La bonne humeur règne à nouveau, le maire et le Conseil municipal y participent. Notre ami anglais nous amène deux merveilles absolues, une petite fille et son frère, plus beaux que le jour ! J’y ferai l’achat d’un masque noir avec la croix occitane. L’étal est d’une variété et d’une richesse inattendues. Tout le monde y trouve son bonheur.
Le fait marquant sera l’arrivée de quatre cyclistes, deux jeunes filles et leurs compagnons qui partant de La Rochelle se rendent en Europe de l’Est. L’an passé ils avaient parcouru l’Amérique Centrale ! Une allure décontractée, quelque peu hippie, ce qui me rend ma jeunesse, bien que je n’ai participé à aucun des mouvements des années 70. L’un est du Québec, qui n’est pas encore français, malgré l’espérance Gaullienne. Quand Manzac devient l’étape d’une épopée moderne !
Lundi 28 novembre 2011. Date ultime du Journal d’un ours consacrée au rappel d’un texte ancien que Jean Chalon avait publié dans le Figaro Littéraire du 2 novembre 1963 sur sa grande amie Natalie Barney[4], l’Amazone et son Salon, auquel le Tout Paris littéraire et artistique participait. Elle fit cette déclaration au jeune Jean Chalon : « On prétend que je suis une source de souvenirs… Je crois que c’est vrai et que j’ai cédé une fois de plus à la tentation en écrivant pour le Mercure de France Traits et portraits. Mais c’est fini. Cela me gêne d’écrire sur ma propre vie. J’aime ma vie et mes écrits n’ont fait que l’accompagner. La plupart des gens écrivent parce qu’ils n’ont pas de vie et c’est aussi dangereux que l’alcool ou les drogues. Je n’aime pas les produits de remplacement. Et vous, jeune homme ? » ♦
[1] Albert Camus, Carnets III, « Cahier IX, juillet 1958 – décembre 1959 », 25 juillet 1958, Paris, Gallimard, collection Folio, 2013, p. 282
[2] Mélia Azedarach voir la note 1 de mon texte du 11 juin 2020, intitulé Françoise Decroix.
[3] Jean CHALON, Journal d’un ours, 2008-2011, La Vancelle, 2015, p 163.
[4] Natalie BARNEY dite Natalie Clifford Barney (1876-1972) est une femme de lettres américaine du XXe connue pour ses poésies, mémoires et épigrammes, une des dernières salonnières parisiennes. Ouvertement lesbienne, elle a cherché à faire de son salon littéraire une nouvelle Mytilène, une école de femmes poètes qui réponde à l’Académie française d’alors, strictement masculine. Pendant plus de soixante ans, le 20 de la rue Jacob a revivifié un monde littéraire et artistique féminin, à travers les nombreuses conquêtes amoureuses de son hôtesse, telles la courtisane Liane de Pougy, la mécène Élisabeth de Clermont-Tonnerre, la peintre Romaine Brooks, la romancière Colette – à qui elle inspira le personnage de Flossie dans Claudine s’en va (1903) –, mais aussi des intellectuel(le)s qui ont compté des deux côtés de l’Atlantique, tels Salomon Reinach ou Gertrude Stein, homosexuels ou non, mais favorables à la libération des mœurs et des arts. Par son indépendance d’esprit, sa liberté de mœurs, sa séduction, son goût pour les choses de l’esprit, elle a permis de donner, dans le Paris de la Belle Époque et de l’Entre-deux-guerres une bien plus grande visibilité aux lesbiennes. Cette maison sera, pendant près de soixante ans, le cadre de ses célèbres « vendredis », un des derniers salons littéraires influents. Viendront régulièrement Auguste Rodin, Rainer Maria Rilke, Colette, James Joyce, Pierre Louÿs, Paul Valéry, Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz, Anatole France, Robert de Montesquiou, Gertrud Stein, Somerset Maugham, T. S. Eliot, Isadora Duncan, Ezra Pound, Virgil Thomson, Jean Cocteau, Max Jacob, André Gide, Djuna Barnes, Georges Antheil, Nancy Cunard, Peggy Guggenheim, Marie Laurencin, Paul Claudel, Adrienne Monnier, Sylvia Beach, Scott et Zelda Fitzgerald, Emma Calvé, Sherwood Anderson, Hart Crane, Alan Seeger, Mary McCarthy, Truman Capote, Françoise Sagan, Marguerite Yourcenar…
Premier & 2 juin 2020
L’air du temps
Nous serons guéris si une bonne fois nous
nous écartons de la foule ; car la masse,
qui chérit ses propres maux, s’insurge contre la raison[1].
Sénèque, La Vie heureuse
L’air du temps en cette année 2020 est insolite, des plus incertains, malgré le « déconfinement » partiel du 11 mai dernier et celui plus large encore du 2 juin. La gestion du covid-19 fut particulièrement hasardeuse, riche en contradictions et incuries (masques, gel hydro-alcoolique, médicamentation (Chloroquine), tests, lits, respirateurs… ). Un gouvernement de parfaits amateurs et d’inconscients, mais très professionnels, lorsqu’il s’agit de mentir et de berner !
La popularité du personnel soignant a mis ces guignols sur la touche. Ils ont perdu tout respect de la population usée par leurs tergiversations, sauf aux yeux de quelques évaporées de la cervelle ! Être un Premier de Cordée a pris un tout autre sens – vision insultante – que le sens de celui brandi par Emmanuel Macron tel un étendard.
Je sortais très peu (tous les quinze jours pour les courses alimentaires) ; je poursuis avec quelques assouplissements ce principe d’économies de déplacements.
Pour autant j’ai repris les marches mais à proximité de la maison. Une fois les eaux stagnantes absorbées pour pourvoir passer sur le chemin qui rejoint la route Napoléon où la route de Montanceix.
Ma tentative de revenir pour la seconde fois sur le marché de Neuvic samedi dernier a été un fiasco, j’étais équipé au mieux, sauf muni d’argent pour payer mes achats. Du coup, immédiatement, j’ai reconverti cette absurdité dans une marche sur la première section de la voie verte de Neuvic à 8h30 du matin. Fraîcheur et légèreté de l’air. Je n’étais pas tout à fait seul, me croisèrent ou me dépassèrent quelques sportifs et cyclistes. Transformation d’un échec en succès, sans fierté excessive !
La kyrielle ininterrompue de décès depuis ce début d’année a de quoi sidérer. C’est une désertification douloureuse. Il y a ceux qui me touchent directement et puis cet effritement du monde artistique qui fut celui dans lequel nous avons vécu de si longues années. Comment ne pas éprouver de la tristesse avec les disparitions de Michel Piccoli (1925-2020), Guy Bedos (1934-2020), avec lequel on peut entendre que j’ai quelques affinités, les grandes voix du lyrique : Gabriel Bacquier (1924-2020), Suzy Delair (1917-2020) qui fut une exceptionnelle Metella dans La Vie Parisienne de Jean-Louis Barrault, Mady Mesplé (1931-2020), Janine Reiss (1921-2020). Cette dernière, directrice de chant ou vocal coach à l’Opéra de Paris de 1973 à 1980 mit tout son talent et sa dévotion à l’exigence du respect du texte. Elle fut la répétitrice des plus illustres et devint parfois même leur amie : Ruggero Raimondi, Maria Callas, Teresa Berganza, Mady Mesplé, Julia Migenes, Denise Duval, Placido Domingo, Luciano Pavarotti…
Il me faut évoquer Olivier. Nos relations n’ont pas été toujours parfaitement sereines, mais c’est une personnalité attachante, un explorateur de la vie, du monde – en détail –, avec passion. Au-delà d’être un jardinier comme il n’en existe que bien peu, comme tout possesseur de jardin aimerait en avoir pour gérer, embellir et porter à son meilleur ses cogitations pas toujours heureuses, parfois même ingérables. Sa philosophie de résilience permet de supporter la disparition des végétaux les plus admirés du jardin et d’accueillir des semis spontanés, parfois magnifiques comme un privilège et de nouvelles sources d’émerveillement. Le plan d’eau du jardin, petit mais enchanteur, est sa création et s’est édifié grâce à sa générosité, son ingéniosité.
Depuis vingt ans qu’il travaille ici, il a paysagé ce jardin qui était en train de se transformer en parc de manière confuse, difficilement gérable. Le résultat est sans doute bien différent des idées qui avaient présidé à son élaboration, mais attrayant et surtout enfin apte à une certaine pérennisation !
On pourrait parler de sa vaillance, de son efficacité redoutable et visionnaire en raison de sa connaissance du monde végétal, animal… mais encore de son courage indomptable. Sa présence ici aura été un des beaux cadeaux que m’aura fait la vie !
Vie que j’accuse, je le dis, assez souvent, de ne pas s’être montrée trop généreuse ou même équitable envers moi. Certains me démontreront le contraire, et peut-être, en effet, ai-je tort !
Il y a des gens que l’on apprécie, d’autres que l’on aime et encore d’autres que l’on aide tout en sachant que ce sera pour rien, presque rien. Tentation inutile et stérile. Seule l’enfance est propice à tenter d’orienter nos destins, ceux d’autrui. Après il est trop tard. Si on a soif on boira. Dans ce paysage, trouver l’âme soeur est particulièrement hasardeux, voire improbable et n’a plus le moindre sens pour moi. On rencontre pourtant des sympathies sur le bord du chemin… parfois elles se révèlent ombrageuses. C’est avec distance et bienveillance que l’on accompagne nos semblables qui comme nous-mêmes, avec le poids des ans, ont l’âme altérée par les souffrances et la solitude. Montesquieu n’écrivait-il pas : « Les hommes se regardent de trop près pour se voir tels qu’ils sont. Comme ils n’aperçoivent leurs vertus et leurs vices qu’au travers de l’amour-propre ; qui embellit tout, ils sont toujours d’eux-mêmes des témoins infidèles et des juges corrompus.[2] »
Mes 73 ans furent fêtés de manière encore plus dense encore que l’an passé. Plus de 100 messages auxquels il fallut, par délicatesse, répondre individuellement. C’est le principe même de Facebook où chaque jour on peut saluer l’anniversaire d’« amis » ce qu’il est rare que je ne fasse pas. Mais de très fidèles et attentifs amis, il n’en est que fort peu, la majorité vient quérir quelque chose que je ne suis pas certain d’offrir.
Dans une lettre du 13 mai 1918, le compositeur Camille Saint-Saëns s’exprimait sur sa trop grande franchise : « Quand on dit ce qu’on pense, on a vingt chances contre une de n’obtenir d’autre résultat que de se faire un ennemi ; mais cette chance unique de réussir crée pour moi un devoir auquel je ne manque jamais sans m’en dissimuler les inconvénients et sachant parfaitement le tort que je me fais à moi-même… En posant en principe que l’on doit toujours complimenter, la civilité puérile et honnête, règle mondaine universellement observée, crée d’incalculables ravages. Sans elle, on ne verrait pas pulluler un tas de médiocres qui se prennent pour des génies et encombrent inutilement les carrières. On ne verrait pas s’évertuer à être poètes, musiciens, peintres, des gens qui seraient beaucoup plus utiles dans les affaires, le commerce et l’industrie[3]… » ♦
[1] SÉNÈQUE, La Vie heureuse (La Petite Collection t. 282) (French Edition). Fayard/Mille et une nuits. Édition du Kindle.
[2] MONTESQUIEU, Éloge de la sincérité, Œuvres complètes, Paris, Aux Éditions du Seuil, 1964, p. 43.
[3] HÉNAUX, Michel, Saint-Saëns de A à Z : Le compositeur – L’homme – L’oeuvre (French Edition). Édition du Kindle.
MAI 2020
9, 11-12, 26 & 29 mai 2020
Sur les traces d’Henri Duparc ou la quête de l’absolu
La musique, la vraie musique – la seule –
est la musique d’âme et d’émotion :
l’art purement cérébral n’existe pas :
il est ce que vous appelez si joliment ‟inutile”.[1]
Henri Duparc
L’arrivée de Franck Besingrand aux Amis de la musique française ne me semble pas fortuite, ni anodine. Ses projets portent en eux des réponses à mes questionnements. Touché, interrogé, il m’appartient de découvrir ce qui se cache pour moi dans sa propre approche de musiciens comme Henri Duparc ou Louis Vierne, découvrir ce qui va avoir un écho profond en moi. Lorsque j’écris, ou travaille sur le site des Amis de la musique française, je porte cette nourriture à ma propre bouche avant de la proposer aux autres, si je la crois nourricière.
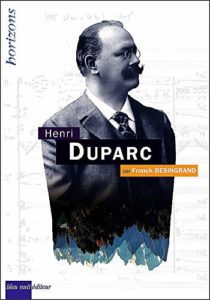 |
||
| Henri Duparc par Franck Besingrand, 2019 | ||
Je connaissais bien entendu le nom d’Henri Duparc qui, en réalité, est sans doute plus évocateur, dans sa complétude : Eugène Marie Henri Fouques-Duparc. Dire que je connaissais sa musique, même ses mélodies célèbres entre toutes, il me faut reconnaître qu’en réalité, assez peu, même si j’en possédais plusieurs versions.
César Franck (1822-1890) m’a toujours touché, le personnage est magnifique, sublime même ; sa musique se trouve éclairée par cette pure candeur, tout en étant construite savamment. C’était un saint qui enseignait et écrivait de la musique. Parmi ses élèves, le plus âgé, Alexis de Castillon (Marie-Alexis de Castillon de Saint-Victor, 1838-1873) avait fait naître en moi, une tendre affection. Son Concerto pour piano sous les doigts d’Aldo Ciccolini, il y a bien des années, m’avait fasciné par la beauté mélodique du thème de son premier mouvement.
Dans la liste de ses autres élèves, nous connaissons tous Vincent d’Indy, Ernest chausson, Guillaume Lekeu (le Rimbaud de la musique), Gabriel Pierné, Guy Ropartz, Charles Tournemire, Louis Vierne, Henri Busser, un peu moins Dynam Victor Fumet, Charles Bordes, Pierre de Bréville, Sylvio Lazzari, Samuel Rousseau, Mélanie Bonis, Augusta Holmès…
Sans doute en raison de la personnalité de leur maître, la « bande à Franck » comme ils s’étaient amusés à se qualifier, se signale par un fait suffisamment rare pour qu’il doive être relevé : les relations de tous ces musiciens étaient empreintes d’une authentique courtoisie et de rapports de franche amitié.
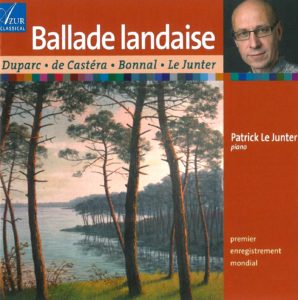 |
||
Ballade landaise, un des titres du disque Azur Classical, nous avait proposé une rareté absolue, l’opus 1 d’Henri Duparc, sous les doigts de Patrick Le Junter. Ces cinq pièces pour piano, intitulées Feuilles volantes, datée de 1869, sont d’une fraîcheur que l’on pouvait attendre d’un compositeur né en 1848, et donc âgé de 21 ans. Franck Besingrand dans sa biographie parue chez Bleu nuit éditeur – collection horizons – en 2019, décrit ainsi ses pièces : « Le langage est plaisant, clair, influencé par Franck, mais on ressent déjà le talent mélodique propre à son auteur et la profonde sensibilité. Remarquons dans la troisième pièce Andante un poco agitato une belle plasticité de la mélodie étirant sa phrase sur un accompagnement syncopé, lequel apporte beaucoup de stabilité au discours musical. »
Le don mélodique chez Duparc est évident et se confirme dans toute l’œuvre, plus que restreinte, du musicien. Les sommets atteints dans les mélodies accompagnées au piano ou orchestrées sont reconnus universellement, ce qui accroît l’inconfort des mélomanes devant un renoncement dont nous ne savons ni ne voulons définir les raisons profondes. Dans son Histoire de la Musique, Paul Landormy, lui consacre un paragraphe fort éloquent : « Henri Duparc (1848-1933) est un des premiers musiciens qui aient travaillé (dès avant 1870) sous la direction du Maître (César Franck). Il n’est connu que par un poème symphonique, Lénore (1875), et un recueil de douze mélodies parmi lesquelles l’Invitation au voyage (1871), Phidylé, La Vie antérieure, sont certainement les plus beaux lieds qui aient jamais été écrits en France. Un langage des plus choisis, une forme parfaite, de grandes images et de grandes passions et aussi des sentiments subtils et raffinés, une mélancolie délicate et un peu maladive, mais toujours le souffle d’une inspiration profonde, la phrase large et vibrante, voilà ce qui fait de ces quelques pages un des plus précieux monuments de notre art moderne[2]… »
Dans cet ouvrage, on notera que les noms de Vierne et de Tournemire sont simplement cités comme organistes ce qui accrédite bien l’idée pour l’auteur de cet ouvrage et très communément admise, qu’un organiste n’est pas, à proprement parler, un compositeur, sauf de partitions pour orgue !
Revenons à Duparc. Peu enregistrée, sa Sonate pour violoncelle et piano (1867) mérite d’être entendue. Sa brièveté ne la rend pas moins attachante et en particulier son second mouvement que Franck Besingrand qualifie de « poignant », préfigurant « le lyrisme des compositions ultérieures, par un chant éperdu du violoncelle, dans une ligne souple, presque aérienne. ». Le troisième mouvement par son impétuosité se révèle schumanien. Il surprend par sa vigueur rythmique peu fréquente chez le compositeur.
Trois pièces orchestrales nous permettent de regretter plus encore le génie orchestrateur du musicien. Michel Plasson dans un disque intitulé Poèmes Symphoniques Français a enregistré Effet de nuit (tableau symphonique d’après Verlaine), Lénore (poème symphonique d’après Bürger) et Aux étoiles (entracte pour un drame inédit). (Un disque EMI Classics). On trouve chez Accord, sous la direction de Jérome Kaltenbach, neuf mélodies avec orchestre, Lénore, Danse lente, Aux étoiles.
L’empreinte wagnérienne était recherchée, intégrée puis combattue par tous les compositeurs qui étudièrent avec César Franck. La volonté de se démarquer se manifesta davantage encore après le conflit de 1870. Au sujet de l’influence de Richard Wagner, dans une lettre à Henri Lerolle de 1893, Duparc reconnaît : « Il est certain que pour nous débarrasser de la préoccupation de cet homme et de ses œuvres, il faut un effort surhumain… Wagner a merveilleusement réalisé ses conceptions ; et, dans des conceptions analogues, aucun de nous ne peut espérer l’égaler : notre seul mérite sera donc d’avoir su faire de belles choses en les concevant autrement. »
La SNM[3] s’était fixée pour but de combattre le « mauvais goût » représenté dans certaines pages de Daniel-François-Esprit Auber, Adolphe Adam, Victor Massé, sans vouloir parler de Jacques Offenbach dont le refus de la musique était sous-entendu, et la prépondérance de la musique germanique, afin de réaliser un art français.
Si Duparc était un homme habité par le doute, il ne doutait cependant pas de l’affection de son maître et savait que celui-ci avait placé en lui ses meilleurs espoirs. En 1888, César Franck dédie affectueusement sa Symphonie à son cher Henri Duparc. Deux après, le décès de Franck, atteint Duparc au plus vif de son cœur.
Duparc avait une vision claire de l’attente du public, mais aussi du rôle d’éducateur qui revient aux artistes : « le public est un grand enfant maniaque et capricieux qui demande toujours du nouveau et toujours se révolte quand on lui en donne, qui n’aime pas à être secoué de sa torpeur par la rude étreinte du génie, mais qui, cependant, après avoir résisté, finit toujours par obéir. »
Duparc avait fait, en 1871, un mariage d’amour avec Ellie Mac Swiney qui ne lui survivra qu’une année. Ils eurent deux fils Charles et Léon. Mais comment expliquer les départs successifs du couple Duparc vers la province ou l’étranger qui vont se multiplier à partir de 1885 ? La maladie, l’inquiétude morale, le besoin de soins visuels, la recherche de sérénité, de calme, l’aspiration spirituelle ? Sans doute un mélange d’aspirations et de nécessités.
 |
||
| Portrait de Duparc par Georges Zezzos, 1907 | ||
Première évasion en 1885 : le couple Duparc s’installe dans la villa Florence à Monein, petite ville du Béarn, située non loin d’Orthez. L’intention de Duparc est explicite : « J’ai besoin, plus que vous ne pouvez le croire – plus que vous ne l’avez jamais cru –, de calme, de silence, de recueillement : ma vie, à Paris, était émiettée et gaspillée ; j’étais devenu incapable de toute occupation sérieuse et suivie ; j’en souffrais cruellement, et, entouré de tous les éléments du plus grand bonheur, j’étais profondément malheureux : ici une vie tranquille et régulière va me rendre enfin la santé du corps et celle de l’esprit : déjà je me ressaisis moi-même, et mon art bien-aimé, qui ne voulait plus de moi, reprend possession de tout mon être : mes facultés renaissent, et les années gâchées vont être réparées[4]… »
 |
||
| Villa Florence à Monein | ||
Des amitiés fortes vont se nouer avec Charles de Bordeu (1857-1926), écrivain réputé en ce temps, totalement oublié aujourd’hui, qui vivait à Abos, à quelques kilomètres de Monein et le poète Francis Jammes (1868-1936) qui vivait alors à Orthez. L’entente entre ces trois hommes croyants est puissante et bénéfique à Duparc qui jouissant en ces lieux de calme, de repos, entouré par ailleurs par les plus chaleureuses amitiés. L’émulation est à la fois artistique et spirituelle.
Le lien avec Bordeu, alors à peine âgé de 30 ans, sera indestructible.
Jammes, plus jeune encore, âgé de 22 ans, chantera en poésie cette amitié, après avoir fait la connaissance, grâce à Bordeu, en 1890, de Duparc :
Duparc, je vous ai bien aimé lorsque Bordeu
Et moi vous allions voir dans ce Monein morose
Où vous vous éleviez comme un nuage aux cieux
Comme une cime où seul le rossignol se pose[5].
Charles de Bordeu est un esprit libre, bucolique, pur, bon, fusionnel avec la nature :
« C’est surtout la solitude que je cherche et goûte et l’intimité avec la nature. C’est la sensation, toujours tonique, de me trouver encore fort et dispos, sinon jeune et insoucieux comme jadis, de frapper la terre d’un pied amical, en souliers ferrés, et d’être moi-même. Je vais où je veux, du pas que je veux, sans chemins ni gêne. J’emplis d’air ma poitrine et j’aère du même coup mes pensées[6]… Je prends l’oubli du monde, affolé d’affaires et perclus d’élégances, qui perd de plus en plus le sens de la vie. Où, lorsqu’il m’en souvient, c’est de très loin, enveloppé comme je le suis dans le calme des choses naturelles et me sentant vivre au cœur de la vie. Comme il convient, je mêle à ma tranquillité tout ce qu’il faut de la compassion intime que les hommes échangent dans leurs relations. Je la rendrais, avec une ampleur indulgente, à ceux qui, voyant comment je vis ou lisant par hasard ce que j’en écris, seraient tentés de me plaindre. Je les plaindrais aussi, de tout mon cœur, pour leur agitation grave et futile et le poids de leurs soucis éclatants, pour leur travail de forgeurs de mondes, sonnettes et tintamarres variés. Je les plaindrais surtout de leurs plaisirs, servitude autrement lourde que celle des plus rudes labeurs… Je me sens magnifiquement libre et maître de mes pensées. Je vais dans ce bel horizon ainsi qu’en un royaume où tout est mien, fermé à la vérité comme un cloître, mais dont les parois sont de cristal[7]. »
Charles de Bordeu se sent porté par ses relations artistiques et spirituelles :
« Je suis allé où penchait mon cœur… Merci à ces deux parfaits et grands amis, Henri Duparc et Francis Jammes, unis dans la même reconnaissance… À Charles Lacoste, à Carrière, qui voulut aussi m’être affectueux, au vieil ami des miens et de moi, le cher docteur Forcade : il a meublé pendant tant d’années de sa haute silhouette, avec ses grands chapeaux, sa barbe blanche et son air simple et fin de médecin-voyageur, ces chemins et ces champs, nous eûmes par là tant d’entretiens prolongés à plaisir, que je l’y vois encore. […]
Henri Duparc habitait alors Monein presque toute l’année, dans sa maison de ‟Florence”, qui domine une opulente vallée… J’allais le voir souvent. Et j’avais, en entrant chez lui, à quelque heure qu’il me convînt d’arriver, la joie toujours émue et nouvelle d’être le bienvenu, les mains se tendant par un geste poussé du cœur. L’accueil et le sourire, les yeux clairs, tout en lui était limpide, comme la pensée […] Avec Duparc, je pouvais parler ou me taire tant que je voulais, rire aux éclats d’une drôlerie sautant aux yeux, oublier le prochain, y revenir pour nous amuser salubrement, me passer d’esprit, en avoir aussi, comme M. Jourdain faisait de la prose. Jammes et Lacoste m’accompagnaient chez lui, chaque fois qu’ils venaient dans mon pays d’Abos faire de vagabondes promenades et manger des cailles avec du jambon, du pain bis et des œufs, boire mon vin rosé… Tous deux étaient jeunes et du même âge… Lacoste[8] avait les yeux tranquillement ouverts à méditer ses tableaux. Les premières toiles de ce grand peintre étaient déjà belles, de la sérénité claire et profonde qu’il voit dans la nature, parce qu’il l’a dans l’esprit. Volontiers silencieux, précis, quand il s’ouvrait, de pensée et de langage, il donnait l’impression d’un être paisible et fort qui se recueille avant d’agir. Duparc les aima d’abord, surtout Jammes qu’il vit plus souvent et qui entra de plain-pied dans son amitié. Il l’aima pour son beau caractère, sa franchise. Il fut séduit par son génie de poète et son esprit ailé. Combien de fois nous avons oublié l’heure, à quelque lecture de Shakespeare, Tolstoï, quelque autre grand, ou dans nos entretiens sur mille choses, sur le monde lointain, sur les livres et l’art, la nature et la vie !
Je ne sais pas d’esprit plus robuste et plus clair, mieux ouvert à tout, plus vif et gai, ni d’une sensibilité plus délicate que celui de notre ami. Il nous pardonnait avec bonne grâce d’être inattentifs à la musique et par conséquent de ne pas entendre les chefs-d’œuvre mélodiques qu’il a écrits et que tout le monde connaît… Il nous était reconnaissant de l’aller voir et de remuer toutes nos pensées avec lui, des vers que Jammes lui communiquait et des pages écrites de frais que je venais lire… On peut louer son esprit suffisamment, non sa bonté. C’est celle d’un cœur sans tache et sans soupçon, d’une âme où les laideurs n’ont pas d’entrée[9]… »
Durant ce séjour Duparc poursuit son travail compositionnel, sur une oeuvre qui l’occupera vingt-cinq années. Il s’agit d’un opéra, Roussalka. Malheureusement le doute le conduisit à détruire ce qui était déjà composé, sans doute la partition presque achevée. Pris de remord il tentera de la réécrire de mémoire mais il brûla à nouveau son second manuscrit. La villa ‟Florence” à Monein garde la marque de cette tragédie du doute artistique, de « l’inutilité » des choses du monde qu’instaure la prédominance du spirituel dans sa vie, alors même, peut-être stimulé par son jeune ami Charles Lacoste, qu’il s’adonne avec délice à l’aquarelle et au pastel.
Comment ne pas évoquer ce séjour en Béarn, sans imaginer qu’il fut pour Duparc un bain de jouvence, comblé principalement par l’amitié de ses trois jeunes amis, qu’il pouvait soutenir, stimuler dans leur propre quête artistique et spirituelle. Malgré l’épisode destructeur de Roussalka, ce fut un temps bénéfique pour Duparc.
En novembre 1895, Duparc perd sa mère. Durant l’été 1896 Francis Planté[10], et Vincent d’Indy vinrent en visite à Monein. Mais cette résidence qui aura duré plus de 10 années, lui déplaît désormais, il ne songe qu’a fuir la villa ‟Florence”. Il reviendra cependant dans la région, début 1899, pour le mariage de son ami Charles de Bordeu.
Le séjour à Monein s’achève en 1897. Le couple se réinstalle à Paris dans un esprit qui peut interroger. Duparc confiera à son ami Chausson : « Je suis arrivé à Paris, plus découragé, plus humilié que je ne l’ai jamais été et avec l’intention de me cacher à tous les yeux. » Sa santé défaillante le conduit en cures en France, Suisse et Autriche. Comme l’exprime Franck Besingrand : « …autant à Monein il oscillait sans cesse entre espoir et désespoir, autant à Paris, il s’installe dans une sorte de résignation[11]. » Le 10 juin 1899, le décès prématuré et accidentel de son proche ami Ernest Chausson va lui porter un nouveau coup sévère.
Duparc va faire la connaissance de deux personnalités musicales. Avec le grand pianiste Ricardo Viñes (1875-1943) ami de Ravel, Debussy et quelques autres, s’instaureront une admiration réciproque et de fructueux échanges.
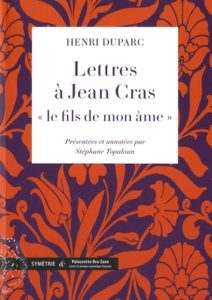 |
||
Après une première rencontre en octobre 1901, c’est avec un musicien autodidacte et officier de marine, de 31 ans son cadet que va s’établir une amitié puissante, riche de conseils, de respect et d’affection mutuelle. De cette rencontre, Jean Cras, écrivait dans une notice biographique datée de 1921 : « ceci marque une grande date dans ma vie ». Réciproquement, Cras sera le dernier grand bonheur de Duparc qu’il appelait « le fils de mon âme ». Les lettres de l’aîné heureusement préservées, contrairement à celle de Cras, sont désormais publiées[12].
Dans une très longue correspondance achevée le 22 mai 1902, Duparc confie sa déception à son nouvel ami Jean Cras au sujet de Pelléas et Mélisande, pour lui « Debussy n’est pas allé jusqu’au bout » de sa démarche innovante, il trouve qu’il y a « antinomie entre la musique immatérielle et la recherche de la vérité matérielle dans la mise en scène et le décor ».
La première visite de Duparc à Lourdes eut lieu le lundi de Pâques, 31 mars 1902 où il eut une illumination mystique. Sa seconde visite, en 1906 se fit avec Paul Claudel et Francis Jammes.
Nouvelle aspiration à plus de repos, de retrait, la proximité d’une sommité de la médecine oculaire qui pourra lui préserver ce qu’il lui reste de vue. En 1907, Duparc part s’installer près de Vevey en Suisse, dans la Villa Amélie (commune de La Tour-de-Peilz). Il fait la connaissance du jeune Ernest Ansermet et va rencontrer Igor Stravinsky. Non seulement il continue à peindre passionnément comme à Monein, mais sous l’heureuse impulsion d’Ansermet, il va entreprendre l’orchestration et la réorchestration de certaines mélodies, nous laissant ainsi le corpus le plus absolu de la mélodie française et la seule pièce restante de Roussalka, Danse lente. Le 17 octobre 1912, Ansermet donne à Montreux, parmi d’autres œuvres du musicien, Chanson triste qui sera bissée avec enthousiasme. Ce fut, une des ultimes joies artistiques de Duparc.
En 1913, Duparc et son épouse quittent la Suisse pour Tarbes et en 1919, il aménage dans sa dernière résidence, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, qui se trouve à deux pas de l’église. C’est en cette maison qu’il mourut vingt après s’y être installé, âgé de 85 ans, en 1933.
Avec les affres du vieillissement, le compositeur se perd ou se trouve dans une quête éperdue d’Absolu. Sa vision physique s’estompe jusqu’à la cécité ce qui lui faisait écrire, en 1922, à son ami Jean Cras : « Les yeux de mon corps sont dans les ténèbres, mais ceux de mon âme sont dans la lumière » et encore « Ma vie artistique est finie : elle est remplacée par une vie toute intérieure qui vaut mieux… »
La lettre du 29 mars 1922[13] dans laquelle Jean Cras narre à son épouse Isaure, son ultime rencontre avec Henri Duparc, a été conservée. Ce récit est particulièrement émouvant. Le vieux maître quasiment aveugle attend « le fils de son âme » à la sortie de la gare de Mont-de-Marsan. Il faut lire le récit de ce bref séjour pour en comprendre l’ineffable beauté et ce que représentent ces rencontres sur les cimes de l’intelligence et de l’art, offrant une esquisse de ce que pourrait être la vie qui s’ouvre au-delà du temps terrestre. Mais c’est déjà le jour et l’heure du départ : « À 8 heures moins le quart, le vieux landau de louage m’attendait à la porte. Duparc très ému, m’a embrassé longuement puis, se tenant sur le pas de la porte, avec un sourire si triste !, il agita les mains tandis que la voiture s’ébranlait. » Duparc lui ayant avoué : « Je n’ai plus beaucoup de joies, mais vous venez de m’en donner une très profonde. »
On cachera à Duparc la disparition prématurée de Jean Cras, survenue à Brest le 14 septembre 1932.
Henri Duparc achève son épreuve terrestre le 12 février 1933. Sur la carte commémorative annonçant son décès s’inscrivait cette pensée tirée de ses notes personnelles : « Quoi de plus naturel pour une âme chrétienne que de désirer la mort, puisque la mort est le seul chemin qui conduise à la Vie ? »
Paul Claudel qui avait entendu son espérance suprême, la décrivait, en 1936, dans La messe là-bas : « Il y a quelqu’un là-bas qui m’attend avec une suavité indicible. »
Son ami Francis Jammes lui dédiait cette épitaphe qui exprime son vœu le plus cher :
J’ai faim de toi, Ô Joie sans ombre
Lorsque je serai mort, Fermez-moi bien les yeux
Pour qu’en dedans je vois enfin s’ouvrir les Cieux.
[1] Henri DUPARC, Lettre à Alice Boisonnet, 24 novembre 1909.
[2] Paul LANDORMY, Histoire de la Musique, Paris, Éditions Mellottée, 1954, p. 326.
[3] SNM, Société Nationale de Musique fut fondée le 25 février 1871 par Romain Bussine et Camille Saint-Saëns, qui en partageaient la présidence. Son but était de promouvoir la musique française et de permettre à de jeunes compositeurs de faire jouer leurs œuvres en public. Sa devise était « Ars gallica ». Parmi ses membres initiaux figuraient : César Franck, Ernest Guiraud, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Alexis de Castillon, Henri Duparc, Théodore Dubois, Théodore Gouvy, Paul Taffanel… Elle fut créée en réaction à la tendance française de favoriser la musique vocale et l’opéra au détriment de la musique d’orchestre, et pour réaffirmer la grandeur de la musique française face à la tradition germanique.
[4] Joël-Marie FAUQUET, Correspondance de César Franck, réunie et annotée, Lettre d’Henri Duparc adressée depuis Monein à César Franck, Liège, Mardaga, 1999.
[5] Francis JAMMES, « Chez Henri Duparc », Ma France poétique, 1926.
[6] Le texte de Charles de Bordeu présente une évidente analogie avec le poème Chant de la grand-route de Walt Whitman (1819-1892), poète, romancier, journaliste, éditeur américain, dont le recueil de poèmes Feuilles d’herbe (Leaves of Grass) est considéré comme son chef-d’œuvre.
[7].Charles de BORDEU, La Terre de Béarn (French Edition). Chapitre IV, II À la chasse, BnF collection ebooks. Édition du Kindle.
[8] Charles LACOSTE (1870-1959), fils d’un comptable bordelais et d’une mère créole, il rencontre dès le lycée le futur poète, Francis Jammes avec lequel s’instaure une amitié de toute une vie, ainsi qu’un grand collectionneur Gabriel Frizeau. Sa formation est celle d’un autodidacte, de 1894 à 1897 il fait plusieurs rencontres importantes : André Gide, Arthur Fontaine, les frères Rouart et le compositeur Henri Duparc. De fréquents séjours à Londres marqueront sa vision de la nature d’une mélancolie brumeuse. Refusé à la Société des amis des Arts de Bordeaux, il apparaît en public en 1898 au Salon de La Plume, revue qui vient de publier son article « La Simplicité en peinture » puis expose en octobre au Salon des Cent. Il s’installe à Paris et de 1901 à 1914, il expose aux Indépendants. Membre fondateur du Salon d’automne, il expose également au Salon de la Libre Esthétique à Bruxelles, en 1907 et au Salon de la Toison d’Or de Moscou en 1908. Par un procédé de simplification et une sorte de naïveté voulue, Lacoste, fidèle à la tendance idéaliste, trouve des sujets d’émerveillement ou de rêverie parfois inquiétante dans les atmosphères brumeuses et hivernales qui permettent à l’artiste de simplifier les formes réduites à des formes indécises et de transfigurer la réalité quotidienne. Charles Lacoste a vécu à Monein, puis à Pardies où il repose (villages situés entre Orthez et Pau). D’après WikipediA.
Sous la signature A.P., en date du 17 août 2010, un article de La République des Pyrénées nous informe qu’en Béarn « … le peintre aura trouvé une sorte de sérénité absolue. « Il vivait en communion avec la nature, et même au-delà », commentent deux anciens de Pardies et Abos, que le personnage a profondément marqués. « Il n’avait que faire des apparences, d’ailleurs il se promenait toujours vêtu du même long imperméable, un large chapeau sur la tête et des sabots aux pieds, pour ne pas se les tremper. En Béarn il peignait certes la nature, mais il émanait de ses œuvres une telle spiritualité ! Il percevait à l’évidence beaucoup plus que ce que l’on pouvait voir. » À travers sa peinture, celui que les gens de Pardies qualifiaient même de saint homme rendait grâce à Dieu. « Il créait du beau et le rendait au Seigneur. C’était quelqu’un de très pieu, qui se rendait à la messe chaque matin, » raconte encore un jeune homme de l’époque. « C’était un mystique, et sa très forte personnalité inspirait le respect, » complète Marie-Andrée Benays, Pardisienne dont les parents invitaient autrefois le vieux peintre à déjeuner. À Pardies, Charles Lacoste aura vécu chichement. Sa demeure – la maison Passette – a depuis été rachetée. L’image du grand barbu peignant dans sa grange, les portes grandes ouvertes sur le soleil du soir, aura profondément marqué les esprits. » Toujours dans La République des Pyrénées, sous les initiales R.M. (publication du 25 janvier 2011) on lit : « Fin décembre, le Musée des Beaux-Arts de Pau a acheté, auprès d’une galerie parisienne, le tableau de Charles Lacoste intitulé Pardies, vue des Pyrénées. Le peintre girondin a exécuté ce magnifique paysage en 1906, à l’occasion de l’une de ses visites régulières au poète Francis Jammes. Séduit par les terres, le ciel et la lumière du Béarn, il a reproduit le panorama qui s’offrait à lui depuis le village. Post-impressionniste, la composition aux douces et chaudes tonalités balance entre naturalisme et symbolisme. »
[9] Charles de BORDEU, La Terre de Béarn, chapitre IV, III Amis d’autrefois et d’aujourd’hui, (French Edition). BnF collection ebooks. Édition du Kindle.
[10] Francis Planté (1839 –1934) est né à Orthez. Il suit son père à Paris et commence ses études musicales à l’âge de quatre ans. Il eut comme professeur madame de Saint-Aubert, qui avait été une élève de Franz Liszt. Il entra comme auditeur dans la classe d’Antoine-François Marmontel. Il obtient aux concours de juillet 1850 le premier prix de piano. Il poursuit son éducation musicale au conservatoire dans les cours d’harmonie de François Bazin. Surnommé « le dieu du piano », il fut l’un des tout premiers musiciens à avoir été enregistré. Arthur Rubinstein dans ses souvenirs Mes longues années, se souvient avec respect de la fougue de son jeu. D’après Wikipédia.
[11] Franck BESINGRAND, Henri Duparc, Paris, bleu nuit éditeur, collection horizon, 2019, p. 79.
[12] Henri DUPARC, Lettres à Jean Cras « le fils de mon âme », Lyon, Symétrie-Palazzetto Bru Zane – collection Perpetuum mobile, 2009.
[13] Ibid., Extrait de la lettre de Jean Cras à son épouse Isaure, du 29 mars 1922, p. 159-160.
17 mai 2020
Retour sur le chemin des bois
Qu’est-ce que le bonheur sinon le simple accord
entre un homme et l’existence qu’il mène ?
Albert Camus, Le Désert
C’était en 2009, il y a 11 ans aujourd’hui, que disparaissait Pierre Redon (gendre du compositeur Louis Aubert), Premier de cordée pour le monde du handicap, un saint homme illuminé par une foi intense et sereine.
Il m’a fallu brosser mes vieux baskets qui ont profité que de trop de la boue du chemin des bois que j’ai emprunté comme je le faisais si souvent par le passé avant que de prendre d’autres habitudes sur la voie verte, le long du canal de Saint-Astier.
Le soleil impose, un peu au-delà de 11h00, sa chaleur bienfaisante. La route, selon l’immuable rituel de printemps, est bordée de graminées variées, de boutons d’or et de fougères, les voitures sont peu nombreuses et je m’engage sur le chemin blanc du camping du Sabotier.
Le champ de gauche si richement fleuri il y a quelques années recèle encore, parmi les graminées et les marguerites abondantes, de parcimonieuses fleurs de lin, d’un bleu ciel pâle. Alors, le coucou, bien au-delà du champ, se fait entendre ! La déforestation de la parcelle qui suit aura pour conséquence désastreuse, à mon sens, de voir surgir une forêt dense de jeunes trembles.
Le chemin transversal qui s’en retourne vers la propriété Huot, fait place à un tapis de plantain non pourvu encore de toutes ses hampes brunâtres. Une haie de bourdaine arbore ses baies en formation… pour autant, il me semble que l’année 2020, avec son abondance de décès successifs, un état grippal de quatre semaines en février, un temps exécrable la première quinzaine de mars au moment de la taille au jardin, l’arrivée du Coronavirus, le confinement, n’aura pas nécessité à nous proposer, en supplément, les propriétés laxatives de l’écorce de Dame bourdaine !
« Avoir la chiasse » me fait penser à cette rencontre fortuite au marché de Neuvic, où je me suis rendu hier, pour la première fois depuis plus de deux mois. Nous étions bien peu nombreux à 8h30, cernés de barrières. Après avoir fait quelques achats sur le stand bio de Marie-Christine et Rémi, je traverse la halle pour me rendre sur le côté droit, afin de me procurer 500 gr de pointes d’asperges. Un couple âgé de ma connaissance arrive alors dans ma direction, lui, sans dire mot, file du côté gauche et son épouse recule de deux mètres comme si elle avait la peur au ventre de m’adresser la parole ! Entre les risques et la peur, je me demande ce qui rend le plus stupide ? En tout cas, je suis retourné chez moi heureux de cette « audace », je me mis à préparer la moitié des asperges et un potage de courge musquée auquel j’ajoutais carottes, courgette, oignon et un poivron jaune. Un régal !
 |
| L’Iris de la page Facebook de Stéphanie Moraly |
| Splashacata, Iris Cayeux |
Avant cette marche sous le soleil printanier, en ce premier week-end de déconfinement, où la liberté nous est généreusement rendue !, je cherchais à découvrir le nom du magnifique iris que la violoniste Stéphanie affiche sur sa page Facebook, fleur opulente qui possède toutes les caractéristiques des iris modernes, d’obtention récente ou relativement récente possédant des pétales ondulés d’un ton léger de mauve satiné, de blancs sépales relevés et larges, constellés ou piquetés de petits points violet-rose.
 |
| Cris de Cœur, Lawrence Ransom, 1993 |
Mes recherches sur les catalogues en ligne, Cayeux, Iris en Provence, Bourdillon dont je fus au début du jardin un lecteur fervent, me menèrent à rechercher Iris au Trescol à Hautefage-la-Tour (village situé entre Laroque-Timbaut et Penne d’Agenais) ce qui me fit connaître que Lawrence Ransom était décédé en 2016, alors qu’il était de sept ans plus jeune que moi, de retrouver la trace du sympathique jardinier Claude-Louis Gayrard, trésorier de la SFIB[1], domicilié à Peyreandrieu, commune de Gasques (82400), non loin à la fois de Valence d’Agen et de Saint-Nicolas-de-la-Grave (82210), disparu prématurément, mais encore celle du pharmacien botaniste Georges Gallier qui avait fondé La Salicaire. J’apprenais encore que Gladys Clarke[2], installée à Domme, avait été la fondatrice de la SFIB, en 1959. Lawrence Ransom avait baptisé un iris bleu mauve, Claude-Louis Gayrard et un rose tendre, Gladys Clarke (qui elle aussi est décédée, en mars 2016).
 |
| Gladys CLARKE devant l’Iris que lui a dédié Lawrence RANSOM |
Le voyage dans le présent, dans la grâce et l’atmosphère légère d’un matin de mai avait un corollaire, un voyage dans ce passé dont j’avais presque oublié qu’il fut hautement riche de rencontres heureuses, passionnantes. ♦
[1] La SFIB est l’association qui regroupe les amateurs d’iris, d’hémérocalles et de toutes sortes de plantes bulbeuses. Créée en 1959 par Madame Gladys Clarke, animée par des bénévoles, la Société Française des Iris et plantes Bulbeuses (S.F.I.B.), est une association régie par la loi de 1901, affiliée à la Société Nationale d’Horticulture de France.
[2] Celle qui a eu l’initiative de créer la SFIB, mais qui n’y a jamais tenu de fonction exécutive, c’est Gladys Clarke, une dame d’origine britannique, née et élevée en Chine, qui a pensé que les iridophiles français devaient s’organiser à l’image de ce que les Américains et les Anglais avaient fait auparavant. Il est en effet étonnant qu’en France, pays de l’iris par excellence dans les années 1920/1930, il n’existât aucune organisation rassemblant les amateurs. Gladys Clarke a réparé cette anomalie, et son entreprise a été couronnée de succès puisque six mois après sa fondation la SFIB comptait déjà une centaine de membres. Gladys Clarke a laissé le devant de la scène à un aristocrate russe, le Prince Pierre Wolkonsky, passionné de botanique, créateur du célèbre jardin de Kerdalo, en Bretagne, qui a exercé cette fonction jusqu’en 1961.
AVRIL 2020
Du 15 au 30 avril 2020
Les Preneurs d’âmes
Friedrich von Schiller (1759-1805) a pu dire : « Les grands arrêterons de dominer quand les petits arrêteront de ramper. »
Étienne de La Boétie (1530-1563) avait dans son Discours de la servitude volontaire, exposé la lâcheté qui amène les peuples à se soumettre aux tyrans qu’il juge inhumains, nuisibles, lui qui était un aristocrate :
« Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut faire que tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul, qui n’a puissance que celle qu’ils lui donnent, qui n’a pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante – et pourtant si commune qu’il faut plutôt en gémir que s’en ébahir –, de voir un million d’hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d’un, qu’ils ne devraient pas redouter – puisqu’il est seul – ni aimer – puisqu’il est envers eux tous inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes : contraints à l’obéissance, obligés de temporiser, ils ne peuvent pas être toujours les plus forts[1]… »
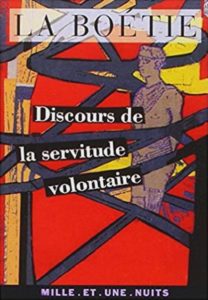 |
Comment ne pas en vouloir à cette race servile qui par ses incessantes lâchetés contraint tous les autres, les lucides, les courageux, les engagés, à subir la servitude générale. C’est ici un rôle qu’incarne ignominieusement Laurent Berger, chef conduisant un troupeau – qui parfois se démarque –, mais incarne le plus souvent la servitude consentie, adepte de collaboration avec l’ennemi.
Noam Chomsky dénonce les stratégies de manipulation des masses, cependant qu’en France, un bientôt ex-Premier ministre, use de termes suscitant la peur, la panique, tel que la menace d’un « effondrement économique » ; brandissant, par ailleurs, le spectre de la dette, cette chimère que la Banque Centrale peut balayer en créant simplement de « l’argent magique »…Même si l’Europe se refuse à user de cette stratégie, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’autre chose que d’opérations comptables et non d’effondrement, de catastrophe économique. Le choc des mots pour emporter l’adhésion.
« Nous vivons dans un monde plutôt désagréable, où non seulement les gens, mais les pouvoirs établis ont intérêt à nous communiquer des affects tristes. La tristesse, les affects tristes sont tous ceux qui diminuent notre puissance d’agir. Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. Le tyran, le prêtre, les preneurs d’âmes, ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous réprimer que de nous angoisser, ou, comme dit Virilio[2]… Ce n’est pas facile d’être un homme libre : fuir la peste, organiser les rencontres, augmenter la puissance d’agir, s’affecter de joie, multiplier les affects qui expriment un maximum d’affirmation. Faire du corps une puissance qui ne se réduit pas à l’organisme, faire de la pensée une puissance qui ne se réduit pas à la conscience[3]. »
 |
Marco Bersani (Attac Italie) dans un article intitulé Covid-19 : culpabiliser les citoyens, épargner les vrais responsables, publié le 24 mars 2020, en fait cette analyse :
« Une des stratégies les plus efficaces mises en œuvre dans toute situation d’urgence par les pouvoirs forts consiste à culpabiliser les individus pour obtenir d’eux qu’ils intériorisent la narration dominante sur les événements en cours, afin d’éviter toute forme de rébellion envers l’ordre constitué.
Cette stratégie a été largement mise en œuvre dans la dernière décennie avec le choc de la dette publique, présenté comme la conséquence de modes de vie déraisonnables, où l’on vivait au-dessus de ses moyens sans faire preuve de responsabilité envers les générations futures.
L’objectif était d’éviter que la frustration due à la dégradation des conditions de vie de larges couches de la population ne se transforme en rage contre un modèle qui avait donné la priorité aux intérêts des lobbies financiers et des banques sur les droits des individus.
C’est bien cette stratégie qu’on est en train de déployer dans la phase la plus critique de l’épidémie de coronavirus […]
Ce n’est pas le système sanitaire, dé-financé et privatisé qui ne fonctionne pas ; ce ne sont pas les décrets insensés qui d’un côté laissent les usines ouvertes (et encouragent même la présence au travail par des primes) et de l’autre réduisent les transports, transformant les unes et les autres en lieux de propagation du virus ; ce sont les citoyens irresponsables qui se comportent mal, en sortant se promener ou courir au parc, qui mettent en péril la résistance d’un système efficace par lui-même.
Cette chasse moderne, mais très ancienne, au semeur de peste est particulièrement puissante, car elle interfère avec le besoin individuel de donner un nom à l’angoisse de devoir combattre un ennemi invisible ; voilà pourquoi désigner un coupable (« les irresponsables »), en construisant autour une campagne médiatique qui ne répond à aucune réalité évidente, permet de détourner une colère destinée à grandir avec le prolongement des mesures de restriction, en évitant qu’elle ne se transforme en révolte politique contre un modèle qui nous a contraints à la compétition jusqu’à épuisement sans garantir de protection à aucun de nous. […] Mais commençons à écrire sur tous les balcons : « Nous ne reviendrons pas à la normalité, car la normalité, c’était le problème[4] »
 |
« Une fois cette tragédie surmontée, tout recommencera-t-il comme avant ? Depuis trente ans, chaque crise a nourri l’espérance déraisonnable d’un retour à la raison, d’une prise de conscience, d’un coup d’arrêt. On a cru au confinement puis à l’inversion d’une dynamique sociopolitique dont chacun aurait enfin mesuré les impasses et les menaces[5]. La débandade boursière de 1987 allait contenir la flambée des privatisations ; les crises financières de 1997 et de 2007-2008, faire tituber la mondialisation heureuse. Ce ne fut pas le cas[6]… »
L’espoir, au contraire de ce que l’on croit
équivaut à la résignation.
Et vivre ce n’est pas se résigner.
Albert Camus, Noces
[1] Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Paris, Mille et Une Nuits, 2005, p. 8.
[2] Paul Virilio (1932-2018) restera comme ‟le penseur de la vitesse” dont la tyrannie, disait-il, a tout désynchronisé. Le temps humain et le temps technologique, expliquait-il, ne sont plus en phase. Ce déséquilibre croissant perturbe gravement nos environnements économique, politique, culturel, en diminuant l’espace de la réflexion et de la décision.
[3] Gilles Deleuze, Dialogues avec Claire Parnet, sur le site Réveil-Mutin : https://reveilmutin.wordpress.com/category/citations/
[4] Marco Bersani (Attac Italie), Covid-19 : culpapiliser les citoyens, épargner les vrais responsables, publié le 24 mars 2020. Source : https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/et-maintenant-on-culpabilise-les-citoyens
[5] Lire Le naufrage des dogmes libéraux et Frédéric Lordon, Le jour où Wall Street est devenu socialiste, Le Monde diplomatique, respectivement octobre 1998 et octobre 2008
[6] Serge Halimi, Dès maintenant !, Le Monde Diplomatique d’Avril 2020.
16, 18 & 23 avril 2020
La gloire de faire du miel
Ressembler aux abeilles tant elles ont l’amour des fleurs !
tant elles ambitionnent la gloire de faire du miel !
Joseph Joubert[1]
La rediffusion sur la cinquième chaîne de la Grande librairie qui avait pour invité d’honneur François Cheng était plus que pertinente, bienvenue. Sa première diffusion m’avait été signalée par Marie-Hélène qui voulut écourter notre conversation téléphonique pour regarder l’écrivain, le poète et le penseur. Je l’avais découvert par un livre enthousiasmant que m’avait offert Monique Selva. C’était Cinq méditations sur la beauté.
C’est pourquoi je voulus regarder moi-même l’émission à un moment avancé d’ailleurs puisqu’un des deux autres invités, Daniel Tammet, était en conversation avec François Cheng. J’avais peu prêté attention à l’autre invitée Christiane Rancè, fasciné par Daniel Tammet, un autiste éveillé et surdoué.
 |
Cette rediffusion était d’autant heureuse que leur conversation à trois voix parvenait à une unité évidente, invitant à repenser nos rejets brutaux et amers. La spiritualité, l’âme en chacun de nous, est tout autre chose que l’appartenance à des organisations religieuses trop souvent prêtes à enfermer les mouches capturées dans un conformisme abêtissant, vivement dénoncé par Élisée Reclus : « Il est en effet plus commode de recevoir des opinions toutes faites que d’avoir à chercher avec anxiété dans le sanctuaire de sa conscience : débarrassé du soin de penser, d’aimer, de vivre pour son propre compte, l’homme timide accepte avec joie l’autorité d’un prêtre ou d’une tradition : il ne connaît point ces questions redoutables qui se posent devant l’homme vraiment religieux, ces doutes terribles qui l’assiègent, ces luttes intérieures auxquelles succède un profond découragement ou parfois même le désespoir. Il repose tranquillement sa tête sur l’oreiller de la foi commune et s’adonne à quelques vaines cérémonies qui remplacent avantageusement les convictions[2]. »
Dans le prologue de ses carnets spirituels, Christiane Rancè s’exprime dans un style imagé de pure poésie qui invite à suivre sa méditation : « J’ai voulu que ces textes aient la couleur et l’esprit du pollen, cette poudre d’or que la nature confie aux visiteurs de passage pour qu’elle porte ses fruits. Papillons, abeilles, la manche d’un enfant qui court ou encore le vent ou l’aile d’un oiseau. Ce pollen qui nous incite à prendre le temps d’écouter la nature et à s’émerveiller du passage des saisons. Ce pollen dont le poète romantique allemand Novalis voulait baptiser son œuvre afin que ses grains de soleil illuminent encore nos heures, et nous rendent autres[3]. »
 |
L’ouvrage de François Cheng, De l’âme : Sept lettres à une amie, cite la première lettre d’une amie l’invitant à reprendre leur conversation sur l’âme : « Sur le tard, m’écrivez-vous, je me découvre une âme. Non que j’ignorais son existence, mais je ne sentais pas sa réalité. S’ajoute à cela le fait que, autour de moi, personne ne prononçait plus ce mot. Cependant, à force de vivre, de me délester de pas mal de choses, s’impose à moi cette entité irréductible, à la fois intangible et charnellement réelle. Elle m’habite au centre et ne me lâche plus. Et puis, un jour, je me suis souvenue de cette rencontre – si lointaine, si estompée, on dirait dans une autre vie – lors de laquelle, en passant, vous aviez glissé le mot dans notre conversation. J’étais trop jeune pour le saisir au vol. Entre-temps, j’ai lu certains de vos écrits. À présent je suis tout ouïe ; acceptez-vous de me parler de l’âme ? Il me semble qu’à partir de là, tout redeviendrait essentiel, ouvert[4]. »
Et l’auteur de s’interroger : « L’âme n’est-elle pas justement cette chose dont on ne doit pas parler, au risque d’incommoder ? On ne doit ni ne peut. Qu’on s’y hasarde, et l’on se découvre aussi démuni que celui qui chercherait à définir par exemple ce qu’est le temps, la lumière ou l’amour. Pourtant, ce sont là des éléments dont aucun de nous ne saurait nier l’existence, et dont notre existence même dépend[5]. »
Ainsi débute la première des Cinq méditations sur la beauté de François Cheng : « En ces temps de misères omniprésentes, de violences aveugles, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourra paraître incongru, inconvenant, voire provocateur. Presque un scandale. Mais en raison de cela même, on voit qu’à l’opposé du mal, la beauté se situe bien à l’autre bout d’une réalité à laquelle nous avons à faire face. Je suis persuadé que nous avons pour tâche urgente, et permanente, de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités de l’univers vivant : d’un côté, le mal ; de l’autre, la beauté. Le mal, on sait ce que c’est, surtout celui que l’homme inflige à l’homme. Du fait de son intelligence et de sa liberté, quand l’homme s’enfonce dans la haine et la cruauté, il peut creuser des abîmes pour ainsi dire sans fond, ce qu’aucune bête, même la plus féroce, ne parvient à faire. Il y a là un mystère qui hante notre conscience, y causant une blessure apparemment inguérissable. La beauté, on sait aussi ce que c’est. Pour peu qu’on y songe cependant, on ne manque pas d’être frappé d’étonnement : l’univers n’est pas obligé d’être beau, et pourtant il est beau. À la lumière de cette constatation, la beauté du monde, en dépit des calamités, nous apparaît également comme une énigme.
Que signifie l’existence de la beauté pour notre propre existence ? Et en face du mal, que signifie la phrase de Dostoïevski : « La beauté sauvera le monde[6] » ? Le mal, la beauté, ce sont là les deux défis que nous devons relever. Ne nous échappe pas le fait que mal et beauté ne se situent pas seulement aux antipodes : ils sont parfois imbriqués. Car il n’est pas jusqu’à la beauté même que le mal ne puisse tourner en instrument de tromperie, de domination ou de mort. Mais une beauté qui ne serait pas fondée sur le bien est-elle encore « belle » ? La vraie beauté ne serait-elle pas elle-même un bien ? Intuitivement, nous savons que distinguer la vraie beauté de la fausse fait partie de notre tâche. Ce qui est en jeu n’est rien de moins que la vérité de la destinée humaine, une destinée qui implique les données fondamentales de notre liberté[7]. »
Le lundi de Pâques j’eus la surprise d’un appel de Jean-Claude qui venait ici, il y a plus de vingt ans, travailler au jardin. Nous avons causé de ce qu’il est convenu de nommer « prophéties » ou « révélations », ou encore intuitions. Les Mormons sont adeptes de la chose, pour avoir des Présidents Prophètes et Révélateurs à la tête de l’Église qui inlassablement répètent : « Suivez les commandements de Dieu. » comme révélation toute fraîche !
Chaque fois qu’une révélation s’imposait après la mort de Joseph Smith et de Brigham Young ce fut pour s’adapter aux lois américaines, premièrement celle qui condamnait la polygamie. Deux présidents se succédèrent avec des points de vue totalement différents. John Taylor (président de 1880 à 1887) polygame lui-même, refusa d’abdiquer la loi divine pour la loi humaine, il fut emprisonné en 1886 et 1887, et termina sa vie, fin juillet 1887, dans une sorte d’exil. Son successeur Wilford Woodruff, président de 1887 à 1898, eut à cœur de trouver une solution pour sauver son peuple et dans une déclaration publique, datée du 24 septembre 1890, il affirma son intention de se soumettre aux lois du pays et donc d’abdiquer la « loi divine » de la polygamie !
L’Église ne m’a jamais semblée raciste comme tant d’américains ont pu et peuvent l’être encore. Sa bienveillance vis-à-vis des Indiens est légendaire mais la négritude était pour l’Église la marque de Dieu sur ceux qui avaient enfreint ses enseignements, la malédiction des descendants de Caïn. Ils étaient baptisés mais jamais ordonnés à la prêtrise. Les pressions du gouvernement, des mouvements des droits civiques… contraignirent les autorités Générales à la réflexion. Sans une véritable révélation le président de l’Église, Spencer W. Kimball convainquit le collège des Douze de revenir sur cette loi, ce qui fut une grande joie pour les membres de couleur et pour les autres également. Du coup avec le temps l’Église voulut investir ses efforts en Afrique, où elle envoie ses missionnaires et érige des temples. Mais à ces adaptations bienvenues, où la sagesse impose de radicaux changements, ne me semble pas pouvoir s’appliquer la définition de « révélation ». C’est la raison qui plie devant contraintes et pressions extérieures.
La révélation directe, implacable, incontestable me semble être tout autre chose qu’une forme de sagesse. J’expliquais à Jean Claude que j’avais eu plusieurs intuitions ou « révélations » soudaines, comme chacun de nous peut en avoir, et dont la pertinence s’impose comme indiscutable : ce fut le cas pour Neil Andersen, pour Thierry Naudou. Celle pour Mathieu Le Roch est en voie de réalisation, mais n’est nullement parvenue à son accomplissement total. J’ai su en un bref instant quel serait leur devenir. Lorsque je m’en ouvrais, lors d’une visite, à notre ami Maurice Claude, ce dernier me confirma que c’était naturel. Le corps physique, l’esprit n’ont pas accès à ces connaissances, par contre l’âme ou le corps spirituel accède à ce qu’il convient de définir comme « le temps linéaire ». Ainsi note âme peut avoir accès au passé comme au futur. N’ayant jamais accepté les initiations que l’on me proposait, je ne sais si cette capacité de voyance fulgurante peut exister de manière plus continue ou permanente.
François Cheng agit par passion, enthousiasme – ce qui signifie la Présence de Dieu en soi, ainsi que le formulait Daniel Tammet. Sa démarche permanente est la recherche à travers la Beauté, non exempte, mais au contraire, alliée à la Souffrance, de l’essence même de la vie que corps et esprit ne peuvent connaître. Seule l’Âme éternelle peut en procurer une vision.
 |
Souvent notre foi régresse devant les effarants et insoutenables mensonges des politiciens. La non assistance de Dieu et de ses saints dans nos tribulations produit la même suspicion et le même rejet. Nous nous sentons trahis, abandonnés. « L’actualité des hommes blesse souvent ce désir de joie, et il arrive que la souffrance, le deuil, la déréliction fassent leur grimaçante irruption dans nos maisons[8]. » « Il n’est que trop évident que notre époque rappelle le début de La Divine Comédie, dans cette plongée aux enfers dont nous sommes tous les témoins. Dès lors, il s’agit de prêter l’oreille à ce que Dante enseigne, sous le regard de son maître Virgile, à savoir qu’il importe d’entreprendre un pèlerinage pour monter au purgatoire et, au terme de l’aventure, pour autant que l’aventure soit vraiment tentée, atteindre le paradis. Comme le disait Paul Claudel : ‟Notre résurrection n’est pas tout entière dans le futur, elle est aussi en nous, elle commence, elle a déjà commencé.”[9] »
« …on ne compte plus les témoignages des gens qui travaillent dans les hôpitaux sur la soudaine incandescence de certains êtres à qui la maladie rend le feu de l’Esprit qu’une vie trop matérialiste avait volé à leur âme… C’est aussi ce que fait la maladie, nous intimer l’ordre de voir l’invisible, et d’entendre ce que chuchote le mystère.[10] »
 |
« La mort corporelle, notre « sœur la mort corporelle », comme disait saint François, est incontournable. Étant un arrachement, elle est douloureuse. Mais la marche du Souffle vital se situe infiniment au-delà de la mort. Elle n’en finira pas de poursuivre sa Voie, selon l’adage formulé par les penseurs chinois : Sheng-sheng bu-xi, « La Vie engendre la Vie, il n’y aura pas de fin ». De tout l’univers, de toute éternité, il n’y a qu’une unique aventure, celle de la Vie, et nous en faisons partie.[11] »
On ne meurt pas complètement, la vie continue.
Ce n’est plus une vie terrestre, voilà tout.
Max Jacob
[1] Joseph Joubert cité par Christiane Rancè dans son ouvrage En pleine lumière : Carnets spirituels, Exergue (French Edition). Paris, Éditions Albin Michel, 2016. Édition du Kindle.
[2] Reclus, Élisée, Le mormonisme et les États-Unis (French Edition). Revue des Deux Mondes T. 32, 1861 Exporté de Wikisource le 30/12/2016. Édition du Kindle.
[3] Rancè Christiane, En pleine lumière : Carnets spirituels, Prologue (French Edition). Paris, Éditions Albin Michel, 2016. Édition du Kindle.
[4] Cheng, François. De l’âme : Sept lettres à une amie (French Edition). Éditions Albin Michel, 2016. Édition du Kindle.
[5] Ibid.
[6] Fédor Dostoïevski, L’Idiot, Paris, Gallimard, collection Folio, 2001, IIIe partie, chap. I.
[7] Cheng, François, Cinq méditations sur la beauté, Paris, Le Livre de Poche/Albin Michel, 2010, p. 13-14.
[8] Rancè, Christiane, En pleine lumière : Carnets spirituels (French Edition). Albin Michel. Édition du Kindle.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Cheng, François, De l’âme : Sept lettres à une amie (French Edition). Albin Michel. Édition du Kindle.
Du 2 avril au 14 avril 2020
Vaincre le vide
Réfugie-toi dans l’étude, tu échapperas
à tous les dégoûts de l’existence.
L’ennui du jour ne te fera pas soupirer après la nuit
et tu ne seras pas à charge de toi-même et inutile aux autres.
Sénèque, De la tranquillité de l’âme
Après cette interminable procession mortuaire depuis début janvier je pourrais dire comme le personnage central de la nouvelle Le fil des Missangas de Mia Couto : « Je ne suis pas vieux, c’est vrai. Mais j’ai contracté de nombreuses vieillesses[1]. »
Lorsqu’on possède un espace extérieur, un balcon, un bout de terre, il peut exister une félicité du confinement choisi : « Regarder passer les nuages est une occupation comme une autre. Ne plus bouger, ne plus s’agiter, rester là allongé à contempler le temps qui s’enfuit et à écouter le vent dans les arbres, me semble la félicité suprême[2]. » Cette tranquillité de l’être passe par la décroissance heureuse, le renoncement à l’argent, au toujours vouloir plus. Sénèque déjà prônait : « Tu vois à quelle triste et cruelle servitude sera asservi celui que posséderont tour à tour les plaisirs et les douleurs, ces maîtres les plus capricieux et les plus tyranniques de tous. Il faut donc se retirer vers la liberté ; et rien d’autre ne la donne que l’indifférence envers la fortune. Alors naîtra cet inestimable bien, le calme et l’élévation de l’âme placée dans un asile sûr[3]. »
Car c’est aussi mon indépendance, mon inextinguible soif de liberté pour moi et les exploités qui me dresse contre la religion abêtissante, avilissante, asservissante. Tout cela n’est fait que pour tenir l’homme en laisse. La Secrétaire Générale de la CGT Dordogne réagissait vivement à de petits cadeaux d’entreprises peu scrupuleuses sur les droits des salariés : « ceux qui nous exploitent se donnent bonne conscience en faisant oeuvre de charité, telles les dames patronnesses dans Germinal… La charité est un acte individuel de bonne conscience, la solidarité est un choix collectif de protection et d’égalité de droits pour tous.»
Léon Bloy, «mystique de la douleur» est le plus furieux invocateur de la justice au coeur d’une époque dont il dénonça la misère sociale et l’hypocrisie bien-pensante. Dans Le Sang du pauvre, il invective les imposteurs, ces «bâtards des démons» : « Et ils osent parler de charité, prononcer le mot Charité qui est le Nom même de la Troisième Personne divine ! Prostitution des mots à faire peur au diable ! Cette belle dame, qui n’a pas même la loyauté de livrer son corps aux malheureux qu’elle attise, ira, ce soir, montrer tout ce qu’elle pourra de sa blanche viande à sépulcre où frémissent des bijoux pareils à des vers et la faire adorer à des imbéciles, en des fêtes prétendues de charité, à l’occasion de quelque sinistre, pour engraisser un peu plus les requins ou les naufrageurs. La richesse dite chrétienne éjaculant sur la misère ![4] »
C’est ici une discussion que j’ai souvent avec Mathieu. Moi-même entre un employeur insultant et un doucereux, je n’hésitais pas à tomber à bras raccourcis sur le premier et à trouver la bienveillance du second touchante ! Dans la lutte de classe, il y a les exploiteurs et les exploités. Sans doute, la seconde manière relève de plus de subtilité (ou de machiavélisme) pour baiser son monde. Jusqu’à l’apothéose des phalanstères[5] qui permettait d’avoir en permanence ses « esclaves » sélectionnés et attitrés sous la main. Reconnaissons que nous sommes nombreux à nous laisser embobiner et berner, pourvu que l’on nous fasse de petits cadeaux ou de petits signes de favoritisme.
Il y a des patrons qui aiment ou qui ont besoin d’avoir bonne conscience, d’autres qui, comme Macron, n’ont rien à faire de l’avis des autres et sont suffisamment imbus de leur petite personne pour apparaître aux yeux de tous comme d’authentiques salauds !
Et tristement, les salariés sont souvent adeptes du moins pire qui ruine leurs espérances d’émancipation !
Alors que j’étais hospitalisé à Bordeaux, le 6 janvier 2015, j’avais tracé ces lignes intitulées « Être Homme », lignes dédiées à mes camarades de lutte :
« Les éveillés, les conscients, les rebelles, les quêteurs, les hommes en marche, ceux qui luttent pour plus de justice et d’équité se doivent de porter le front haut, le regard clair et l’espoir au cœur. Car c’est par eux qu’inéluctablement germent les remises en question, les avancées, les victoires de l’humanité.
Celui qui a de la dignité, de la fierté, qui ne se soumet à rien d’avilissant est en droit de se savoir porteur d’espoir, de rédemption en cette humanité malade et gangrenée.
Depuis toujours et souvent aux prises avec des luttes étrangement violentes, cruelles dans leurs propres vies, ils sont les flambeaux et la quintessence de notre civilisation.
Nous n’irons pas chercher chez Pinochet, Videla, Franco, Mussolini, Hitler… les références pour construire le progrès. Et comment même se rattacher à des personnages prêts à vendre leurs âmes contre l’argent sale et criminel du grand capital ?
L’homme courbé, servile est toujours indigne, même si son adhésion temporaire à l’ordre établi semble lui apporter caution et reconnaissance (faussée car elle ne peut qu’être imprégnée de mépris de la part des récipiendaires de ces vilenies).
Seulement si tu es intègre, tu as le droit d’être fier et d’arborer un large sourire, car tu es Homme digne de ce nom. »
L’amour d’écrire, de dire, fait partie d’un don, d’un partage. Partage restreint certes mais qui s’il peut éclairer, libérer une seule personne, mérite d’exister. Michel Etievent nous rappelait, tout récemment, la fièvre de celui qui écrit : « Tout écrivant souffre », disait le frère Rimbaud. Il était expert en la matière lui qui hurlait parfois devant le blanc désespérant du papier quand la musique de sa saison en enfer tardait à traduire les orages qu’il avait en tête. Et il en est ainsi de tous ceux qui écrivent. Peut-être parce que lorsque l’on écrit on ne pense qu’aux autres. Un don de soi. On donne, on offre ses mots. Aussi faut-il qu’ils soient à la hauteur de l’exigence de ceux qui vont vous lire. Je vous sens. Je vous vois lire. Et c’est pour cela que j’écris. Pour tenter, je dis bien tenter, de vous mettre en bonheur. Le prix c’est l’incertitude de vaincre le vide qui court sous votre main. Celle que ressentait Frantz Kafka devant la phrase absente. « Ce matin, écrit-il dans son journal intime, je n’ai rien écrit. La plume se dérobe. Les mots piétinent. La couleur des mots ne s’impose plus… »
D’autres auteurs l’ont dit avec autant de vérité. Paul Auster : « J’écris pour vous. J’écris pour que l’on se parle enfin par delà les silences que ce monde fou nous impose… ». Faut-il encore citer Flaubert évoquant dans sa correspondance son impuissance devant la phrase. Pour rédiger Madame Bovary, il n’écrivait guère plus de deux pages par semaine tant l’ouvrage réclamait humilité, j’allais dire santé. « Le roman est un mur. Des briques que l’on pose une à une comme des phrases qui vous glissent des mains. J’ai peur que tout m’échappe, que tout s’effondre… ». Kafka encore : « Quand je commence à écrire après m’être interrompu, c’est comme si je tirais des mots du vide. Rimbaud pour achever : « Je tentais chaque nuit de noter des vertiges, des silences. Mon encre s’épuisait dans la quête. Mes sens et ma vie aussi… ». ♦
[1] Mia Couto, Le fil des Missangas, Paris, Éditions Chandeigne – Librairie Portugaise, 2010, p. 76.
[2] Jean Chalon, Journal d’un ours 2008 à 2011, La Vancelle (67730), Éditions du Tourneciel – collection le Chant du merle, 2015, p. 124.
[3] Sénèque, La Vie heureuse (La Petite Collection t. 282) (French Edition). Fayard/Mille et une nuits. Édition du Kindle.
[4] Bloy, Léon, Le Sang du pauvre (French Edition) (pp. 41-42). Édition du Kindle.
[5] Phalanstère : Communauté de production imaginée par Fourier afin de parvenir à la dernière étape de l’industrie sociétaire.
Mars 2020
Du 24 au 31 mars 2020
Lune-soleil, Maurice Claude
Mardi 24 mars, Marie Annick m’apprenait la disparition de Maurice CLAUDE à l’âge de 88 ans. Lors de notre dernière rencontre, en 2012, dans sa maison si singulière, à Guilme, commune de Plazac, nous avions été troublés par son inconfort nerveux qui accentuait la peine causée par le départ de sa douce épouse Suzanne.
Plazac, charmant village proche de Montignac, ne s’attendait certainement pas à se voir proclamer « Nouvelle Terre Promise » par une éclosion, sur ces terres, du « New Age » ou « Renouveau Spirituel ». La création de Lune-soleil date du 28 juillet 1990. L’association se définissait elle-même ainsi : « Lune-soleil est un espace de convergence et de rayonnement ayant pour but d’accueillir et d’échanger des connaissances et des moyens contribuant à l’épanouissement de l’être et à sa réalisation intérieure, dans un esprit d’ouverture, de partage et de solidarité. Cet espace a pour vocation de faciliter la pratique d’une vie simple, l’expression de l’art facteur d’amour et d’harmonie, l’étude de la nature et le respect de ses lois, et toutes pratiques d’éveil intérieur. »
 |
| Lune-soleil, Plazac |
Ce nouveau paradigme, sorte d’émanation de « Peace and Love » et d’ex-Hippies, s’affichait comme une approche individuelle éclectique incluant des personnes en recherche de tous horizons : adeptes de la Théosophie, de l’Anthroposophie, du Bouddhisme, de l’Indouisme, fervents de Carl Gustav Jung, Graf Durckheim, Swami Vivekananda, Arnaud Desjardin, Krishnamurti, Satprem, Mère, Sri Aurobindo, Gurdjieff, de pèlerins s’en revenant d’Auroville, de Findhorn, adeptes du Channeling… la liste est presque infinie. L’aspiration à l’écologie vient se joindre aux turbulences d’un shaker dans lequel tourbillonne une multitude d’enseignements ésotériques. Certains sociologues considèrent « L’Ère du Verseau » comme un « bricolage » syncrétique de pratiques et de croyances ayant pour vocation commune de transformer les individus par l’éveil spirituel et par voie de conséquence de magnifier le monde.
Parmi les personnages essentiels de ces lieux, il faut citer le Docteur Guy Londechamp, homéopathe à Périgueux, Anne Givaudan, parfois appelée Anne Meurois-Givaudan, écrivain, auteur d’ouvrages de spiritualité « New Age ». Elle a collaboré à la rédaction de plusieurs ouvrages avec Daniel Meurois, son ex-mari, puis avec Antoine Achram, son mari actuel. Ses livres traitent des sujets de la vie après la mort et de questions existentielles. Elle affirme que cette connaissance proviendrait de son expérience de voyages hors du corps. Son ex-époux Daniel Meurois, parfois appelé Daniel Meurois-Givaudan, est écrivain, auteur populaire, depuis trente-neuf ans, d’ouvrages du courant spirituel dit « New Age » en partie en collaboration avec Anne Givaudan. Il y évoque principalement des expériences personnelles de « décorporation » ou « Sortie astrale », fondées sur la théorie des Annales Akashiques. Ses livres sont des succès de librairie, traduits dans une quinzaine de langues. De 1984 à 1996, il dirige la société d’édition Arista, devenue par la suite Amrita leur permettant de publier leurs ouvrages et d’autres écrivains et ce qui fit mon bonheur, les trois volumes de la biographie de Krishnamurti, par Mary Lutyens[1].
Bernard Leblanc Halmos se définit comme « praticien en santé sociale, conseiller en communication et accompagnateur de changement, intervient dans les domaines de la recherche scientifique appliquée, les produits nouveaux, le management et la dynamisation d’entreprises. Il est à l’origine des séminaires Sérénité et Efficacité qui ont touché plusieurs milliers de cadres, et de responsables d’entreprise depuis plus de 30 ans à l’initiative de Jigmé Rinpoché. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de sagesse et d’humour. Il est aussi musicien, auteur dramatique, sculpteur, dessinateur et écrivain. Il est également le fondateur de l’École du Génie Mutuel. Toutes les activités proposées – enseignements, conférences, pratiques et ateliers – sont en lien avec la Sagesse Bouddhiste Tibétaine. »
 |
| Dhagpo, Plazac, temple bouddhiste |
En quittant Plazac, dans la direction du Moustier, la route de droite permet d’accéder au bâtiment de Lune-soleil, celle gauche qui grimpe en lacets permet d’accéder au plateau dominant la Vézère qui traverse le superbe village de Saint-Léon-sur-Vézère, avant de rejoindre, dans la vallée, le village de Thonac. Par cette route on accède au château de Chaban, mais encore à La Terre de Jor, maison d’hôtes – centre de stages et restaurant végétarien –, à Dhagpo, centre Bouddhiste renommé. Ces lieux ont vu s’ériger, dans les années 90, un grand nombre de chalets et de maisons en bois où se développèrent de nombreuses activités liées à l’univers de cette spiritualité. C’est au cœur de ces « lieux sacrés » que nous venions rendre visite de temps à autre à un personnage tout à fait unique.
La décennie des années 90 aura été la plus riche et fastueuse de mon existence, avec le développement du jardin, de multiples rencontres, de nouvelles amitiés, et finalement la gestation des Amis de la musique française, qui vit le jour en 2001.
Le jeudi 10 mai 1990, je rencontrais au Bugue, Franck Willems, un jeune des Eyzies, épris de jardin, mais visiblement sérieusement malade. Nous restâmes en contact et je recherchais des moyens de l’aider à surmonter ses troubles psychologiques.
Lors de mes contrôles, le mardi 23 juillet 1991 à Montignac, je fis connaissance de Mireille Balmes. Le centre de Lune-soleil à Plazac fut évoqué. Le soir même au retour de Terrasson, j’arrivais par Le Moustier pour découvrir Lune-soleil, hexagone, sa bibliothèque et la sympathique Anne Dizin. J’y rencontrais un peintre hollandais spécialisé dans l’ésotérisme : licornes, elfes, gnomes, sylves… J’emportais, choisies dans la bibliothèque de l’association, des cassettes audio de Christian Tal Schaller[2], Marie von Franz et Marie Madeleine Davy.
Le mardi 6 août, au retour de Sarlat, je repassais par Plazac et j’y fis l’acquisition de deux ouvrages. Le premier sur les élixirs du docteur Edward Bach (remèdes dont je ferais grand usage durant des années), le second sur les cristaux. Le jeudi 8, au retour de Carlux, je prenais de nouveau cette route. Cette fois, je fis la connaissance de Joseph qui vivait en caravane et prêtait main forte à l’association. J’emportais d’autres cassettes, des livres.
Le lendemain soir, accompagnée de Christiane Jensen, j’assistais à une conférence sur Findhorn et ses merveilles !
L’impact de Lune-soleil sur moi, je dois l’admettre, fut conséquent. C’était davantage une grande curiosité avec des sympathies qui étaient en train de se développer. Mais la circonspection qui me devint consubstantielle provenait de mon expérience, puis de ma rupture avec le mormonisme, et plus encore de mes lectures de Jiddu Krishnamurti ; et elle sera désormais agissante en permanence.
Le 3 septembre, où je fis halte aux Éditions Arista me procurant entre autres deux volumes de la biographie de Krishnamurti par Mary Lutyens. Et le 19 septembre, je passais voir l’installation du chapiteau pour le forum du week-end. Marie-Hélène arrivait de Saint-Laurent-d’Olt, en fin d’après-midi, le vendredi 20 septembre pour un week-end très dense.
Samedi 21, au retour de Saint-Nicolas-de-la-Grave (Tarn-et-Garonne), de l’arboretum de Georges Gallier, nous participâmes à la soirée chants, rires, danses et poésie de Lune-soleil, soirée animée par Christian Tal Schaller et Madly Bamy, dernière compagne de l’artiste Jacques Brel.
Grande affluence et bel esprit pour le Forum Lune-soleil de la journée du dimanche 22 septembre. Les interventions du couple Meurois-Givaudan, de Madly Bamy, de Jacques de Panafieu[3], de Bernard Leblanc Halmos furent passionnantes comme la table ronde qui précédait, en fin de journée, la séance de dédicaces des intervenants ce qui nous autorisa d’approcher et d’échanger quelques mots avec la ravissante Madly Bamy.
Le 30 octobre et le 5 novembre je passerais faire des échanges de cassettes audio.
Les « Croissants de Lune » du dimanche matin présentaient aussi un intérêt certain. Ce fut le cas de celui du dimanche 17 novembre auquel j’assistais avec Franck. C’est, je pense, lors de cette réunion que je fis connaissance avec Maurice, Suzanne, leur fils Laurent. Chacun présentant son parcours personnel, mon expérience dans l’église Mormone et mon intérêt qui suivit pour Krishnamurti ne manqua pas d’interpeller l’assistance. Ce jour-là, quelque chose de spécial se produisit, une sorte d’élévation de conscience que j’ai notée dans mon journal. Nous partageâmes un repas végétarien succulent à La Terre de Jor qui m’apparut comme un lieu idéal. L’après-midi fut consacré à une conférence sur l’alimentation, suivie d’une soirée aux Rolphies avec Anne Dizin et Djamel.
 |
| Maurice CLAUDE |
Maurice Claude avait invité le dimanche 24 novembre suivant, un petit groupe dont j’étais avec ma voisine Éliane de Montanceix, à assister à une projection du film L’Ile Blanche qu’il avait réalisé. Nous étions à Guilme sur la Terre de Jor. Son habitation était surplombée par une salle de forme pyramidale qui servait à la méditation et à ses expériences de défragmentation de la lumière avec des prismes, des cristaux… Nous visiterons d’ailleurs ce lieu où circulait une énergie bien particulière. Il me semble me souvenir que Maurice avait été ingénieur en optique dans la région Rhône-Alpes. La projection du film fut un moment à la fois troublant et bienfaisant. À l’issue de la projection, Maurice nous demanda à chacun ce que nous avions ressenti. J’étais très gêné d’avouer que j’avais eu à me cramponner aux rebords du canapé car j’avais ressenti quelque chose d’étrange, comme si mon corps éthérique sortait de son enveloppe physique par un mouvement latéral au niveau des jambes. Depuis ma jeunesse et ma fréquentation d’Albert Gazier, guérisseur Rosicrucien, j’avais quelques vagues notions de ces choses et eu quelques expériences de décorporation… mais c’était un lointain souvenir dont je ne parlais jamais. On peut vite se voir taxer de schizophrénie ! Si les autres participants furent un peu ébahis, Maurice parut très intéressé.
Son allure pouvait le faire apparaître tel une sorte de mage. C’était probablement un initié ; il nous parlait de mondes supérieurs, d’interférences spirituelles, de vies antérieures, avec un grand calme. Je crois entendre encore sa voix éthérée qui semblait presque venir du Monde Invisible.
La soirée se passa avec Anne, Aura et Cécile autour d’une table chez Anne et Djamel à Plazac. Journée mémorable qui malgré les agitations d’Éliane me laissa délié et en paix.
Dans un état de grâce toute la journée du lendemain, je retrouvais la famille Claude au cinéma Vox de Montignac pour le film Always de Steven Spielberg.
Le 3 décembre, après ma journée professionnelle sur Sarlat, je ferais halte à Plazac pour y retirer deux cassettes d’enregistrements du Forum. J’y rencontrais Anne Dizin et Joseph puis au Millefeuille une des responsables de l’association Ricochet.
J’eus dans cette période par deux fois des échanges téléphoniques avec Maurice et même avec Laurent au sujet de son studio d’enregistrement.
Après avoir planté des roses trémières puis conversé sur la couleur des cristaux, un repas nous réunissait chez Maurice, le dimanche 8 décembre.
Le 13 décembre, en soirée, fut un moment bien particulier, au Sablou, à Fanlac, pour une séance de guérison holistique qui fit beaucoup de bien à Franck. Il connut une période de mieux notable. Nous terminions la soirée par un repas fraternel à La Terre de Jor.
Cette fois, sans Éliane, avec Franck, après un passage chez Maurice, l’assemblée des « Croissants de lune », du dimanche 15 décembre, fut perturbée par un intrus. De nouveau, nous prîmes un agréable repas avec une amie d’Anne Dizin, Nathalie, à la Terre de Jor. La conférence de l’après-midi fut consacrée aux Vierges Noires. J’étais également en relation avec Olivier Dizin, Jean-Paul Quentin et Maira.
Une émission de France Culture, du 20 décembre, sur le New Age refroidit mon enthousiasme et je notais « Bing dans le New Age ! »
Le mardi 24 décembre 1991, il y eut ce temps de vie et de rencontre, à Rouffignac, chez Thérèse, que j’avais totalement occulté : une soirée et un repas de Noël où je me rendis avec Franck, Jean-Michel, Éliane. J’y retrouvais Maira, Nathalie, Noël frère d’Anne Givaudan, Joseph, Sandy, Frank Rich et son amie. Puis ce fut juste après minuit un feu à Lune-soleil (comme ceux de la Saint-Jean) avec Maurice, Suzanne. Sans doute le Noël le plus inattendu de mon existence !
L’année 1991 et le tout début de l’année 1992 sont donc marqués par un retour au spirituel.
Le 10 janvier nous étions chez Marianne, au Sablou, pour une nouvelle séance de guérison holistique avec Franck. Nous prîmes notre repas à La Terre de Jor avec le docteur Londechamp. Une autre séance eut lieu le 7 février, toujours avec Franck, suivie par le repas à La Terre de Jor.
Puis, sans que je puisse trop en établir la raison, les raisons, une distanciation sans rupture se produisit dès le mois de février. Le jardin prit, il est vrai, une place centrale dans mon existence avec une recrudescence de relations. L’art, la peinture tinrent aussi une place importante, laissant moins d’espace pour d’autres rencontres.
Lors d’un passage le 4 août je ne trouvais personne à Lune-soleil et Anne Dizin n’était pas chez elle. Je revis Joseph, rapidement, le 1er septembre après ma journée à Sarlat.
Pour autant, Marie-Hélène m’accompagnait, comme en 1991, pour le Forum de Lune-soleil des 19 & 20 septembre 1992. Le samedi 19, nous eûmes un accueil un peu réservé et je n’ai noté aucune des conférences auxquelles nous avons assisté toute la journée ainsi qu’au beau concert de Morice Benin[4] en soirée. Le lendemain, je laissais, en matinée, Marie-Hélène seule assister au début du forum pour me rendre à la foire bio de la Chapelle-Aubareil. Retour au forum, pour repartir à La Chapelle-Aubareil où nous prendrons notre repas, avant de retourner assister à la dernière partie du Forum où j’ai noté l’intervention des Meurois-Givaudan : « Pardonnez-vous, pardonnez les autres ». Sur le retour, nous déposions un potimarron chez Thérèse à Rouffignac. Arrivés aux Rolphies, j’évoquais la revue de La Nouvelle Ère, une autre association sise à Sainte-Eulalie-d’Ans. De temps à autre, je passais-là pour y saluer André son animateur. Était-ce là un signe de déception ?
 |
| De gauche à droite : Marie-Hélène, Suzanne, Madeleine, Maurice, Alain |
Marie-Hélène était arrivée de la veille. Après un repas aux Rolphies avec Madeleine Marcoux et sa sœur, nous étions attendus à Plazac, chez Maurice et Suzanne ce samedi 26 février 1994. Des photos attestent de ce moment hors du temps où grâce à sa pratique des bols tibétains Maurice nous fit bénéficier d’une élévation du niveau de nos vibrations. Nous étions tous, il est vrai, dans une démarche de recherche spirituelle.
Le 17 décembre 1994, je retrouvais Henri Vessat aux Versannes et nous fîmes le voyage jusqu’à Plazac, passant devant le site de Lune-soleil pour se rendre à Guilme. Maurice et Suzanne nous accueillirent avec leur habituelle gentillesse. Après une discussion, nous participâmes à une séance de bols tibétains qui se révélait toujours un temps d’élévation vibratoire.
Des années s’écoulèrent…
Avec Marie Annick nous étions membres de l’association Amis-Amigos qu’animait, entre autres, notre amie Marie Rose Théophile. Le dimanche 5 juin 2011, l’association avait projeté une sortie sur le secteur de Saint-Léon-Sur-Vézère où nous prîmes notre repas. Auparavant nous avions visité le château de Reilhac, à Tursac. Après le repas nous fîmes le tour du château de Saint-Léon-Sur-Vézère. Après la visite de l’église et du château de Sergeac nous reprenions notre liberté. Avant de rentrer sur Périgueux, nous fûmes d’avis de passer sur la Côte de Jor. Après une visite à Dhagpo, je ressentis le désir de revoir Maurice et Suzanne, de les faire connaître à Marie Annick, sans savoir s’ils nous recevraient. Un peu à tâtons nous arrivâmes à Guilme. L’accueil fut chaleureux, comme si aucun temps ne s’était écoulé. C’est ainsi que Marie Annick découvrit ce lieu inspirant et ce couple attachant. Elle était conquise et moi heureux d’avoir retrouvé Suzanne et Maurice comme si le temps s’était immobilisé depuis 1994.
 |
 |
|
| Maurice & Marie Annick, 9 septembre 2012 | ||
Le dimanche 9 septembre 2012, en compagnie de Marie Annick, après un passage à Dhagpo où nous accomplîmes le pèlerinage complet autour du temple, nous nous avançâmes après avoir pris rendez-vous avec Maurice, jusqu’à Guilme. Nous eûmes la tristesse d’apprendre que Suzanne venait de disparaître. Suzanne était la discrétion même, on peut même dire qu’elle incarnait l’effacement, la douceur, la gentillesse. Son absence était comme une incommensurable incomplétude. Maurice désirait s’entretenir avec Marie-Annick sur sa vie et son passé. Afin de les laisser en tête-à-tête, je quittais la pièce et partis faire, en solitaire, un tour dans les bois environnants. Marie Annick retira, à ses dires, un grand profit de cet entretien.
 |
| Maurice Claude et Marie Annick, 28 avril 2013 |
Le dimanche 28 avril 2013, avec Marie Annick, nous eûmes le désir de rendre à nouveau visite à Maurice. Ce fut notre ultime rencontre en commun avec lui. Marie Annick lui fera, seule cette fois, une visite ultérieure. La solitude et l’état de santé préoccupant de Maurice faisaient peine à observer. Sans doute le rejet de toutes croyances et spiritualités dans mon cursus bloqua la réception des énergies générée par la séance de bols tibétains. Je sortis donc de la salle. Personnellement, j’étais bien trop dubitatif pour pouvoir accéder à ce que je ressentais être, peut-être à tort, comme une extravagance ou un délire ésotérique. C’était, même s’il est difficile de tricher par amitié ou compassion, peu empathique de ma part. Que dirait-il aujourd’hui où je fais tournoyer mes épées verbales contre un Dieu déchu ou mort. Il y eut là comme une brèche entre nous. Marie Annick fut particulièrement réconfortée par cette troisième rencontre.
Les tentatives de reprendre contact téléphoniquement en 2018 furent vaines, la santé de Maurice ne lui permettait plus de recevoir à Guilme.
Il n’est pas anodin de noter que ma rencontre avec Lune-soleil et Maurice Claude se situe après le deuil terrible que j’avais vécu, fin février 1991, avec le suicide de mon père. Dans ces périodes de choc émotionnel, la recherche de réponses à d’insolubles questions n’est pas surprenante, même si elle est inconsciente. Et il n’est pas anodin non plus que ma reprise de contact avec Maurice se soit produite après la série de disparitions douloureuses de l’année 2010, au moment de mon départ à la retraite.
Je ne conserve que de bons souvenirs de ce temps, que la suractivité des années qui suivirent, me fit un peu oublier. De retracer ce temps de vie fut comme une redécouverte de ce que j’avais vécu avec ces personnes, même si les activités n’étaient pas toutes de même intérêt. Cependant un seul demeure inoubliable dans ma mémoire comme dans mon cœur : Maurice… personnage hors du commun, porteur de paix, de douceur et d’énergie. Il est sans doute une des plus belles âmes que j’ai rencontrées dans ma vie. Je lui associe son épouse Suzanne, car elle était la sublime incarnation de la simplicité et de la modestie. Ils sont les seuls qu’une vie entière, fabuleusement éclectique, ne puisse effacer. Sans bien comprendre les messages de Maurice, de ce qu’il a tenté de partager avec moi, je crois que je les aimais, que je les respectais. Cette maison restera dans ma mémoire jusqu’à la fin de cette vie et qui sait même, il se peut, au-delà !
Demeure, l’image que je garde du frêle, presque transparent Laurent, leur fils, de son studio d’enregistrement. Je crois qu’il était l’image la plus absolue d’un être irréel, désincarné, d’un ange. Avec de tels parents on est appelé à la sainteté dès la naissance. ♦
[1] Mary Lutyens, biographie de Krishnamurti en 3 volumes : Les années de l’éveil, Plazac, Éditions Arista, 1982 ; Les années d’accomplissement, Plazac, Éditions Arista, 1987 ; La porte ouverte, Plazac, Éditions Arista, 1989.
[2] Christian Tal Schaller, est un médecin, essayiste et conférencier suisse. Le docteur Christian Tal Schaller est l’un des pionniers de la médecine holistique européenne. Conférencier international, auteur de plus de vingt ouvrages consacrés à l’éducation de la santé, il parcourt le monde avec son épouse, Johanne Razanamahay, pour montrer à tous ceux qui veulent sortir du subir et du souffrir les moyens naturels permettant de vivre dans le bien-être, à tout âge et en tout lieu.
[3] Jacques de Panafieu (1930-2001) est à l’origine de la création des Ateliers du Changement, psychothérapeute lié au Rebirth.
[4] Lucien Nicolas présente ainsi l’artiste : « Benin sait écrire des chansons et sait chanter. Mieux que ça, il chante, et quand il chante ça sort profond, avec des pleins et des reliefs, avec des réserves de fraternité, de passion et d’humour. Ce serait assez pour la surprise et l’émotion, mais, derrière le bonhomme qui chante, il y a encore autre chose, il y a ce qu’il dit. Car s’il paraît impossible de chanter comme ça sans être sincère, ce qui est dit prend alors beaucoup d’importance… ». Facebook : https://www.facebook.com/moricebenin.
Du 23 au 30 mars 2020
Confiteor, confinement, Claudine
Entre l’Ange Moroni qui perd sa trompette au sommet du Temple Mormon de Salt Lake City, la Vierge qui n’apparaît plus nulle part et un Dieu absent lorsque tout va mal, on se demande à qui accorder sa confiance spirituelle ? Ni droite, ni gauche s’avère encore plus gauche que la droite impure ou que la gauche à vomir porteuse de toutes les trahisons. La coalition bien secouée de tous les corrompus, dans le shaker du maître queux Macron, se révèle la pire des horreurs et des indécences.
Après bien des recherches au cours du temps, un cheminement de curieux, d’investigateur, d’inquisiteur parfois, m’a rendu incrédule. Ainsi, ai-je choisi de n’accorder ma confiance à quiconque ; car pour du fric, tous sont prêts à faire du mensonge la vertu première.
En pleine épidémie de coronavirus, on observe comment les tergiversations gouvernementales devenant obstruction criminelle, dissimulant à peine un outrageant intérêt personnel, conduisent à la mort nombre de nos compatriotes. On n’hésite pas ! Et a-t-on jamais hésité à abandonner, détruire, tuer, pour s’enrichir toujours ? Souvenez-vous de la lettre d’Anatole France adressée au directeur de l’Humanité, le 18 juillet 1922 : « … Cette fois, l’ignorance des victimes est tragique. On croit mourir pour la patrie; on meurt pour des industriels. Ces maîtres de l’heure possédaient les trois choses nécessaires aux grandes entreprises modernes : des usines, des banques, des journaux… »
Ce temps de claustration ne me perturbe pas outre mesure, pour correspondre, en plus distendu, à mes traditionnelles occupations jardinières du début du printemps. Ainsi à la manière de Pline le Jeune je pourrais avouer : « Aucune attente, aucune crainte ne me trouble, aucune rumeur ne m’inquiète : mes seuls interlocuteurs, ce sont mes livres et moi-même. »
Mais l’ampleur des victimes du covid-19, l’incapacité éthique et médicale de ce gouvernement, instaure une peur diffuse qui n’est peut-être pas un péché par omission ! Alors que tous ces anciens en attente d’une fin paisible étaient majoritairement des électeurs favorables à leur bourreau. Erreur donc de stratégie.
Et même en ce temps très inhabituel, ce qui heurte le plus, c’est l’incessante érosion des relations que j’eus en nombre, il est vrai.
 |
Aujourd’hui dimanche 29 mars, Khadra me raconte la disparition de sa voisine, Claudine, âgée de 70 ans. Séparée de son mari, ayant fait vœux de pauvreté et de prière, très croyante, elle vivait aux frontières de la misère, se consacrant à aider les SDF, les pauvres, les isolés, dont elle était elle aussi par choix. Une fois, je l’avais accompagnée sur les rives de l’Isle, où vivait dans une précarité assumée, un SDF prénommé Alain. Elle a engagé des démarches pour le faire héberger dans un centre d’accueil, pour la mauvaise saison qui s’annonçait.
Après le décès de son conjoint, elle est venue habiter son appartement, dans les HLM du Bas-Chamiers. Elle était voisine de Khadra et avait accueilli avec joie, samedi 21 mars, la nouvelle de sa rémission d’un cancer du poumon, ayant beaucoup prié pour elle. Lorsque la police et les pompiers sont intervenus, hier, sans doute alertés par son fils qui demeure à Bordeaux et ne pouvait la joindre au téléphone, elle était décédée sans doute depuis lundi soir.
On meurt aussi de solitude en ces temps effroyables.
Tombe la neige, de quoi glacer un peu plus les cœurs.
Dans son Journal, Jean Chalon notait le 9 janvier 2010 : « Il a neigé cette nuit et il va encore neiger dans la journée. J’ai hérité de ma mère son horreur de la neige. Je ne répéterai jamais assez que tout ce blanc me donne des idées noires[1]. »
C’est aussi en ces temps troubles que resurgissent tous les travers petits-bourgeois de ceux qui n’ont de conviction que celle du confort de leur arrière-train avec, pire encore, des manifestations dignes du temps de la collaboration, des pires heures du pétainisme, dont l’insuffisante épuration laisse jusqu’à nos jours des traces insalubres. ♦
[1] Jean Chalon, Journal d’un ours 2008 à 2011, La Vancelle (67730), Éditions du Tourneciel – collection le Chant du merle, 2015, p. 108.
Du 17 au 21 mars 2020
Giboulées de mars
George Sand avait cette formule : « noircir bien du papier pour me dénoircir l’esprit. »
On aimerait savoir qui est probe, irréprochable, parmi tous ces baladeurs, arnaqueurs, tricheurs de tous horizons : religieux, politiques… ?
Se moquer ainsi du monde, en ce temps où la conscience populaire s’élargit est très dangereux et ferment constant de violences.
Mon expérience professionnelle fut suffisamment instructive pour m’avoir prouvé que si la hiérarchie autrefois pouvait avoir une forme de supériorité, l’arrivisme (faire une carrière et non plus son métier) qui s’est constamment développé ensuite a mis en avant et au premier plan de véritables cancres, crétins, amateurs et incapables notoires, voire d’authentiques bourrins !
Avec le covid-19, l’impréparation de la France, un président dont la vanité fait surgir un amateurisme irresponsable et coupable, malgré l’apparition très attendue du beau temps, flingue le présent qui n’est plus tout à fait « le repos de la retraite, en attendant le repos éternel[1] ». L’âge n’exclut pas le tangage et les menaces de sérieux inconforts, si ce n’est pire !
Un président qui après avoir fait preuve de légèreté (il se croit toujours et sans fin au-dessus de tout), aurait sans doute été bien inspiré d’éviter de marteler le terme de GUERRE, même s’il y a bien une guerre bactériologique. Lorsqu’on panique les moutons ça ne donne rien de bien et ces foules devant les supermarchés sont idéalement propices à la diffusion du virus. Personnellement j’achète ce dont j’ai besoin comme chaque semaine. J’ai non seulement la chance mais la nécessité de travailler au jardin. Lire, écrire, téléphoner à la famille concoure à LA DÉCROISSANCE HEUREUSE, ce qui me semble une vision aujourd’hui indispensable et salutaire. Nous verrons que dans cette pandémie très sérieuse il y aura un retour, pour certains, à l’essentiel, évidemment pas pour les abrutis, on s’en doute. Nos vies sont trop souvent l’expression d’agitations inconsidérées, parfois stupides.
À une amie sur Facebook, je disais que la chance est quelque chose de fluctuant. Ainsi, un événement qui semble positif peut devenir une épreuve ; au contraire ce qui semble inquiétant ou désastreux peut devenir dans le temps une chance. Aujourd’hui mon jardin est une chance, demain il se peut qu’avec une sécheresse implacable, une tempête, il se présente comme une catastrophe. Si ce que nous avons : toi, ce petit bonhomme qui est le plus grand bonheur du monde et moi cet espace merveilleux, nous apporte du réconfort et de la joie, alors tout n’est pas en définitive si mal pour l’un comme pour l’autre. Trop d’enfants n’ont pas de relation réelle avec leurs parents, aimer son enfant tout en l’aidant à prendre ses ailes et il sera construit pour être fort en face de l’adversité qui ne manque jamais de survenir.
Carl Gustav Jung considérait que « Les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. »
« Cette crise nous montre que la mondialisation est une interdépendance sans solidarité. Le mouvement de globalisation a certes produit l’unification techno-économique de la planète, mais il n’a pas fait progresser la compréhension entre les peuples. Depuis le début de la globalisation, dans les années 1990, guerres et crises financières ont sévi. Les périls planétaires – écologie, armes nucléaires, économie déréglée – ont créé une communauté de destin pour les humains, mais ceux-ci n’en ont pas pris conscience. Le virus éclaire aujourd’hui, de manière immédiate et tragique, cette communauté de destin. En prendrons-nous enfin conscience ? Faute de solidarité internationale et d’organismes communs pour prendre des mesures à l’échelle de la pandémie, on assiste à la fermeture égoïste des nations sur elles-mêmes » observe Edgar Morin.
Dans la thérapie apaisante et méditative qu’exercent sur moi mes lectures, je découvre quelques surprises ou événements piquants.
Par exemple, à la date du vendredi 1er octobre 2004, jour faste et célébré comme tel, Chalon qui connaît l’artiste José Correa pour être tous les deux des proches admirateurs et défenseurs de François Augiéras, note dans son journal : « Le téléphone sonne. C’est le peintre José Correa qui me propose de faire un album, pour les éditions de La lauze, avec mes quatre déesses, selon leur ordre d’entrée dans ma vie, Lola Flores, Colette, Natalie Barney, George Sand. J’accepte[2]. »
Mes sœurs, cousines, cousins, amis requièrent mon attention dans ces temps plus troublants. Nos échanges délogent un temps la solitude contraignante du confinement. Tout se passe bien, même si j’observe quelques angoisses ou frustrations. Annick par exemple ne voit plus ses deux petits-fils. Pierrette aperçoit seulement ses petites-filles d’un peu plus près. La tendresse se résume à des mots et des signes. Nous voici tous consignés à un autisme pas toujours bien vécu.
Le père de Lionel a subi avec succès, jeudi en soirée, son intervention attendue du cœur : deux mois d’insécurité et enfin le soulagement. Par contre René, l’oncle de mon beau-frère, lui s’en est allé, jeudi matin, entouré, jusqu’au cimetière de Bonneville, par son épouse et sa fille.
Ce gouvernement ne cesse d’écœurer la France par ses inconséquences, sa lâcheté, son amateurisme permanent, sa constante arrogance culpabilisante. Il ne semble pas vraiment dérangé par les appréciations peu flatteuses de la presse étrangère. Même le premier tour des élections municipales de dimanche dernier, qui les sanctionne clairement, ne semble pas faire ravaler au navet présidentiel, totalement creux, sa superbe ! Germaine Beaumont usait pour ce genre de personnage d’une formule très appropriée : « Car un navet, même camouflé en fruit exotique, reste un navet. »
On me connaît peu royaliste ou légitimiste, bien au contraire, mais cette pensée du prince de Ligne me convient : « Je suis heureux d’être content de tout et de pouvoir me passer de tout. »
[1] Jean Chalon, Journal d’un ours 2008 à 2011, La Vancelle (67730), Éditions du Tourneciel – collection le Chant du merle, 2015, p. 77.
[2] Jean Chalon, Journal d’un lecteur 2002-2004, Paris, Plon, 2007, p. 208. L’album paraîtra aux Éditions de La Lauze (Périgueux), en février 2005.
8, 11, 12 mars 2020
Peur, pluie et larmes
« Et puis, au milieu de mon angoisse, de petites choses se précipitent pour l’exacerber : la nostalgie de toutes les choses que j’ai vécues, les personnes disparues que j’estimais et qui furent affectueuses avec moi. Il n’y a pas que ça : je souffre des coups que j’aurai inévitablement à subir, comme par exemple, la mort fatale et prochaine de quelques personnes que j’estime profondément et qui sont âgées[1]… »
Madeleine nous quittait dimanche matin. Cette hémorragie mortelle d’amis, de relations : Meg Jones, Pierre Jouin, Madeleine Marcoux, s’inscrit comme l’achèvement d’une période faste autour de mes 45 ans où j’étais entouré d’un grand nombre de belles personnes dont beaucoup sont parties entre 1997 et 2015.
Le temps détestable, irrémédiablement – dans cet adverbe, on découvre la présence de ‟diablement” ; on se prend à véritablement y croire ! – pluvieux et venteux, confine l’atmosphère dans une moue désobligeante amplifiée par la menace mondiale d’épidémie de coronavirus !
|
|
| Madeleine Marcoux |
Et comment n’aurais-je pas ressenti ce vide devant le cercueil de Madeleine ce jeudi 12 mars au crématorium Virgo. Elle était là, dans le secret, entourée d’une petite poignée de personnes, le descendant d’un des fils de Paul Marcoux, et d’Éric, son petit-fils et son épouse et enfin des amis de la ligue protectrice du monde animal. Dany Correa en beauté (l’âge n’a aucune prise sur elle) et moi vestige d’un temps tellement heureux, inoubliable… que je saurai conter, afin de raviver la flamme des heures de lumière ! Là-haut sur la colline de l’Étang aux daims, à Villejalet, vivait une belle personne, charismatique, généreuse et immensément douée. Ses toiles naïves ou allégoriques enchantent le regard de ceux qui ont une âme.
C’est à la fois triste et tellement enseignant aussi que je puisse arriver à me retrouver seul pour affronter ces deuils répétés. Le temps des amis d’exception est achevé. J’en ai une claire conscience, non amère, mais renseignée, éclairée. « Il n’y a pas d’amitié, il n’y a que des preuves d’amitié » disait Jean Cocteau. Ce qui remplace désormais cette douce utopie que j’ai cultivée avec passion, et que je n’avais point imaginé, c’est ce que ma sœur Christine estime essentiel : « les liens du sang ! »
J’ignorais encore avant-hier s’il me restait une seule amie vivante parmi tous ces alliés fabuleux dont je dis qu’il faut les mériter. En ai-je eu assez de ces témoignages pour accepter de croire que je les ai mérités ? Je recevais d’Azucena Wainer, née en Argentine, un lien pour accéder à une étude de Connaissance des Arts, sur un joyau d’architecture hispano-mauresque redécouvert à Madrid. Dissimulé sous le stuc de centaines d’années, un caisson en bois de style mudéjar a refait surface dans l’église Santa Maria la Blanca.
 |
| Azucena & Joan, Jumilles 2012 |
Avec mes remerciements, j’osais lui demander des nouvelles de celle que je présumais être l’unique survivante de ces temps enchanteurs, Joannes Antoinette van Limburg Stirum qui veut que nous l’appelions Joan ! Voici la réponse d’Azucena : « Joan va bien, malgré un petit accident qui lui a causé une douleur quasi permanente à une jambe. Elle a fêté ses 98 ans le 27 février dernier avec 30 personnes entre amis et voisins de l’estancia (Estancia San Pedro, Correa, Santa Fe, Argentine). Si vous avez un numéro WhatsApp je peux vous envoyer une petite vidéo faite à cette occasion ainsi que des photos.
Meg est partie ! C’est triste. Je ne savais pas qu’elle était si âgée. Comme vous le dites, ce temps heureux et lointain s’achève. »
Nous aimons, croyons aimer, mais nous posons-nous la question de savoir ce que ressentent pour nous ceux que nous aimons bien ? Nous aiment-ils en retour ? Avec les décès de Meg, de Madeleine, j’apprends par des personnes, qui m’étaient inconnues, que mon nom était prononcé avec tendresse et affection par l’une comme par l’autre. Il est vrai que j’avais de l’affection pour elles, mais il me faut admettre qu’elles en avaient aussi pour moi. Rencontres bienfaisantes entre pèlerins durant l’énigmatique traversée terrestre.
 |
En découvrant le Journal d’un ours (2008-2011) de Jean Chalon, si longuement indisponible dont j’ai attendu la livraison plus d’un mois, comment ne serais-je pas d’accord avec lui lorsqu’il écrit : « Il n’arrête pas de pleuvoir… peut-être que cette pluie permanente explique ma tristesse ? Heureusement que les livres sont là. Les livres sont des parapluies, si j’ose écrire, que l’on ouvre pour se protéger de la pluie et de la tristesse. Les livres, les vrais, ceux qui, depuis des siècles, continuent à dormir sur des étagères, en attendant de ressusciter sous le regard d’un lecteur[2]. »
Jean Chalon ne cache pas sa prédilection pour les mémoires (Saint-Simon), les journaux (Jules Renard), les correspondances (George Sand) et pour étayer son propos, il cite Jean Cocteau : « La vie épistolière ressemble à celle du sommeil. Elle se déroule en marge des œuvres et des groupes. Soudain elle se montre après la mort… Les lettres commencent à vivre dans l’inactualité. Elles y puisent, par quelques prodiges, une actualité toute neuve. Écrivez, conservez les lettres. Relisez-les. Laissez-les travailler dans l’ombre[3] ».
Peut-être, parce que j’y ai ressenti comme une réminiscence de Nous avons fait un beau voyage, de la Ciboulette de Reynaldo Hahn, j’ai adoré ce passage noté au dimanche 8 juin 2008 : « Entre deux averses, nous avons pu marcher pendant trois quarts d’heure et nous avons rencontré un lilas de Perse, des genêts et des lavandes[4]… »
Au-delà des ombres inquiétantes du covid-19, nous allons miser sur juin 2020 et dire avec Jean Chalon : « La lumière de juin me pénètre enfin et m’arrache au royaume des morts[5]. » ♦
[1] Mário de Sá-Carneiro, Lettres à Fernando Pessoa (Lettre de Paris du 16 novembre 1912), Falaises, Éditions Impeccables, 2015, p. 22.
[2] Jean Chalon, Journal d’un ours 2008 à 2011, La Vancelle (67730), Éditions du Tourneciel – collection le Chant du merle, 2015, p. 18.
[3] Ibid., p. 18-19.
[4] Ibid., p. 19.
[5] Ibid., p. 21.
7 mars & 8 mars 2020
Les lumières de la fête
Une à une s’éteignent les lumières de la fête… Bientôt il fera nuit noire.
Chaque astre qui, à sa manière, illuminait nos vies, s’éteint, disparaît de notre ciel qui fut pourtant si richement étoilée.
Offenbach, fin 1880, au seuil de la mort, le chantait dans Belle Lurette :
Demain affiches nouvelles,
Aujourd’hui plus rien à voir.
Adieu, les amis, adieu, bonsoir !
On va souffler les chandelles.
La cérémonie dans le vaste cimetière de Saint-Astier, entre deux giboulées, était d’une grande simplicité, je dirais même d’une grande humilité. Elle était donc à l’image même de cet homme dépouillé de vanité, une anti-thèse de ce siècle défiguré par une arrogante prétention, adepte de l’apparence triomphante et mensongère.
Le choix du laurier, du romarin, du blé à déposer sur le cercueil correspondait aux valeurs, à la passion fusionnelle de Pierre avec la nature et ses symboles. Ce qui me fit souvenir d’une récolte de sommités fleuries de Reine des près, cueillette de grande abondance dans les prairies traversées par le ruisseau qui coule entre Saint Aquilin et Saint Germain-du-Salembre.
Au retour du marché de Neuvic où je n’étais plus apparu depuis des semaines, je m’arrêtais à Saint-astier saluer celui dont je ne reverrai plus le visage souriant, heureux de retrouver ses nièces et son vieux copain et de saluer toutes ses connaissances à travers les étals.
Pour autant, et le temps incertain qu’il reste, il me faut adopter cette devise de George Sand : « Le bonheur, c’est l’acceptation de la vie quelle qu’elle soit », et peut-être le remède aux chagrins répétés : « Le travail guérit de tout. » Ce dernier constat, je l’ai expérimenté bien des fois et, comme Sand une fois encore, « l’âge m’a appris qu’on ne s’arrête pas » !
Pierre était consubstantiel avec la nature, les animaux sauvages avec lesquels il trouvait des ententes proprement inouïes, apprivoisant à force d’attention et de respect des races qui possèdent, à juste titre, une défiance génétique vis-à-vis de l’homme.
Le spectacle de la nature, vaut plus et mieux que tout : « comédie des papillons, ballet des tourterelles, concert de pies qui semblent avoir des castagnettes à la place du bec, et tragédie d’une libellule blessée qui expire en un ultime battement d’ailes, à même le sol[1]. »
Ainsi, peut-être, plus tard dans le temps, je dirai rêveur : « il restait là encore des lucioles pour éclairer la tristesse des jours. » ♦
[1] Jean Chalon, Journal d’un lecteur, Paris, Plon, 2007, à la date du jeudi 8 juillet 2004, p. 190.
Jeudi 5 mars 2020
Merci Pierre d’être venu !
Il m’a fallu m’avancer aux Pompes funèbres Limon, pour accepter de croire que Pierre n’était plus là, lui que je voyais fêter ses 100 ans tant il avait longuement été l’expression de la vigueur et d’une inaltérable santé. Mais 4 jours seulement avant son quatre-vingt-dixième anniversaire, il s’en est allé.
Je lui avais rendu visite, en fin de journée, vendredi 7 février après celle que je fis au camarade Georges Ridoin, en convalescence à l’hôpital de Saint-Astier. Je l’avais trouvé en petite forme, et le lendemain matin, son infirmière le trouvait par terre, fiévreux, lors de sa visite. Rien n’allait plus après son hospitalisation, par ailleurs, la même semaine que celle de sa sœur. Le frère et la sœur étant comme deux doigts d’une main, on pouvait craindre que de mauvais jours s’annoncent. C’est mercredi soir que j’appris la funeste nouvelle.
Notre collègue Thierry était moins dupe que moi sur la dégradation de santé de Pierre ; en effet nous nous réunissions une fois par an, autour d’une table, pour évoquer le temps jadis. Et celui qui ne voyait Pierre qu’une fois par an, pouvait observer son déclin. Nous qui nous voyions presque tous les jeudis, jours de marché, nous étions habitués aux dégradations qui survenaient, probablement en les minimisant, lui avec nous, car il manifestait un rejet absolu des altérations que la vie nous impose à tous d’une manière ou d’une autre, refusant l’idée de disparition.
N’était-il pas une sorte de guérisseur comme le fut Albert Gazier à Douchapt ? Il était convaincu, dans la lignée de son grand-père qu’il admirait, que seule la nature était propice à nous bien soigner. Mais comme Albert, il reconnaissait que dans la multitude de ses fiches de remèdes miracles, il n’en possédait pas un seul qui lui soit applicable.
 |
| Pierre à son bureau |
Né en 1930, lorsqu’il arriva à la Direction du Travail à Périgueux, nous n’y étions pas encore, mais de sa génération il était incontestablement le plus consensuel, populaire et apprécié. Tous, sans exception, conservent un heureux souvenir de lui. Notre collègue Roselyne Bordas m’écrivais : « J’aurai une pensée émue pour notre Pierre qui, malgré sa grande discrétion, était dans nos coeurs. ». Madame Lalande, partie bien trop tôt, le qualifiait d’extra-terrestre, car il n’avait jamais chaud en été, ni froid en hiver ! Yvan Crespin, Thierry Naudou, Serge Lopez, Jean Bessière, devenus directeurs s’enquerraient de ses nouvelles. Nos collègues secrétaires, les filles de la Cotorep, chacune était curieuse de ses habitudes et singularités parfois amusantes et appréciait ses talents pour chanter les charmes féminins. Jean-Michel et lui se rencontraient régulièrement autour d’une bonne table. Il s’était construit un petit royaume de gentillesse et de fraternité qui a perduré dans les mémoires longtemps après son départ.
 |
| Pierre et le château d’Issac, 2010 |
Étant venu habiter à Montrem, nous devenions plus proches géographiquement pour nous voir, pour se balader, échanger des idées. Nous étions en parfaite synchronisation sur le plan politique et social, nous aimions la nature, la vie saine, les médecines douces, lire, pas vraiment les mêmes livres, mais les livres, à partir desquels on se trace des vies parallèles sur les ailes du rêve. Nous étions deux esprits poétiques, ce qui fit que, depuis 1970, se développa au cours du temps une sympathie marquée. J’ai connu sa mère que j’appréciais beaucoup, sa sœur, son beau-frère, son frère parti trop tôt, sa veuve Georgette et ses nièces qui lui étaient dévouées et l’ont accompagné aux rendez-vous médicaux auxquels il se rendait à contrecœur, que ce soit à Périgueux ou à Bordeaux.
|
|
| Dans le jardin de Pierrette et Maurice Biret, Neuvic, 2010 |
La famille était sacrée pour lui. Les rituels familiaux ne souffraient aucun report. Le rite des repas du dimanche chez sa sœur et son beau-frère, à Neuvic, était une tradition intouchable. Le décès de son beau-frère a bien été la fin de ce temps inscrit dans la permanence, l’immuable, une manière de faire fi du temps qui passe. Les soucis de santé de sa sœur devenaient une nouvelle source d’inquiétude et d’insécurité, même si ses nièces, Monique et Francine, compensèrent au mieux pour que cette tradition puisse se proroger… c’était la barque des beaux jours glissant au fil de l’eau…
 |
| Pierre est le second à gauche au premier rang, 1952 |
Le sport lui était naturel, dans ses jeunes années, il s’adonnait au rugby à Saint-Astier, il fut l’entraîneur de l’ex-maire Jacques Monmarson. Traverser la rivière à la nage pour aller flâner sur ses îlots lui était coutumier. Il affectionnait la bicyclette sur laquelle on le voyait arriver chaque jour au centre de Saint-Astier, fin janvier de cette année encore, sans parler de ses escapades en plein été jusqu’à l’abbaye d’Échourgnac.
Est-il un seul habitant de ce pays pour dire qu’il ne connaît pas Pierre l’affable, le compagnon fidèle, discret, bienveillant, guérisseur des maux et des solitudes, poète rêveur des espaces sauvages entre Isle et Dronne ? Pierre me taquinait car je lui disais que je n’avais pas peur de la mort, seulement de celles des autres et de la dégradation physique qui souvent la précède.
Pour nous réconforter en ce temps de séparation, je dirai que Pierre n’aura pas eu à subir de dépendance avant de s’en aller. Libre comme l’air, il l’aura été durant toute sa trajectoire, c’est un luxe dont très peu d’entre-nous peuvent se prévaloir. Il a bien vécu, laissant ce qui est insoluble à résoudre à de plus tourmentés ou inquisiteurs. Il a pris la vie comme un don qu’il faut savoir apprivoiser et s’approprier !
Pierre appréciait la solitude, il aurait pu dire avec Pablo Neruda : J’aime la tranquillité plus que toutes les choses de ce monde. Je perçois dans les quiétudes des choses, un chant immense et muet[1].
Homme parmi les hommes, dénué de prétention, des vanités du monde, simple et content, tu l’étais ! Je peux l’attester, et je le dis non sans une fière admiration. Pierre nous ne saurions t’oublier, car tu fus avec subtilité et discrétion, notre instructeur sur la part de liberté dont nous pouvons encore nous saisir et jouir en ce pauvre monde. Merci Pierre. ♦
[1] Pablo Neruda, Les Cahiers de Temuco, 1918.
Février 2020
Vendredi 28, samedi 29 février 2020
Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa
Une amitié fertile et tragique
Le poète ne sait que feindre
Il feint si complètement
Qu’il va même jusqu’à fendre
La vraie douleur qu’il ressent[1].
Un des biographes de Fernando Pessoa, José Blanco, né en 1934, nous a gratifiés sous le titre de Pessoa en personne, d’une étude suivie d’un choix de correspondance publiée en traduction chez Minos-La Différence, à Paris, en 2003. Dans son introduction, il aborde le thème de la « Sincérité » chez le poète.
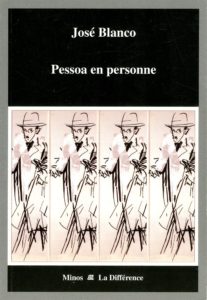 |
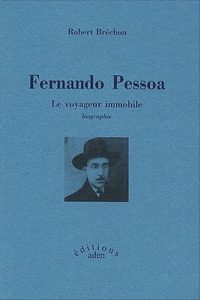 |
|
Mário de Sá-Carneiro[2] (1890-1916), poète et écrivain portugais incarnant le courant symboliste et celui de ‟L’école du désenchantement”, lié à Fernando Pessoa, se suicidait[3] à Paris, le 26 avril 1916, dans l’hôtel de Nice au pied de Montmartre, rue Victor-Massé, à l’âge de 26 ans.
 |
| Mário de Sá-Carneiro |
Dans une lettre inachevée de Pessoa, destinée à son ami[4], écrite le jour même du suicide de ce dernier, il n’est pas possible de douter du violent pressentiment de Pessoa chez qui la détresse ne semble pas un vain mot ou une attitude de l’esprit. Pessoa après avoir exprimé son trouble suite à l’attaque d’apoplexie de sa mère, aborde leur relation :
« S’y ajoute la grande douleur que vous m’avez causée – sans le vouloir bien sûr – avec votre terrible crise[5] (les dernières lettres de Mário de Sá-Carneiro, dont celle datée du 18 avril 1916, adressée à son ami, sont très sombres et annoncent même son suicide[6]). Je ne sais si vous comprenez bien à quel point je vous aime, combien je vous suis dévoué et attaché. Le fait est que votre grande crise fut aussi la mienne, et que je l’ai sentie non seulement dans vos lettres, mais bien avant, télégraphiquement, par la « projection astrale » (comme « ils » disent) de votre souffrance. »
Dans une autre lettre adressée à son ami Mário de Sá-Carneiro, datée du 14 mars 1916, Pessoa exprime des sentiments dont on ne peut guère mettre en doute la profonde sincérité et qui de plus s’expriment en un style subtilement imagé :
« … Je suis dans un de ces jours où je n’ai jamais eu d’avenir. Il n’y a qu’un présent immobile, avec un mur d’angoisse tout autour. L’autre rive du fleuve, du fait même qu’elle est de l’autre côté, n’est jamais celle d’ici ; et telle est la raison profonde de toute ma souffrance. Il y a des bateaux pour bien des ports, mais aucun pour là où la vie ne fait pas mal, ni d’endroit où débarquer pour oublier. Tout cela est arrivé il y a bien longtemps, mais ma peine est plus ancienne.
Les jours où mon âme est comme aujourd’hui, je sens bien, dans toute conscience de mon corps, que je suis l’enfant triste maltraité par la vie. On m’a mis dans un coin, d’où l’on entend jouer les autres. Je sens, dans mes mains, le jouet cassé qu’on m’a donné par dérision ; en ce 14 mars, à neuf heures dix du soir, ma vie a tout de bon ce goût-là. […] Si je ne mets pas cette lettre à la poste demain, il se peut qu’en la relisant, je prenne la peine de la copier à la machine, afin d’en reprendre des phrases et des digressions dans Le Livre de l’intranquillité[7]. Mais cela n’enlève rien à la sincérité avec laquelle je l’écris, et à la douloureuse nécessité où je me sens de l’écrire[8]… »
 |
| Fernando Pessoa©José Correa |
Après ce drame, le 4 mai, Pessoa adressait une lettre à Armando Côrtes-Rodrigues[9] :
« Mon cher Côrtes-Rodrigues, je ne vous ai pas écrit. J’ai traversé une énorme crise intellectuelle. Et maintenant je vais encore plus mal avec l’énorme tragédie qui nous frappe tous. Sá-Carneiro s’est suicidé à Paris le 26 avril. Je n’ai pas la tête à vous écrire, mais je veux tout de même vous le communiquer. Il est clair que la cause du suicide est ce tempérament qu’il avait, et qui devait fatalement le mener là. Il y eut aussi, bien entendu, une série de perturbations, qui furent les causes occasionnelles de la tragédie. Il s’est suicidé à la strychnine. Une mort horrible. Il avait déjà voulu se suicider trois fois – la première le 3 avril. Quel grand malheur ![10]… »
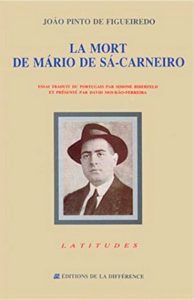 |
À propos de la crise et de la fin tragique de Mário de Sá-Carneiro, le 24 juin 1016, il confie dans une longue lettre adressée à sa tante Anica[11], ses dons de médiumnité :
« … Vers la fin de mars (si je ne me trompe) j’ai commencé à être médium. Figurez-vous ! Moi qui (vous devez vous en souvenir) étais un élément retardataire au cours des séances de semi-spiritisme que nous tenions[12], je me suis mis tout à coup à l’écriture automatique. Un soir, j’étais à la maison, rentrant de la « Brasileira[13] », quand j’ai eu envie, littéralement, de prendre une plume et de la poser sur le papier […] Ma médiumnité ne s’arrête pas là. J’en ai découvert une autre facette, que non seulement je n’avais jamais perçue, mais que je n’avais, pour ainsi dire, perçue que négativement. Quand Sá-Carneiro, à Paris, traversait la grande crise mentale qui devait le mener au suicide, j’ai senti la crise ici, il m’est tombé dessus une dépression subite venue de l’extérieur, que je ne parvins pas alors à m’expliquer[14]… »
Dans cette lettre, Pessoa parle encore de ses capacités de médium-voyant qu’il sent se développer en lui et que les occultistes décrivent sous les termes de « vision astrale » et de « vision éthérique ».
* * *
Pessoa et Sá-Carneiro se sont connus à Lisbonne début 1912, ce dernier achevant tardivement ses études secondaires.
« En 1912, Sá-Carneiro publie un livre de contes, Princípio (Prémices) et une pièce de théâtre, Amizade (Amitié). Son talent pour le théâtre était déjà célébré, et même tragiquement : Tomás (ou Thomaz) Cabreira[15], son ami, condisciple et co-auteur de la pièce Amizade, s’était suicidé[16] au beau milieu du lycée devant Mário qui dut aller annoncer au directeur le terrible événement. Ce suicide va être décisif dans l’œuvre et dans la vie de Sá-Carneiro[17]. »
 |
« Comme il y a un cas Pessoa, il y a un cas Sá-Carneiro, qui en est l’inverse. L’œuvre de Pessoa a caché sa vie ; la vie et encore plus la mort de Sá-Carneiro ont fait oublier son œuvre, que certains trouvent pourtant aussi géniale que celle de son ami. On a eu tendance à l’étudier et à le juger par rapport à Pessoa, dont il apparaissait comme une sorte d’hétéronyme supplémentaire, avec un statut tout de même un peu différent de celui de Caeiro, de Reis et de Campos. À l’époque où il le rencontre, nul, pas même lui, ne sait qu’il n’a plus que quatre ans à vivre ; mais nous le savons, nous, et cette fin proche donne à cette vie et à cette amitié une tonalité tragique. D’ailleurs, Sá-Carneiro pouvait légitimement avoir le sentiment d’une menace, d’une créance sur lui du destin : le cours de cette brève existence comporte, aussi bien en amont qu’en aval de la rencontre de 1912, des épisodes funèbres, dont les plus douloureux sont la mort de sa mère en 1892, quand il avait deux ans, et le suicide sous ses yeux de son meilleur ami en 1911, quand il avait vingt ans, suicide où il nous est impossible de ne pas voir une préfiguration du sien. Tout cela donne à sa destinée et à sa personnalité une aura exceptionnelle. Son dernier exégète oppose la « super-personnalité » de Sá-Carneiro à la « non-personnalité » de Pessoa[18]… »
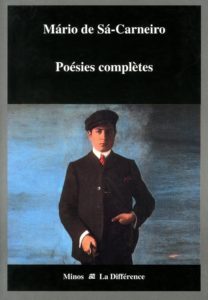 |
Cette amitié brève 1912-1916 entre Pessoa et Sá-Carneiro est la fusion de deux esprits majeurs de l’histoire littéraire du Portugal. Teresa Rita Lopes écrit dans sa préface :
« Pessoa a affirmé – par plume interposée, celle de Alvaro de Campos – que le Sensacionismo ‟est né de l’amitié entre F. Pessoa et Mário de Sá-Carneiro”. N’oublions pas que ce mouvement – considéré comme l’expression du modernisme portugais – est bien plus redevable au trajet parcouru ensemble par Pessoa et Sá-Carneiro pendant les quatre années que dura leur amitié, qu’à n’importe quelle esthétique, portugaise ou étrangère. […] Après tout ce que je viens de dire, je ne peux donc accepter l’opinion qui fait de Sá-Carneiro un épigone de Pessoa, ou au mieux, son disciple : ils ont été disciples l’un de l’autre. Et si l’on admet que Pessoa a été le maître à penser de Sá-Carneiro, il faudra ajouter que Sá-Carneiro a été, lui, le maître à sentir de Pessoa[19]. »
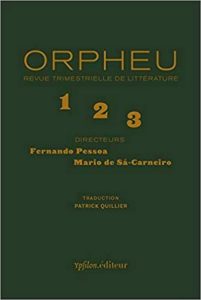 |
| Coopération de Fernando Pessoa & Mário de Sá-Carneiro |
| Revue ORPHEU |
Les lettres de Fernando Pessoa à son ami n’existent plus (exception faite de la dernière que Pessoa n’a pas expédiée) et sauf miracle, sont perdues. Elles se trouvaient dans « la malle que son ami gardait dans sa chambre à Paris, et qui a disparu après sa mort. C’est une perte irréparable. Sá-Carneiro, dans une des nouvelles, parle de ces admirables lettres de son ami[20]… ». Les lettres de Sá-Carneiro sont désormais éditées en français.
 |
Pessoa se guérira mal de l’absence de son ami, frère d’âme. « Le travail de deuil auquel il va se livrer pendant des mois ou des années est son travail de création poétique. Quelque chose de lui meurt avec son ami ; quelque chose de son ami survivra en lui[21]. » Dix-huit ans après la mort du poète, un an avant sa propre disparition, en 1934, Pessoa lui dédie ce poème :
Aujourd’hui, tu me manques, je suis deux à être seul […]
Comme nous étions un seul, en nous parlant ! Nous
Étions comme un dialogue dans une âme […]
Ah ! mon incomparable ami, plus jamais
Dans le paysage funèbre de cette vie
Je ne connaîtrai une âme aussi attachée
Aux choses qui en moi sont les choses réelles […]
Plus jamais, plus jamais, et depuis que tu es sorti
De cette prison étroite qu’est le monde
Mon cœur est inerte et infécond
Et je ne suis plus qu’un songe triste…
L’édition française des Poésies complètes de Mário de Sá-Carneiro est précédée d’un texte de Fernando Pessoa en hommage à son ami :
« Génie dans l’art, Sá-Carneiro n’a eu, en cette vie, ni joie ni bonheur. Seul l’art, qu’il fit ou sentit, lui apporta des instants de trouble consolation. Ainsi sont ceux que les Dieux ont prédestinés à leur appartenir. Ils ne sont ni chéris par l’amour, ni visités par l’espérance, ni accueillis par la gloire. Soit ils meurent jeunes, soit ils se survivent à eux-mêmes, hôtes de l’incompréhension ou de l’indifférence. Celui-ci est mort jeune, parce que les Dieux l’ont beaucoup aimé[22]. » ♦
[1] Poème de Fernando Pessoa dans la traduction française de Teresa Rita Lopes.
[2] « Mário de Sá-Carneiro, de deux ans le cadet de Pessoa, est né le 19 mai 1890 à Lisbonne, dans les beaux quartiers, d’une mère et d’un père appartenant l’un et l’autre à la bourgeoisie aisée. Orphelin de mère, il est élevé par son jeune père un peu fantasque, presque toujours en voyage, et par une nourrice également jeune, dans la Quita (propriété à la campagne) de ses grands-parents paternels. À sept ans, quand son père se fixe davantage, sa vie se partage entre la ville et la campagne. Il commence à écrire, à neuf ans, des petites pièces de théâtre qu’il met en scène et joue à la Quita avec les domestiques. À dix ans, il entre au lycée à Lisbonne. À douze ans, il commence à écrire des poèmes. En août 1904 son père, pour la première fois, l’emmène en voyage avec lui et lui fait découvrir Paris. Ils logent au Grand Hôtel (au-dessus du café de la Paix). Le père et le fils vont ensuite aux bains de mer à Trouville, puis à Lucerne. Ils traversent la Suisse et l’Italie, faisant escale à Venise, à Rome, puis à Naples. […] Il lit beaucoup, surtout les écrivains français et allemands du XIXe siècle. Il traduit Victor Hugo… et Déroulède, Goethe, Heine et Schiller. Il continue à écrire en prose et en vers. Il fait partie d’une troupe qui joue des comédies dont une de lui, sous le pseudonyme de Sirconera, qui est l’anagramme de son nom. En 1907, il passe de nouveau ses vacances à Paris avec son père. Il publie des poèmes et des contes dans la revue Azulejos… », Robert Bréchon, Étrange étranger, une biographie de Fernando Pessoa, chapitre 12, L’ami (1912), Paris, Christian Bourgois éditeur, 1996, p. 167.
[3] Chez Mário de Sá-Carneiro, on peut évoquer un rejet de lui-même, un narcissisme négatif, des interrogations sexuelles, une rupture amoureuse, des difficultés financières récurrentes pour tenter de comprendre son suicide. Dans sa biographie de Pessoa, Robert Bréchon, donne son sentiment : « On a peine à croire que cette question d’argent ait été la cause de son geste. Pas plus que son abandon par la femme, Helena, qu’évoque le Dernier sonnet. Comme le dira Cesare Pavese dans son Journal du 25 mars 1950, avant de se tuer le 26 août à Turin : ‟On ne se tue pas pour l’amour d’une femme. On se tue parce qu’un amour, n’importe quel amour, nous révèle dans notre nudité, misère, infirmité, néant.” », Robert Bréchon, Étrange étranger, une biographie de Fernando Pessoa, chapitre 20, La guerre, le deuil, l’infini, le désir (1914-1916), Paris, Christian Bourgois éditeur, 1996, p. 197.
[4] La correspondance de Mário de Sá-Carneiro est disponible en traduction française aux Éditions Impeccables, Paris, 2015. Les dernières lettres adressées à Fernando Pessoa sont disponibles en fin de l’ouvrage Mário de Sá-Carneiro, poésies complètes, Paris, Minos-La Différence, 2007, pages 289-313.
[5] Dans une brève lettre datée du 18 avril 1916, parlant de son horoscope, il écrit : « Le moment est venu, plus que jamais… ».
[6] Mário de Sá-Carneiro, Lettre à Fernando Pessoa datée du 31 mars 1916 : « Mon cher Ami, à moins d’un miracle, lundi prochain 3 avril (ou même la veille) votre Mário de Sá-Carneiro prendra une forte dose de strychnine et quittera ce monde. C’est comme ça – mais j’ai bien du mal à écrire cette lettre, tant j’ai toujours trouvé ridicules les « lettres d’adieu »… Ce n’est pas la peine de me plaindre, mon cher Fernando : finalement j’ai ce que je veux, ce que j’ai toujours tant voulu – et en vérité, que ferais-je de plus ici-bas… ». Il réitère ses menaces de suicide dans une courte missive non adressée en date du 3 avril 1916. Il dément son désir de mort dans une carte postale datée du 4 avril suivant. Mais sa lettre du même jour puis celle du 17 avril 1916 contiennent des éléments peu rassurants.
[7] Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquillité, lettre à Mário de Sá-Carneiro, du 14 mars 1916, reprise page 23-25, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1995.
[8] José Blanco, Pessoa en personne, Paris, Minos-La Différence, 2003, p. 188-190.
[9] Armando Côrtes-Rodrigues (1891-1971), professeur de lycée, poète, proche ami de Pessoa.
[10] José Blanco, Pessoa en personne, Paris, Minos-La Différence, 2003, p. 193.
[11] Ana Luisa Pinheiro Nogueira de Freitas, que l’on appelait dans la famille « Tante Anica » était la sœur de la mère de Fernando
[12] Note de José Bianco : « Quand le jeune Fernando vivait chez sa tante, ils firent quelques expériences de « spiritisme », dont l’écriture automatique. »
[13] Le café A Brasileira, quartier Chiado, Lisbonne.
[14] José Blanco, Pessoa en personne, Paris, Minos-La Différence, 2003, p. 198-199.
[15] Thomás (ou Thomaz) Cabreira est de 4 ans le cadet de Mário de Sá-Carneiro.
[16] Thomás Cabreira se suicide en se tirant une balle dans la tête, sur les marches de l’escalier du lycée (Robert Bréchon, Étrange étranger, une biographie de Fernando Pessoa, chapitre 12, L’ami (1912), Paris, Christian Bourgois éditeur, 1996, p. 168.
[17] Mário de Sá-Carneiro, Poésie complètes, Préface par Teresa Rita Lopes, Paris, Minos-La Différence, 2007, p. 12-13.
[18] Robert Bréchon, Étrange étranger, une biographie de Fernando Pessoa, chapitre 12, L’ami (1912), Paris, Christian Bourgois éditeur, 1996, p. 165.
[19] Mário de Sá-Carneiro, poésie complète, Préface de Teresa Rita Lopes, Paris, Minos-La Différence, 2007, p. 18-20.
[20] Robert Bréchon, Étrange étranger, une biographie de Fernando Pessoa, chapitre 12, L’ami (1912), Paris, Christian Bourgois éditeur, 1996, p. 164-165.
[21] Ibid., chapitre 20, La guerre, le deuil, l’infini, le désir (1914-1916), p. 293.
[22] Mário de Sá-Carneiro (1890-1916) par Fernando Pessoa, dans Mário de Sá-Carneiro, poésie complète, Paris, Minos-La Différence, 2007, p. 9.
25 & 26 février 2020
Lotus de mon marécage
Même lorsque tout semble morne, insipide, que la santé se décline en sinusoïdes pleure-misère, macérant sur les altérations d’un hiver édulcoré et pisseux, des choses rassurantes adviennent. À la manière de Fernando Pessoa je peux me consoler : « Même dans les marécages de mon esprit, les lotus fleurissent[1]. »
 |
L’année 2020 s’est ouverte sur bien des tristesses et inquiétudes.
Meg Jones nous quittait le lundi 6 janvier à 6h00 du matin, méconnaissable. À près de 99 ans, la raison prenant brusquement son envol, hospitalisée, elle s’était cassé le col du fémur et ses jours se terminèrent par une agonie assez brève, heureusement veillée par ses amies. Nous l’accompagnions le samedi 11 janvier au petit cimetière du Vigan (Lot).
Khadra débutait une série de rayons à Francheville, auxquels sont venues s’ajouter des chimios. Son teint cadavérique ne ralentit nullement son acharnement à poursuivre son suicide : alcool et tabac. Comme l’écrivain Colette, elle doit penser : « La mort ne m’intéresse pas, même pas la mienne. » Elle est uniquement en recherche de compassion dans le regard des autres.
José m’annonçait le dimanche 12 janvier que Madeleine avait eu un AVC et qu’elle se trouvait à l’hôpital de Périgueux, paralysée du côté droit, plus ou moins inconsciente, dans un état alarmant. Ma visite du mardi 14 janvier ne me laissa pas beaucoup d’espoir. Deux semaines après, son transfert à la maison de retraite de Nontron laissait supposer un mieux. Il m’est impossible d’avoir de ses nouvelles.
De décembre et février ce fut la santé de Marinette, qui présageait une funeste échéance. Ma cousine Pierrette en aura bavé son aise, soutenue par Jean-Pierre et leur fille Céline, depuis l’hospitalisation des deux sœurs de 84 et 98 ans, extraites d’une maison digne des plus sordides récits, en passant par l’attitude revêche de la plus jeune. Jamais cette dernière n’aura pris l’opportunité de rendre visite à sa sœur à l’hôpital de Bergerac où elle était hospitalisée elle-même pour s’être cassé le col du fémur, puis ensuite à la maison de retraite d’Issigeac. La pauvre Marinette eut tant à souffrir avant de s’éteindre. Il existe des vies vouées à tous les abandons y compris celui d’un Dieu dit « compatissant ». Sans l’intervention de mes cousins Martinet, lorsque la cadette dut être hospitalisée, la fin de l’aînée aurait été plus lugubre et terrifiante encore, victime qu’elle était d’une sœur immonde autant qu’ignoble.
Entre temps Georges Ridoin, en tombant à l’UD CGT 24, se brisait le péroné. Hospitalisation à l’hôpital de Périgueux. Une fois remis et plâtré, ce fut un transfert à l’hôpital de Saint-Astier. Le vendredi 7, je lui rendais visite avec ma camarade Christine Soteras-Sudeix, pour envisager par ailleurs l’enregistrement de ses mémoires.
En sortant, j’allais, à proximité, aux pavillons de La Forêt, saluer l’ami Pierre Jouin, que je trouvais relativement étrange. Dimanche 16 février, je recevais d’une de ses nièces, un message disant : « Maman a été hospitalisée mercredi et tonton Pierre samedi matin, l’infirmière a trouvé tonton par terre samedi matin, il est très affaibli. » Les deux inséparables à l’hôpital de Périgueux, simultanément. La sœur de Pierre victime par intermittence de poussées de démence et Pierre se trouvant dans un état fort inquiétant, lui qui fut sa vie entière le symbole de la santé et d’une forme éblouissante. Un guérisseur qui contestait de ne pouvoir avoir de remède pour lui-même. Ce qui me fit souvenir d’Albert Gazier qui pouvait soigner tout, même presque ressusciter une de mes grand-tantes, Marthe Geoffre, et qui s’en alla d’un cancer. Nous nous demandions si nous pourrions même fêter les 90 ans de Pierre, le 8 mars prochain.
Et pour couronner le tout, le 12 février, Étienne et moi recevions ce message de notre ami Lionel : « Depuis lundi Papa a été hospitalisé dans un état grave. Je passe une partie des nuits auprès de lui, et tout le temps que je peux, dès que je ne suis pas en activité professionnelle, que je n’accomplis qu’à minima. La situation est plus que compliquée, et je mets à profit un bref passage chez moi pour prendre quelques affaires, pour vous adresser ce petit mot. Jusqu’à ce que la situation évolue, je ne sais pas du tout dans quel sens, je me vois contraint de suspendre toute activité associative… ». Même si les nouvelles que Lionel me donnait dimanche soir étaient un peu moins angoissantes, rien n’est résolu des ennuis qui affectent son père. On ne remonte pas la perte de 17 kilos en quelques jours. Et Lionel diabétique, insulinodépendant, est épuisé, avec une mère qui vacille, situation aggravée par la mort de leur chien âgé de 15 ans.
Impossible d’ignorer la semaine écoulée des sombres anniversaires entre le 17 et le 22 février, ceux des disparitions de ma grand-mère Marie Rosalie, de mon père, de mes amies Jeannine et Émilie.
Ces nouvelles plus que maussades me virent, comme l’an passé, en une période de trois semaines où je me trouvais dans un état de santé désobligeant, suite à un refroidissement, suivi d’une rhinite, aggravée par une allergie aux pollens et à un risque de bronchite. Le traitement aux antibiotiques que je déteste, s’impose, mais cette fois sans aspartame et accompagné d’un reconstituant de flore intestinale.
L’écriture me maintient en éveil, l’activité de l’association aussi. Le printemps est plus que précoce : une multitude d’hellébores achèvent leur floraison, les primevères surgissent de terre comme par enchantement, ce sont des tapis multicolores, les magnolias et exochordas (Pearlbush) sont en fleurs, sans parler des cognassiers du Japon et des très rustiques cornouillers mâles (cornus mas) étincelants d’étoiles jaunes !
 |
La lecture m’occupe, bien au-delà de mes habitudes : Jean Chalon (Chers contemporains, Journal d’un biographe, 1984-1997, Journal d’un lecteur 2002-2004), Fernando Pessoa (José Blanco, Pessoa en personne – correspondance de Pessoa –, L’éducation du stoïcien), Daniel Tammet (Je suis né un jour bleu), François Augiéras (L’apprenti Sorcier). Il est ainsi possible de vivre plusieurs vies en une seule pour oublier l’amertume de celle que l’on vit contraint et forcé. « La seule vie passionnante qui soit est la vie imaginaire » confiait Virginia Woolf dans son Journal d’un écrivain.
 |
Le temps s’écoule inexorablement, les beaux jours s’inscrivent désormais dans la rubrique « nostalgie » ! « La gloire des iris n’est plus qu’un souvenir… où est leur splendeur des années passées ? Tout passe, même la splendeur des iris ! Mais les martinets noirs dans le ciel bleu, le vent dans les bambous, le soleil qui se couche au fond du jardin suffisent à me combler. Pour ces instants de félicité extrême et de paix absolue, la vie vaut la peine d’être vécue[2]. » ♦
[1] José Blanco, Pessoa en personne, Lettre de Fernando Pessoa à Armando Côrtes-Rodrigues, 4 janvier 1915, Paris, Minos-La Différence, 2003, p. 158.
[2] Jean Chalon, Journal d’un lecteur 2002-2004, Paris, Plon, 2007, « mercredi 30 avril 2003 », p. 94.
Samedi 22 février 2020
Merveilleux enfants autistes
L’autisme n’est pas une maladie mais une caractéristique s’appliquant à quelques êtres qui ont des fragilités au niveau du rapport aux autres, un retrait, une frilosité à communiquer, mais qui sont dotés de capacités intellectuelles, parfois, hors norme ; ils s’avèrent être assez souvent des étudiants concentrés, brillants, et parfois des génies comme c’est le cas pour un des plus célèbres parmi les Asperger, Daniel Tammet.
Le mercredi 29 janvier, désirant regarder François Cheng, dans la Grande Librairie sur France 5, j’ai découvert émerveillé, Daniel Tammet.
En faisant la connaissance en 2019, de David Rivière et Julie Delvas et de leurs deux fils, Tom, 4 ans et Yann moins d’un an, j’observais pour la première fois, un enfant autiste, par ailleurs d’une beauté absolue. Ce petit cousin est à mon avis bien autre chose qu’un enfant différent, silencieux, absent, perdu. Il possède quelque chose de spécial, et lorsque j’ai entendu, des mois après, Daniel Tammet, j’ai compris que de sérieux espoirs étaient permis pour ce bel enfant que certains rejettent et qui me fascine, car il possède probablement des capacités qui nous seront toujours inaccessibles. Daniel Tammet qui nous permet de comprendre par la description de son monde secret ce que sont les craintes, les peurs, les impossibilités d’un enfant et d’un adolescent autiste, était venu, à 41 ans, présenter, dans cette émission, un nouvel ouvrage.
Tammet était au diapason de cet homme merveilleux qu’est François Cheng. De l’écouter, fut comme si soudain une fenêtre s’ouvrait toute grande sur un monde, en apparence, clos !
 |
Je viens de terminer la lecture du livre autobiographique de Daniel Tammet. Toutes les pages où apparaissent des chiffres restent hermétiques pour moi (c’est mon autisme personnel), tout le reste du livre est accessible, passionnant et tellement instructif pour la compréhension de ce qui est difficile pour l’enfant, l’adolescent, autiste : ses craintes, ses insécurités, et pour que l’on prenne aussi conscience de ses immenses potentiels. Le frère Asperger de Daniel, Steven, musicien, a un tout autre parcours que lui, mais intéressant par son originalité. Sa manière colorée de se vêtir[1] rappelle en moins provocant celle de Jacques Offenbach qui arborait des tenues extravagantes[2], lui qui était le roi de Paris et un des plus inventifs génies du XIXe siècle !
On note une recherche du silence et de la solitude chez Tom comme chez Daniel :
« J’aimais le son des pages qu’on tourne. Les livres me devinrent très précieux, parce que chaque fois que mes parents lisaient, la pièce devenait silencieuse, ce qui m’apaisait et me rendait heureux[3]. »
Une solitude et un calme où l’animal tient une place d’apaisement et de sécurité :
« J’ai toujours aimé les animaux, depuis ma fascination enfantine pour les coccinelles jusqu’au visionnage avide de documentaires animaliers à la télévision. Je pense que l’une des raisons de cette fascination est que les animaux sont souvent plus patients et plus tolérants que les humains[4]. »
Même adolescent, le bruit, la foule, la multitude de sollicitations sont une source de perturbations :
« Je n’aimais pas le centre de Londres. C’était plein de gens, de sons, d’odeurs, de visions, de signes, et il y avait trop d’informations pour que je puisse les assimiler : ma tête me faisait mal[5]. »
L’économie extrême de communication est également significative :
« Je prenais rarement l’initiative de parler[6]. »
« Ma mère me faisait toujours lui raconter ma journée à la maternelle. Elle voulait ainsi m’encourager à parler, moi qui était si silencieux[7]. »
« Écouter les autres n’est pas facile pour moi, Quand quelqu’un me parle, j’ai souvent le sentiment d’être en train de chercher une station de radio, et une grande partie du discours entre et sort de ma tête comme des parasites. Avec le temps, j’ai appris à en saisir assez pour comprendre de quoi on me parle, mais c’est parfois problématique quand on me pose une question et que je ne l’écoute pas. Celui qui la pose peut parfois s’ennuyer avec moi, ce qui me met mal à l’aise[8]. »
 |
L’autiste a cet étrange sentiment de ne pas être du même univers que ceux qui l’entourent :
« Je n’avais pas de sentiment particulier pour mon frère et nous vivions des vies parallèles. Souvent, il jouait dans le jardin pendant que je restais dans ma chambre. Nous n’avons presque jamais joué ensemble. Quand nous le faisions, il ne s’agissait pas d’un jeu collectif : je n’ai jamais eu le goût de partager mes jouets ou mes expériences avec lui. Avec le recul, ces sentiments me semblent bien étranges aujourd’hui. Je comprends l’idée de la collectivité, de partager des expériences. Même si j’éprouve parfois des difficultés à m’ouvrir et à communiquer, la nécessité de le faire est définitivement ancrée en moi. Cela a peut-être toujours été là, mais j’ai eu besoin de temps pour le découvrir et le comprendre[9]. »
« Je n’ai jamais été gêné ou concerné par le fait d’être à la traîne : les autres enfants ne faisaient tout simplement pas partie de mon monde[10]. »
« Simplement, c’était comme si je ne pouvais y trouver ma place nulle part, comme si j’étais né dans un autre monde. Le sentiment de ne jamais être tout à fait à l’aise ou en sécurité, d’être toujours d’une certaine manière à part ou exclu, me pesait beaucoup[11]. »
La concentration des autistes sur une multitude de détails les écarte de la vision globale qui nous permet de réagir aux stimuli incessants qui nous sollicitent et parfois d’ailleurs nous épuisent dans le contexte d’une vie de plus en plus artificielle et soumise à un stress permanent :
« … Le fait que les autistes s’intéressent aux détails au détriment des informations globales, alors que la plupart des gens contextualisent les informations et négligent souvent les plus petits détails. Par exemple, des études ont montré que les enfants autistes sont très performants – et meilleurs que les sujets non-autistes – dans la reconnaissance de visages familiers lorsque l’on ne leur montre qu’une partie de ce visage sur des photographies[12]. »
♦ ♦ ♦ ♦
Le séjour que, jeune adulte, Daniel fit, dans le cadre d’un Service volontaire à l’étranger (à Kaunas en Lituanie), affecté à une classe de soutien à l’apprentissage de l’anglais, fut infiniment bénéfique. Ce fut son premier grand voyage en solitaire, en avion. Il restera des mois éloigné de son milieu familial sans trop en souffrir, faisant de très belles rencontres, liant des amitiés, s’impliquant à aider les autres, et confortant son don pour apprendre de nouvelles langues avec une rapidité foudroyante.
Son voyage aux USA dans le cadre d’enregistrements pour la télévision va l’émanciper plus encore et lui faire entrevoir l’autonomie, même s’il vit avec une équipe de techniciens. En Utah, il rencontrera Kim Peek[13], la mémoire absolue. Ses capacités au niveau des chiffres et des langues sont proprement stupéfiantes et le font classer parmi les cent génies actuels.
Puis ce sera en solo une séance d’enregistrement de la chaîne Science Channel à New York mettant en exergue ses fabuleux talents mémoriels en rapport avec sa synesthésie :
« Cette expérience me montrait plus qu’aucune autre que j’étais désormais vraiment capable d’avancer dans le monde, de faire tout seul des choses que la plupart des gens considèrent comme acquises : voyager à l’improviste, rester seul dans un hôtel ou dans une rue animée sans avoir le sentiment d’être submergé par les différentes visions, les bruits et les odeurs tout autour de moi. Je me sentais ivre à la pensée que tous mes efforts loin d’être vains, m’avaient emmené au-delà de mes rêves les plus fous[14]. »
Julie, la maman de Tom, souhaite lire le livre de Daniel Tammet. Elle est tellement investie et attentionnée avec son fils, qu’il progresse désormais très vite. Tous les espoirs sont permis de l’amener à être complètement lui-même, en symbiose avec tous les autres, tout en conservant son particularisme et ses facultés.
De comprendre le fonctionnement de l’enfant autiste permet de bien mieux ajuster nos propres comportements avec lui pour favoriser, au lieu de contrarier, son épanouissement au-delà de toute espérance. La conformité étant sans doute le plus grand risque pour l’enfant. Nos sociétés les y poussent par intérêt. Merci à Daniel Tammet d’avoir pu venir si intelligemment dire au monde, aux interrogateurs, aux perplexes, ce qui se passe derrière vos silences, qui ne sont pas une absence d’intelligence ou du vide, mais une autre manière d’exister et de construire son chemin, et dans le cas de Daniel, magnifiquement ! ♦
[1] « Parfois, mes parents se plaignent des goûts vestimentaires de Steven qui porte des couleurs très vives (des chaussures orange par exemple) et change de coupe de cheveux toutes les semaines. », Daniel Tammet, Je suis né un jour bleu, Paris, J’ai Lu, 2006, p. 268.
[2] Les prétentions à l’élégance de Jacques Offenbach, conduisent au comble de l’extravagance et du « mauvais goût ». Son ami, Ludovic Halévy, écrivait à sa mère, en 1862, depuis Étretat : « Jacques a trouvé un costume qui dépasse celui de l’année dernière : pantalon bleu se perdant dans de longues bottes jaunes, paletot blanc, bordé et brodé de rouge, béret blanc. » Robert Pourvoyeur disait : « En réalité, comme le sont tous ces êtres qui cherchent systématiquement à amuser, à étonner, et qui semblent avoir un caractère extraverti et exhibitionniste, Offenbach est aussi un homme secret, tourmenté, inquiet, hypersensible et profondément romantique. » (Robert Pourvoyeur, Offenbach, Paris, Seuil, Solfèges, 1994, « Portrait d’Offenbach », p. 116.
[3] Daniel Tammet, Je suis né un jour bleu, Paris, J’ai Lu, 2006, p. 39.
[4] Ibid., p. 194.
[5] Ibid., p. 134.
[6] Ibid., p. 40.
[7] Ibid., p. 43.
[8] Ibid., p. 101, 102.
[9] Ibid., p. 38.
[10] Ibid., p. 46.
[11] Ibid., p. 100.
[12] Ibid., p. 57-58.
[13]. Laurence Kim Peek (1951-2009) est un américain atteint du syndrome du savant et possédant une mémoire eidétique (mémoire absolue). Il a inspiré le personnage principal du film Rain Man.
[14] Ibid., p. 265-266.
|
BIOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE de Daniel TAMMET d’après WikipédiA Daniel Tammet, né Daniel Paul Corney, en Angleterre, en 1979, est aujourd’hui écrivain, poète, hyperpolyglotte. Aîné d’une fratrie de 9 enfants, il a vécu une enfance modeste dans le sud de l’Angleterre. Victime de crises d’épilepsie (définitivement guéries) durant son enfance, il sera diagnostiqué autiste Asperger à l’âge adulte. Sa synesthésie lui offre une capacité mémorielle considérable. Ainsi, au Musée de l’histoire des sciences d’Oxford, le 14 mars 2004, il récite en un peu plus de 5 heures les 22 514 premières décimales de ӆ, ce record européen, le propulse sur la scène médiatique. Ayant eu la particularité de développer des capacités de communication proches de la norme, il possède des aptitudes singulières dans les domaines des nombres et des langues.
Les nombres vont l’aider d’abord à surmonter les épreuves qu’il rencontre à cause de sa différence — rejet des autres, incompréhension du monde qui l’entoure et des règles sociales, hypersensibilité au bruit. Il s’exprime ainsi au sujet des nombres : « ils me calment et me rassurent. Enfant, mon esprit se promenait en paix dans ce paysage numérique où il n’y avait ni tristesse, ni douleur. » Jeune garçon, il est fasciné par la magie des nombres premiers, puis à l’adolescence, il s’adonne au calcul calendaire, qui permet de trouver en un instant le jour de la semaine correspondant à n’importe quelle date de naissance. Il développe également une passion et des facultés extraordinaires pour les langues étrangères, qu’il assimile plus rapidement grâce à sa synesthésie, il en connaît aujourd’hui plus d’une dizaine : anglais, français, islandais, allemand, espagnol, espéranto, lituanien, roumain… Il s’invente une langue personnelle qu’il nomme : Mäntis. Après son séjour en Lituanie, à 19 ans, où il est professeur d’anglais, il créait en 2002 son propre site internet d’apprentissage des langues appelé Optimnem qui va rencontrer le succès.
Il fait l’objet d’un documentaire qui lui est entièrement consacré : L’homme ordinateur, version française du documentaire britannique, dans lequel il relève un nouveau défi, linguistique cette fois, celui d’apprendre l’islandais en une semaine et de répondre à une interview en direct à la TV dans cette langue. Le défi est relevé haut la main. On y voit aussi sa rencontre avec un autre autiste, Kim Peek.
En 2009, il s’installe à Avignon avec son compagnon Jérôme Tabet (photographe), puis à Paris, où il est écrivain à plein temps. Le 16 mars 2010, Daniel Tammet est invité par L’Express à poser pour une photographie réunissant les auteurs les plus lus de 2009.
Depuis, il a été l’invité à deux reprises de l’émission La Grande Librairie sur France 5, d’abord en 2017 pour Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter, puis début 2020 pour Fragments de paradis. François Busnel dit de lui : « Ce que j’admire chez vous, c’est votre attirance aussi bien pour la poésie, que pour les neurosciences ou la sociolinguistique. »
Ses livres traduits en français :
Livre en français :
|
Du 2 au 14 février 2020
José Correa, un artiste hors du temps
Jean Chalon dans son Journal d’un rêveur professionnel, note à la date du 8 mars 2005 : « Un ami, Gérard Grosnier, me téléphone pour me souhaiter bon anniversaire et me dire : « Avoir soixante-dix ans, c’est repartir à zéro. » C’est, presque, un écho à ce que m’avait dit Louis Pauwels pour mes soixante ans qu’il avait changé en « soi sans temps ». Me voilà un septuagénaire, je n’arrive pas à y croire complètement.
À la fin de sa vie, dans une lettre à l’un de ses amis, George Sand avouait être : « restée enfant à bien des égards… ». Je pourrais faire le même aveu. Et même je crois que je n’ai jamais cessé d’être l’enfant que j’étais, avec les mêmes terreurs et les mêmes enchantements[1]. »
Naître sur une nouvelle décennie simplifie le mode de calcul du rythme des dizaines. Les années s’écoulent si prestement, que l’on a peut-être même pas le temps de s’en rendre bien compte, sauf si l’on vieillit trop et qu’oubliés – pour n’être plus du temps présent – l’on puisse avoir à compter un nombre, qui semble alors inépuisable, de jours de solitude, avant que de s’en aller !
Il faut pouvoir se déplacer et marcher pour être dans le monde des vivants.
Un artiste compte-t-il ? Il n’existe personne de plus attaché à la liberté de l’enfance qu’un créateur qui a oublié, refusé d’entrer dans la prison de l’âge adulte où il faut se mettre au garde-à-vous, se contraindre à subir conditionnements, soumissions des sociétés formatées par la famille, l’école, la religion, la vie professionnelle… Il échappera à tout cela, ne pouvant, ne voulant, n’acceptant pas de s’y résoudre.
Cette extrême liberté dont j’étais en recherche après l’étouffoir Mormon, il la possédait à outrance, en réalité même pas, tout naturellement, puisqu’il avait échappé à tous les conformismes et endoctrinements qui ne manquent pas de nous assaillir dans la vie organisée.
L’année 1993 fut riche de rencontres essentielles en ce qui me concerne. Ainsi le Jeudi 16 septembre, je me rendis à Villejalet pour une première rencontre avec Madeleine Marcoux. Ineffable artiste et âme transcendante.
Le 25 septembre suivant, avec Marie-Hélène, en visite ici, nous rendions visite à Jean Callerot à Saint-Aulaye, émerveillés par ses pastels, d’un naturel éloquent. Nous avons adoré le travail de cet artiste et sa personnalité aussi humble que talentueuse.
 |
| José Correa, 2020 © Pierre-Yves Besse |
J’avais fait la connaissance de Dany Correa professionnellement, cette même année. Un événement tragique nous réunit autour d’une amie commune dans le service de réanimation de l’Hôpital de Périgueux. C’était le lundi 22 novembre 1993. Je fis donc connaissance avec José, l’artiste dont tous mes amis me parlaient et dont je connaissais quelques créations. Notre relation s’intensifia rapidement et tout ce que je découvrais de ses œuvres dans leur habitation ou dans son atelier, me subjuguait. Il y avait de l’âme dans ses dessins et ses aquarelles. Nos conversations étaient comme une école de liberté et de culture non conventionnelle, un panorama infini sur l’art. José abordait mille sujets, la chanson beaucoup et souvent, Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré… étaient en écoute ou Crosby, Stills and Nash, Neil Young… toutes les musiques, classique, jazz, rock… les créateurs, la littérature, la poésie, l’humour populaire et glacial de Michel Audiard. C’était magique. Nous avons passé des heures dans son atelier qui était la boutique la plus fantastique qui soit ! Il y aurait fallu cent fois plus de temps pour pouvoir évoquer tour à tour Jacques Prévert, Fernando Pessoa, François Augiéras, Arthur Rimbaud, Louis-Ferdinand Céline, Jacques Higelin, Claude Nougaro et surtout Léo Ferré qu’il finit par me faire entendre… grand poète s’il en est ! José est d’ailleurs lié à Marie, sa veuve et aux enfants de l’artiste.
 |
| Atelier de l’artiste, chamiers©José Correa |
On ne saurait parler de laborieux, de vaillant, à son sujet. Le mot qui convient est passionné et on ne peut qu’être éblouis lorsqu’on observe cette dédicace à son art qui se manifeste par l’intensité de sa production. Pas un jour sans un dessin, une aquarelle, une huile… plusieurs projets voient le jour simultanément. Difficile de recenser tous les ouvrages qu’il a illustrés et ses propres publications. Rien que sur le Périgord chez Cairns et à La Lauze, il a tout vu, tout réincarné, enchanté avec ses pinceaux ou ses crayons. La magie évocatrice de ses aquarelles autorise le voyage immobile. L’évocation des petits villages oubliés de Dordogne permet au curieux de découvrir notre pays au-delà des recommandations stéréotypées des guides, la beauté est partout pour l’œil vigilent. Nous regardons distraitement… lui voit ce qui mérite notre attention. Ses ballades nous conduisent sur les traces de nos ancêtres le long de nos cours d’eau, dans les villages les plus secrets et méconnus.
D’autre part, chanteurs, poètes, écrivains, compositeurs, tous sont illustrés admirablement… Léo Ferré un peu davantage ! Il n’y a pas plus expert et amoureux de ses univers.
Il doit être difficile de recenser le nombre d’expositions auxquelles il a participé, celles dont il est l’invité d’honneur ou soliste. Bien souvent, il expose à plusieurs endroits en France, voire à l’étranger et en même temps en Dordogne ou dans les départements limitrophes sur des thèmes différents. Il est un des plus prolifiques illustrateurs des littératures françaises, américaines…
Sous la direction de Dany Correa, les expositions au château des Izards furent des temps d’exception, les beaux jours de l’art, le lieu où l’on pouvait découvrir les meilleurs artistes. Nous y vîmes et admirèrent Louis Tofoli[2], Jean Callerot, le graveur Claude Durrens et beaucoup d’autres.
Sans doute suis-je très privilégié de posséder autant de cartes illustrées par ses soins, de dessins, d’aquarelles et même une huile ; et je dois l’avouer, le plus souvent, des cadeaux ! Le plus bouleversant et magnifique illustre en grand format des hétéronymes de Fernando Pessoa. Un cadeau inoubliable d’un de ces rares noëls, à l’âge adulte, où le Père Noël repasse sans crier gare, avec cette superbe dédicace : « à Alain, cette rencontre intemporelle, Pessoa, Augiéras et les autres… Lumières dans la nuit… Amitié, Hiver 95 »! La toile rutilante de la ferme d’Antoniac à l’automne, aux Moulineaux (Razac-sur-l’isle), pour mes 50 ans, en 1997, fut un autre éblouissement.
Nous avions de nombreuses relations communes, c’était au temps de l’apogée du jardin des Rolphies. Les artistes peintres Lucienne Fabre-Doré, Madeleine Marcoux étaient des fidèles de nos rencontres, des fêtes au jardin, printemps et automne. Il y avait encore Renée Daubricourt, Denise Robin, Françoise chevé, Jeannine Lasserre, Georges et Émilie Dalençon… Toutes et tous étaient des admirateurs de l’art de José qui exposa des tableaux, dessinés ou peints au jardin, dont un grand format qu’il m’offrit au-delà de toute une série de jolies pancartes permettant de diriger les visiteurs depuis la route départementale, jusqu’au parking et enfin au jardin. Les heureux moments partagés avec le couple Correa et leurs deux merveilleux fils, chez Carlos, à la Loubarie d’Eyvirat (où je revenais sur les lieux où vécurent mes arrière-grands-parents Rivière) ou à l’Étang aux Daims à Villejalet, chez Madeleine, sont dans nos souvenirs et y demeurent précieusement !
Je participais à deux manifestations où José était exposé. La première à Neuvic-sur-L’Isle, puis à Montrem, en 1997. J’avais souhaité rendre hommage à Darius Milhaud et les illustrations de José étaient comme un livre ouvert sur cette période de notre histoire musicale, des années 20 et du Groupe des Six. Les poétesses d’Aveyron étaient venues avec la belle Élise, présidente des Jeunesses Musicales d’Aveyron, qui ayant dépassé les 90 ans, s’apprêtait allègrement à passer le cap des 100 ans. Madeleine Milhaud, alors âgée de 95 ans, m’avait avoué avoir eu l’intention de venir se joindre à nous. Des problèmes circulatoires l’en avaient empêchée. J’appris plus tard que son neveu, Georges Milhaud, qui se joignit au début des années 2000, aux Amis de la musique française, l’aurait alors accueillie à Belvès où il résidait avec son épouse, durant la belle saison.
Il y eut cette expédition avec mes m’Amies jusque dans le sud du Lot-et-Garonne, dans le charmant village de Clairac, Galerie Feille, pour une exposition uniquement consacrée à José. J’en revenais avec une aquarelle de Venise, cadeau collectif et affectif, qui orne ma chambre !
|
|
| Couverture de Ravel-Fargue©José Correa |
Une réalisation plus récente fut la couverture d’un opuscule sur l’amitié entre le compositeur Maurice Ravel et le poète Léon-Paul Fargue.
* * *
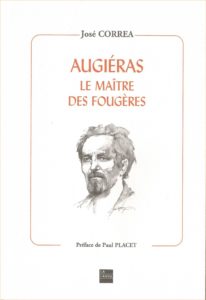 |
Cesser de croire à un monde tout rose, de contes de fées, de Pères Noël, n’est pas facile et s’ouvre sur une grande désillusion. Pour autant le côté rimbaldien, d’enfant livré à lui-même, presque sauvage, vécu par José excepte à presque toutes les règles habituelles du monde de l’enfance européenne, même si après la guerre l’enfant gâté n’existait que dans les familles très aisées. Il le dit dans son Augiéras, le maître des Fougères : « Ma vie a commencé par un malentendu, dans un pays que, longtemps, j’ai cru mien […] Je venais du Sud… De l’autre côté du détroit de Gibraltar… et j’ai traversé quelques régions… Fragile, condamné à faire semblant de ne pas l’être[3]… »
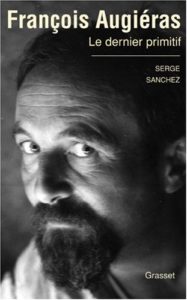 |
En mars 1968, lorsque José, âgé de 18 ans, « garçon un peu perdu de la vie qui risquait le faux pas[4]… », victime d’un accident de sport arrive en convalescence aux Fougères (près de Brantôme), il va être attiré par un grand silencieux, un résident hors du commun qui transcrit ses souvenirs de son Voyage au Mont Athos. La curiosité l’emporte et il va sympathiser avec ce personnage solitaire et studieux. Paul Placet, qui enseignait alors au lycée d’Excideuil, leur rendait visite, chargé de cadeaux. Cette rencontre imprévisible avec un écrivain, qui dans les serres de l’établissement, devenait peintre, fut une initiation à un monde qui lui était inconnu, où l’art, la création tiennent une place centrale, voire exclusive. José s’en souvient : « …Le printemps semble vouloir forcer la porte de notre « serre atelier »… Il pleut et nous peignons… Autour de nous le silence. La Paix. Un parfum nouveau pour moi. Mélange subtil et rude de tabac, térébenthine, peinture à l’huile et thé. Nous sommes seuls au monde. […] Des horizons jusqu’au bout. Des personnages grouillants. Wagner. La bataille de Tétouan de Dali, ne me faisait pas peur[5]… » Duo et duel avec le trait, l’ocre et l’or, les horizons… Provocant ou complice, Augiéras révélant en direct l’art de peindre, de dire avec pinceaux et matière. José finit par affronter le monstre nouveau : la peinture ! Augiéras avait gagné et « Jusqu’à la nuit, il me dit la Peinture. Je ne comprenais pas tout, mais le lyrisme, la douceur d’un soir d’été, le Périgord, l’écho des martinets dans un ciel encore pur… Nous étions seuls au monde. Fumer une dernière cigarette. Que le rêve soit plus long que la nuit. J’avais dix huit ans[6]… »
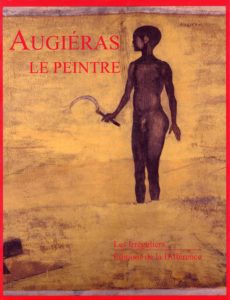 |
Et ce sera la révélation, l’éclosion d’un talent en herbe couronnée par une exposition de trois peintures dans le grenier de l’abbaye à Brantôme, en juillet 1968. Le maître était fier de son élève qui lui, infidèle, était absent, il pêchait dit-on… autrement dit, il le confesse volontiers, il « soufflait sur des cœurs qui sentaient le jasmin. »
Rencontre primordiale que celle des Fougères : « … je sus que le Périgord serait ma famille. Prendre le temps de se regarder. Lui et moi… J’avais, sans conscience, posé ma valise. J’y ressentais de l’inconnu et des sentiments très anciens. L’assurance d’une terre… Nous nous sommes reconnus[7]… »
Cependant, Correa ne fut pas l’un de cette seconde ‟École de Paris” provinciale qui comprenait François Augiéras, Marcel Loth, Jean Boyé, Guy Célérier, Paul Placet, avec on s’en doute comme inspirateur, car professeur reconnu, descendu de Paris dans le Lot, à deux pas de notre département, l’artiste Roger Bissière. En effet, Correa, dans les années qui suivirent cette rencontre va se démarquer et développer son propre style, il ne sera aucunement un épigone de cette famille qui comme en 1920, lorsqu’apparut le ‟Groupe des Six”, avait plus de liens de fraternité, parfois tumultueux, que de fidélité à une esthétique.
Augiéras avait des relations avec plusieurs écrivains, André Gide, Marguerite Yourcenar, Jean Chalon… Certaines de ses correspondances sont éditées.
Ma rencontre personnelle avec l’univers de François Augiéras fut plus chaotique, son égocentrisme et sa liberté sexuelle polymorphe me choquaient. Aussi, n’ai-je pas apprécié Le Vieillard et l’enfant, assez peu Un voyage au Mont Athos qui ressemblait plus, à mon sens, à une conquête pornographique que spirituelle. La trajectoire, une adolescence au temps du Maréchal est un ouvrage biographique et fantasmé ; sans doute, il ne faut pas toujours croire Augiéras. Cependant, bien des passages m’ont semblés intéressants voire visionnaires :
« Que ne peut-on pousser ceux qui sont profondément mécontents à se déclarer ouvertement en révolte ! Que ne peut-on les délivrer de la timidité qu’ils gardent vis-à-vis d’un monde agonisant qui veut ignorer ce qui peut se produire au-delà de lui-même, malgré lui, contre lui. Mieux vaut rompre non par goût de rompre, mais au profit de l’avenir[8]. »
Si sa version de sa rencontre avec Roger Bissière[9] depuis la gare de Villefranche du Périgord jusqu’à Boissiérettes (un lieu que nous avons visité il y a quelques années, en présence du petit-fils de l’artiste, Martin Bissière) à Marminiac (Lot) est jubilatoire, elle s’avère assez fantasmée, nettement fanfaronne, confrontée à la version décrite par Walter Lewino[10] et reprise par Serge Sanchez dans son ouvrage biographique, François Augiéras, le dernier primitif[11].
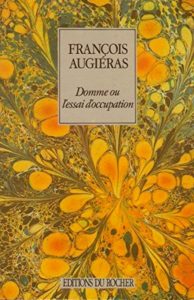 |
Il en sera tout autrement avec le dernier ouvrage d’Augiéras, Domme ou l’essai d’occupation dans lequel je me suis reconnu à la fois dans l’usure du temps, le rejet d’une société sans âme, l’aspiration à une autre civilisation que celle que nous traversons désabusés :
« Comme hier, je me suis arrêté au bord du précipice : il est bien certain que je n’ai pas envie de me tuer, mais celle, tout au contraire, de vivre sur cette planète comme nous vivons ailleurs, sans tenir compte des opinions et des lois du Petit Homme Actuel.
Les pensées humaines que Nous pouvons capter sont hideuses, bassement matérialistes, sans prolongement sur l’infini ! J’entends la triste rumeur du Petit Homme Actuel, plus moraliste que religieux dépourvu de sens métaphysique, une caricature d’être humain. Un être au psychisme étroit. Des hommes coupés de leur passé fabuleux, ayant perdu le souvenir de l’Homme Ancien, des êtres réduits à eux-mêmes, à un temps et à un espace dérisoires, exilés de leurs origines stellaires, inconscients des vastes pulsations de l’Univers-Divin… Une civilisation désacralisée, coupée de l’Univers par Moïse ou le Christ ; elle est minuscule, elle touche à son terme[12]. »
Comme Joseph Delteil, François Augiéras, médium, est un des prophètes de l’An 2000. Précurseur, il annonce des temps nouveaux : « …Nous allons façonner l’Homme à Notre Image : L’Homme du Verseau. Il rejettera de la nouvelle humanité ce qui appartient à une mentalité condamnée. Nous allons l’aider à réintégrer d’antiques pouvoirs, par Notre présence, discrète, secrète. Nous allons le ramener à l’Univers des astres. En cette fin du XXe siècle, c’est le seul « travail » digne de ce nom ; le reste appartient aux morales, aux aliénations collectives, aux Lois, au vent[13]. »
Dans son Journal de Paris, 1965-1985, Jean Chalon qui entretenait une correspondance[14] avec François Augiéras, apprend le 14 décembre 1971 sa disparition : « François Augiéras est mort hier à l’hospice de Périgueux. Il ne sert à rien de pleurer cette perte, irréparable de l’un des plus grands esprits de notre siècle […] Dans sa dernière lettre Augiéras me confiait le soin de publier son dernier ouvrage, Domme ou l’essai d’occupation, déjà refusé par plusieurs éditeurs, que mon enthousiasme pour Domme n’avait pas réussi à convaincre […] Il est l’auteur de livres majeurs, de chefs-d’oeuvre comme L’Apprenti sorcier, Le Voyage des morts, Le Vieillard et l’enfant, pour ne citer que ceux-là, puisque c’est toute l’œuvre d’Augiéras qu’il faut citer. Je vais tout faire pour que Domme soit enfin publié[15]. »
Au printemps de 1982, Domme ou l’essai d’occupation parait enfin chez Fata Morgana, sans rencontrer cependant l’intérêt immédiat que Chalon en espérait. Il y faudra plus de temps encore. Enfin, Augiéras a aujourd’hui trouvé sa place dans la littérature française.
Dans François Augiéras, trajectoire d’une ronce, Jacques Isolery a écrit : « François Augiéras (1925-1971), écrivain et peintre, fascina assurément ceux qui eurent la chance difficile de son amitié. Aventurier de l’esprit, explorateur des corps, grand amoureux de l’âme, il concentra dans son œuvre ce que l’on a essentiellement retenu d’elle ; un érotisme généralisé et souvent scandaleux, un panthéisme anachronique, une pensée magique et une agression intempestive face à toutes les formes de ‟dé-cadence” et d’entropie nihiliste de notre civilisation occidentale. Son parcours, souvent épineux, fut celui d’une ronce projetée dans un ordre cosmique pour y tracer le motif de la valeur. Ses fleurs et ses fruits devaient annoncer l’ère des Nouveaux Nobles de la Terre[16]… »
Jean Chalon et José Correa publiaient, en 2005, à La Lauze, un album de portraits féminins (Lola Flores, Colette, Nathalie Barney, George Sand), intitulé Mes Quatre Déesses. Lorsque les années se sont écoulées, nous « n’avons plus que des possessions », « des dévotions », nous contemplons alors « le temps des sillages » ; parfois, tel que le fait Jean Chalon, nous les traçons sur le papier. Chalon, « l’éternel séduit » se sera passionné et aura écrit sur d’autres femmes encore, Alexandra David-Néel (Le lumineux destin d’Alexandra David-Néel), Louise de Vilmorin, Florence Jay-Gould (Florence et Louise les Magnifiques)… Cependant, le lien originel entre les deux artistes n’est aucune de ces déesses, mais l’écrivain et peintre François Augiéras, dont Chalon est l’exécuteur testamentaire. Le texte de l’écrivain débute ainsi : « Moi, simple mortel, j’ai vécu avec mes déesses… », et moi, qui suis un lecteur de ses journaux [Journal de Paris (1963-1983), L’Ami des arbres, Journal d’Espagne (1973-1998), Journal d’un biographe (1984-1997), Journal d’un arbre (1998-2001), Journal d’un lecteur (2002-2004), Journal d’un rêveur professionnel (2005-2007) Journal d’un Ours (2008-2011)], je peux attester de la présence constante de ces déesses dans ses pensées, dans ses rêves.
Dans son Journal précité, Jean Chalon, le 14 février 2005 confie : « … Je feuillette mon album illustré par José Correa, Mes quatre déesses, avec, par ordre d’entrée dans ma vie : Colette, Lola Flores, Natalie Barney, George Sand. Je passe ce jour de saint Valentin en compagnie de mon soleil et de mes quatre déesses. Que peut-on souhaiter de mieux ?[17] »
Dans cet ouvrage rangé dans une de mes bibliothèques, où s’alignent nombre des albums de José, je retrouve une carte illustrée par ses soins avec ces mots : « Merci, cher Alain, pour ton mot plein d’émotion. Je suis heureux que ce livre t’ait touché. Si tu connaissais Jean Chalon, tu l’aimerais davantage. Cet homme est tellement vivant et… si drôle… capable de chanter et danser en évoquant Lola Flores. Tant d’amour pour « ses Déesses »… je te raconterai. »
Un matin, de bonne heure, il faisait nuit encore, je m’émerveillais des annotations de Jean Chalon, dans le Journal d’un arbre[18], inscrites entre le lundi 10 mai et le jeudi 13 mai 1999. On comprend aisément mon adhésion à cette poésie des jours, simple, éternelle, qui invite au secret, à la contemplation, au silence, au détachement, à la sagesse :
« Une journée céleste. En effet, le ciel semble descendre sur la terre, porté par les ailes du vent… C’est la première fois depuis longtemps que je sens l’odeur du soir d’été, incomparable, inimitable odeur qui semble surgie de la plus lointaine enfance. » (Lundi 10 mai 1999)
« La beauté du jour est telle que l’on peut se croire immortel, et cette immortalité-là vaut bien les autres ! Je pourrais dire, comme Colette dans La Naissance du jour : « c’est une belle saison de ma vie que je passe. » (Mercredi 12 mai 1999)
« J’aime de plus en plus le silence. » (Jeudi 13 mai 1999)
Je dois encore à José ma découverte et la lecture de Mia Couto[19], écrivain portugais qui vit au Mozambique.
 |
|
Lisbonne, Café A Brasileira, Fernando Pessoa, Léo & José Correa, 1995©José Correa |
Pierre Fanlac, à Périgueux, édite la première traduction française du poème aujourd’hui le plus célèbre de Fernando Pessoa (1888-1935) : Bureau de Tabac.
Je ne suis rien
Je ne serai jamais rien.
Je ne puis vouloir être rien.
A part ça, je porte en moi tous les rêves du monde[20]…
En 1994, José m’en offrait une nouvelle version publiée aux ‟Éditions Unes” dans la traduction de Rémy Fourcade avec cette dédicace : « ‟J’ai rêvé plus que Napoléon n’a conquis…” à Alain, cet instant nocturne et intemporel… en Amitié. »
Ce fut une rencontre essentielle pour moi, la découverte d’un univers avec lequel je me sens en pleine concordance, exception faite partiellement cependant pour son ouvrage, Le Livre de l’Intranquillité[21]. Dans le recueil intitulé Le Gardeur de troupeaux, signé de l’hétéronyme Alberto Caeiro, on trouve comme un pré-écho des idées développées par François Augiéras dans Domme ou l’essai d’occupation :
Poème XXXVIII
Béni soit le même soleil d’autres contrées
qui me rend frère de tous les hommes,
puisque tous les hommes, un moment dans la journée, le regardent comme moi,
et en ce moment pur,
tout de sérénité et de tendresse,
ils retournent dans l’affliction
et avec un soupir à peine sensible
à l’Homme véritable et primitif
qui voyait naître le Soleil et ne l’adorait pas encore.
Parce que cela est naturel – plus naturel
qu’adorer l’or et Dieu
et l’art et la morale…[22]
Ce qui me séduira par-dessus tout, c’est d’entrevoir une influence immensément poétique de la philosophie développée par la Théosophie et plus encore de Jiddu Krishnamurti (alors attendu tel un Messie) dont Pessoa était un des traducteurs :
Poème VI
Penser à Dieu, c’est désobéir à Dieu
car Dieu a voulu que nous ne le connaissions pas,
aussi à nous ne s’est-il pas montré…
Soyons simples et calmes
comme les ruisseaux et les arbres,
et Dieu nous aimera, nous rendant
beaux comme les arbres et les ruisseaux,
et il nous donnera la verdeur de son printemps
et un fleuve où nous jeter lorsque viendra la fin !…[23]
Poème XXV
Les bulles de savon que cet enfant
s’amuse à tirer d’un chalumeau
sont dans leur translucidité toute une philosophie.
Claires, inutiles et transitoires comme la Nature,
amies des yeux comme les choses,
elles sont ce qu’elles sont,
avec une précision rondelette et aérienne,
et nul, même pas l’enfant qui les abandonne,
ne prétend qu’elles sont plus que ce qu’elles paraissent.
Certaines se voient à peine dans l’air lumineux,
Elles sont comme la brise qui passe et qui touche à peine les fleurs
et dont nous savons qu’elle passe, simplement
parce que quelque chose en nous s’allège
et accepte tout plus nettement[24].
Poème XVIII
Plutôt le vol de l’oiseau qui passe sans laisser de trace,
que le passage de l’animal, dont l’empreinte reste sur le sol.
L’oiseau passe et oublie, et c’est ainsi qu’il doit en être.
L’animal, là où il a cessé d’être et qui, partant, ne sert à rien,
montre qu’il y fut naguère, ce qui ne sert à rien non plus.
Le souvenir est une trahison envers la Nature,
parce que la Nature d’hier n’est pas la Nature.
Ce qui fut n’est rien, et se souvenir c’est ne pas voir.
Passe oiseau, passe, et apprends-moi à passer ![25]
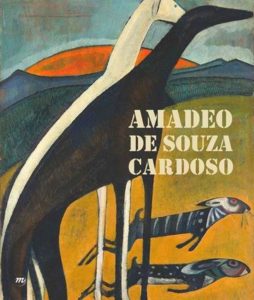 |
|
Catalogue de l’exposition du Grand Palais 20 avril-18 juillet 2016 |
Ce n’est qu’en 2016 que j’ai découvert la peinture et la vie d’Amadeo De Souza-Cardoso (1887-1918) et que j’ai eu la curiosité de savoir s’il avait connu Fernando Pessoa (1888-1935). De bonne heure, Amadeo avait quitté la demeure familiale de la vallée du Douro pour Paris où il devint un proche d’Amedeo Modigliani et de Constantin Brancusi. Rapidement il fut un des artistes parmi les plus recherchés avec Pablo Picasso, Georges Braque… Reconnu comme un des talents les plus prometteurs de la jeune peinture que le Paris des ‟Heures chaudes de Montparnasse” allait rendre célèbres. L’exposition du 20 avril au 18 juillet 2016, au Grand Palais, rendait enfin justice à ce génie inconnu de cette période aussi faste qu’éblouissante. Un film de Christophe Fonseca[26] accompagnait cette superbe exposition, ainsi qu’un gros volume de près de 300 pages consacré à cet artiste par le Grand Palais, Galeries nationales et la Fondation Calouste Gulbenkian (2016). Décédé à 31 ans, Amadeo disparut de la pléiade des peintres les plus prometteurs de son temps. Sa veuve éplorée vécut au secret avec les tableaux d’Amadeo ; le temps de sa longue vie instaura l’oubli.
À la déclaration de guerre, Amadeo De Souza Cardoso revint dans sa famille au Portugal où il vécu entre 1914 et 1918. Par ailleurs, à Lisbonne, la première manifestation organisée du modernisme au Portugal vit le jour grâce à l’enthousiasme de Fernando Pessoa et de Mário de Sá-Carneiro. Ce fut principalement la revue Orpheu[27], publication à vocation littéraire mais qui est ouverte aux arts visuels à la manière de la revue Blast[28]. Chacun y contribuant en toute indépendance.
Ainsi, Helena de Freitas dans le premier chapitre du catalogue d’exposition du Grand-Palais, en 2016, intitulé « Le saut du lapin » relève : « Il est possible qu’Amadeo et Pessoa ne se soient croisés qu’une fois, lors du dîner organisé par Almada à l’occasion de l’exposition du peintre à Lisbonne, mais on devine une curiosité mutuelle et un désir de rapprochement. Il existe une carte astrale d’Amadeo faite par Fernando Pessoa, ainsi qu’une enveloppe adressée au poète, mais non envoyée, dans le fonds d’Amadeo ; des lettres à des tiers contiennent des références concrètes au sujet du désir qu’avait Pessoa de voir Amadeo participer au troisième numéro d’Orpheu avec quelques hors-texte.
Mais il y a, principalement, une proximité évidente entre Amadeo et Pessoa, plus particulièrement Álvaro de Campos, le plus cosmopolite de ses hétéronymes, certainement due à l’attention que le peintre porte à l’écriture et à la pensée de l’écrivain. L’existence dans la bibliothèque d’Amadeo du second numéro de la revue – dans lequel Álvaro de Campos publia son Ode maritime (dans le premier numéro figurait son Ode triomphale qu’Amado avait certainement lue avec beaucoup d’intérêt et Mário de Sá-Carneiro, le poème Manucure – soutient l’hypothèse d’une coïncidence thématique entre ces hymnes poétiques à la modernité et les peintures prenant entre autres pour thèmes les signes de la vie urbaine et cosmopolite : moteurs, ports, publicités, journaux, TSF et électricité, nommant les produits, les marques et les machines. Le peintre établit une homologie entre image littéraire et visuelle, et va jusqu’à reproduire les mots des poèmes dans la peinture[29]. »
* * *
 |
| José Correa, 2020©Cliché Pierre-Yves Besse |
José Correa est de ceux qui vous tracent des chemins buissonniers, des chemins qui nous font échapper au réel, à l’écrasement du monde, mais en contrepartie il vous veut à lui, dans une fidélité exclusive, croyant vous avoir assez offert, pour prétendre à ce privilège. Sa fabuleuse générosité exige cette contrepartie. Mine de rien c’est un affectif. Je ne le suis pas. Ma mère avait trahi ma confiance d’enfant, après, je n’ai plus cherché d’attachement exclusif. J’ouvre le dialogue, mais je reste insaisissable, c’est ma liberté à moi, terriblement privative, mais par ailleurs, immense et vaste… José m’a blessé et je l’ai blessé. Il était trop libre et moi trop peu. Ma liberté était uniquement celle du rêve. Il existe pourtant une connivence irrépressible, un sentiment d’être frères, des frères qui parfois se boxent, mais qui se savent complices. Je n’ai pas connu la rue, Augiéras était bien élevé, moi aussi (trop même, dira un jour notre amie commune, Madeleine Marcoux), José est sans raffinement ou usure sociale, la rue est fertile autant que violente, âpre et demande pour assurer sa propre survie plus d’animalité que j’en ai connue, et dont on m’a toujours protégé ! J’ai vécu tel un prince pauvre, ma famille avait fait ce choix pour moi, José a dû inventer sa principauté à la force de ses poings et de ses crayons. Nous nous rejoignons peut-être dans le conseil que suggère une des dernières lettres de François Augiéras adressée à José, en 1969 : « … en réalité, je suis un homme assez mystérieux, assez sauvage. J’ai ma vie secrète ! Je te conseille d’en faire autant, dans la mesure du possible. Chez toi aussi, il y a un côté assez mystérieux, un peu arabe[30]. »
Ce qui semble justifier la formule de la grande amie de Jean Chalon, Natalie Barney : « La récréation ne sera jamais terminée entre nous[31]. »
« Jouer le jeu, c’est jouer avec le feu. Rester enfant, c’est vivre mille ans en un seul instant[32]. » ♦
[1] Jean Chalon, Journal d’un rêveur professionnel (2005-2007), Paris, Éditions de La Différence, 2008, p. 25.
[2] Louis Toffoli est un peintre français né à Trieste (Italie) en 1907, d’un père italien et d’une mère slovène. Il est décédé début 1999, à Paris. L’œuvre de Louis Toffoli est connue dans le monde entier. Les toiles de Toffoli s’imposent d’emblée au visiteur, la lumière est transparente traversant toutes les formes, elle semble sortir des peintures et l’impression de pureté qui s’en dégage crée une profonde intimité avec les personnages. Louis Toffoli serait à la recherche d’une vérité intérieure inhabituelle, les couleurs et les lumières vibrant dans ses peintures font chanter les motifs de la toile et ravissent les spectateurs. Louis Toffoli utilise différentes techniques pour ses œuvres : peinture à l’huile, lithographie, tapisseries. Les sujets se retrouvent ainsi sur différents supports, la lumière transparaissant de manière différente selon le support. Louis Toffoli consacre une période de son œuvre au travail sur la lumière à la lithographie. Il dédie aussi une œuvre au travail du lithographe avec La Presse à bras. (Galerie 125.fr)
[3] José Correa, Augiéras, le maître des Fougères, Périgueux, La Lauze, 2007, p. 27-39
[4] Préface de Paul Placet, « Pour un premier Salon de Peinture » dans l’ouvrage de José Correa, Augiéras le maître des Fougères, Périgueux, La Lauze, 2007, p. 12.
[5] François Augiéras, une rencontre singulière (Parcours d’un écrivain radical et d’un peintre visionnaire (1925-1971), Bibliothèque patrimoniale et de recherche du Pays de Cahors, 2006, p.12-13.
[6] Ibid., p. 17.
[7] José Correa, Augiéras, le maître des Fougères, Périgueux, La Lauze, 2007, p. 27-39
[8] François Augiéras, La Trajectoire, une adolescence au temps du Maréchal, Saint-Clément-de-Rivière, Fata Morgana, 1980, p. 302-303.
[9] Ibid., chapitre « Bissière » et « Bissière, suite et fin », p. 309-347.
[10] Walter Lewino, Pardon, pardon mon père, Paris, Bernard Grasset, 2001, ps. 107-113.
[11] Serge Sanchez, François Augérias, le dernier primitif, Paris, Bernard Grasset, 2006, chapitre « Bissière et frère Soleil » p. 258-272.
[12] François Augiéras, Domme ou l’essai d’occupation, Monaco, Éditions du Rocher, 1990, p. 31-32.
[13] Ibid., p. 141.
[14] François Augiéras, Le Diable ermite, lettres à Jean Chalon, 1968-1971, Paris, Éditions de La Différence, 2002.
[15] Jean Chalon, Journal de Paris, 1963-1983, Paris, Plon, 1999, à la date du mardi 14 décembre 1971, p. 94-95
[16] Jacques Isolery, François Augiéras, Trajectoire d’une ronce, Paris, L’Harmattan, 2011, quatrième de couverture.
[17] Jean Chalon, Journal d’un rêveur professionnel (2005-2007), Paris, Éditions de La Différence, 2008, p. 21.
[18] Jean Chalon, Journal d’un arbre (1998-2001), Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003.
[19] Mia Couto, né le 5 juillet 1955 est un écrivain mozambicain, fils de Portugais qui ont émigré au Mozambique au milieu du XXe siècle. Après avoir commencé des études de médecine, il débuta dans la profession de journaliste à la fin de la dictature de Salazar. Nommé à la tête de l’Agence d’Information du Mozambique (AIM), il a ainsi créé des réseaux de communications entre les provinces mozambicaines durant la guerre d’indépendance. Puis il travailla comme directeur au journal ‟Tempo” jusqu’en 1981 et continua sa carrière au ‟Noticias” jusqu’en 1985. Il reprit alors ses études universitaires dans le domaine de la biologie. En plus d’être considéré comme l’un des auteurs les plus importants du Mozambique, Mia Couto est aussi l’écrivain le plus traduit (allemand, français, anglais, espagnol, catalan, italien). Dans plusieurs de ses œuvres, il tente de recréer la langue portugaise avec l’influence mozambicaine, utilisant le lexique et le vocabulaire des diverses régions du pays, produisant ainsi un nouveau modèle d’écriture africaine. Sans doute l’un des écrivains les plus célèbres de son pays. En 2013, il reçoit le Prix Camões, plus haute distinction attribuée à un auteur de langue portugaise, pour l’ensemble de son œuvre. Parmi ses œuvres traduites en français, Terre somnambule (1994), Les Baleines de Quissico (1996), La Véranda au frangipanier (2000), Chronique des jours de cendre (2003), Tombe, tombe au fond de l’eau (2005), Le Fil des missangas (2010), L’Accordeur de silences (2011), La Pluie ébahie (2014), La Confession de la lionne (2015). (d’après WikipédiA).
[20] Fernando Pessoa, Bureau de Tabac, Le Muy (Var), Éditions Unes, 1988, réimpression 1990, p. 11.
[21] Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquillité, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 1995.
[22] Fernando Pessoa, Le Gardeur de troupeau et autres poèmes d’Alberto Caeiro avec Poésies d’Alvaro de Campos, poème XXXVIII, Paris, nrf, Poésie/Gallimard, 1993, p. 90.
[23] Ibid., p. 22.
[24] Ibid., p. 75.
[25] Ibid., p. 95
[26] Le film de Christophe Fonseca, Amadeo de Souza-Cardoso, le dernier secret de l’art moderne qui accompagne l’exposition au Grand Palais est désormais disponible en DVD. Le documentaire démarre comme une enquête au nord du Portugal sur les traces du peintre. Un film de 52 minutes pour découvrir cet artiste trop longtemps occulté dans l’histoire de la peinture moderne, coproduit et édité par la Rmn-Grand Palais et France 5.
[27] Orpheu – Revue Trimestrielle de Littérature n’a eu que deux numéros, correspondant aux deux premiers trimestres de 1915, le troisième numéro ayant été arrêté à cause de difficultés de financement. Malgré cela, la revue exerça une notable et durable influence : son avant-gardisme inspira les mouvements littéraires issus du renouveau de la littérature portugaise. Avec une première réaction critique négative, Orpheu introduisit au Portugal le mouvement moderniste, associant dans ce projet des noms importants des arts et des lettres, tels que Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros ou Santa-Rita Pintor, connus sous le nom de Génération Orpheu.
[28] Les vorticistes avaient leur propre revue, Blast, éditée par Lewis et qui a publié en particulier des travaux d’Ezra Pound et de T. S. Eliot. Son inventivité a été considérée par El Lissitzky comme une des avancées majeures de la révolution du design graphique des années 1920 et 1930. Première parution 2 juillet 1914.
[29] Catalogue de l’exposition au Grand Palais du 20 avril au 18 juillet 2016. Paris, Grand Palais, Galeries nationales et la Fondation Calouste Gulbenkian, 2016, p. 23-24.
[30] François Augiéras, lettre du 23 mai 1969 adressée à José Correa, incluse dans l’ouvrage de José Correa, Augiéras, le maître des Fougères, Périgueux, La Lauze, 2007, p. 72.
[31] Jean Chalon, Journal d’un lecteur, 2002-2004, Paris, Plon, à la date du jeudi 31 octobre 2002, p. 64.
[32] Jean Chalon, Journal d’un arbre, 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, à la date du dimanche 4 juin 2000, p. 147.
Dimanche 9 février 2020
En lisant Jean Chalon
Mon texte pour l’anniversaire de José Correa prenant plus de temps que prévu par ses développements, je ne voudrais pas demeurer muet trop longuement. Depuis quelques jours je suis plongé dans des mémoires titrées ‟Journal de…” dans lesquelles depuis des années je trouve matière à réflexion.
Nous parlons de Jean Chalon, connu comme biographe d’égéries (Lola Flores, George Sand, Natalie Barney, Alexandra David-Néel, Colette, Liane de Pougy… Récente acquisition : son Journal d’un Biographe, 1984-1997.
 |
À la date du mercredi 20 mars 1985, il nous confie : « Annick Geille, qui dirige Femme, m’a commandé un article sur le luxe parce que je lui ai fait remarquer que, une rose dans un verre, c’est déjà le luxe. Une rose, une seule, suffit à exprimer le luxe et ses splendeurs. Il faut évidemment y accorder toute l’attention requise et découvrir comment chaque pétale se prend pour un soleil rond et odorant. Douze douzaines de roses entassées dans une vasque d’albâtre, c’est exactement le contraire du luxe, c’est une insanité de nouveau riche[1]. »
Le nouveau riche voici le délit, l’injure. L’écrivain est attentif aux difficultés des autres, aux souffrances des défavorisés. Ainsi à la date du jeudi 22 août 1991, je relève cette réflexion toujours aussi cruellement d’actualité :
« À Franprix, devant la publicité, ‟achetez moins cher”, un vieux monsieur, très digne et qui a l’ait très pauvre, murmure : ‟achetez moins cher, qu’est-ce que ça peut faire, quand on n’a pas d’argent.” Ils sont plus nombreux que l’on ne croit, ces vieillards dont on prolonge la vie, sans leur donner de quoi vivre[2]. »
Mon idée de la culture, même si j’y ai personnellement beaucoup investi, est proche de la sienne, François Augiéras en avait acquis une universelle dans le plus grand dénuement :
« La culture, comme l’amour, se pratique chez soi, entre quatre murs, avec des livres empruntés à la bibliothèque municipale, des disques, des reproductions de tableau. On n’a pas besoin de beaucoup d’argent pour se cultiver. J’en ai assez d’entendre associer culture et argent, culture et crédit. La culture n’est pas un objet de luxe, c’est un objet de première nécessité qui doit être à la portée de tous. Par exemple, dans le métro, à la place de l’éternel panneau vantant les bienfaits des sous-vêtements, on devrait nous offrir un poème d’Anna de Noailles ou de Louise de Vilmorin. Comme disait je ne sais plus qui : ‟Le seul théâtre populaire, c’est le théâtre gratuit.” La seule culture est celle que l’on se dispense gratuitement entre les quatre murs de sa chambre[3]. »
Désigné par François Augiéras comme son exécuteur testamentaire, Chalon a beaucoup fait pour la reconnaissance de cet ami qu’il n’a jamais rencontré. Il est celui qui aura fait publier Un Voyage au Mont Athos, Domme ou l’essai d’occupation et sous le titre Le Diable ermite[4], les lettres que François Augiéras lui avait adressées entre 1968 et 1971. Qui sait ce que François Augiéras doit aujourd’hui de sa renommée, de manière posthume, mais bien réelle, au dévouement de Jean Chalon ? C’est ici une générosité assez rare entre deux écrivains pour qu’il soit juste de la souligner. ♦
[1] Jean CHALON, Journal d’un biographe, 1984-1997, Paris, Plon, 2001, ps. 46-47.
[2] Ibid., p. 196.
[3] Ibid., p. 14-15.
[4] Dans sa réponse à l’éditrice, intitulée Une curieuse amitié, Jean Chalon écrit : « Dans ces lettres, je m’aperçois que je n’ai pas été à la hauteur de François Augiéras que je considère comme un maître dont je n’étais que le serviteur lointain… », Le Diable ermite, lettres à Jean Chalon, 1968-1971, Paris, Éditions de La Différence, 2002, p. 9.
Janvier 2020
Du jeudi 29 au vendredi 31 janvier 2020
Clairières dans le ciel
Être là ou pas. Lorsqu’on vieillit est-on là pour soi ou pour ceux qui arrivent et à qui est proposé un esclavage plus radical que celui que nous avons vécu en faisant semblant de croire à notre liberté ? Comment dans les métiers manuels à haut risque d’usure, invalidant, pourra-t-on travailler jusqu’à 67 ans lorsqu’aujourd’hui un travailleur licencié de plus de 55 ans n’a pas beaucoup d’opportunité pour retrouver un emploi ?
On croit rêver à observer ces ministres kitsch, si loin de la réalité quotidienne, vouloir nous persuader du bien-fondé de leurs inepties qui ne sont qu’une mise sous la botte ; l’arsenal policier n’étant que l’apparence de ce qui est sous-entendu à long terme.
La retraite universelle est un leurre puisque déjà plusieurs régimes spéciaux sont reconduits… sauf à imposer, si la tension sociale vient à fléchir, aux policiers et gendarmes, par ordonnance, la révision de ce qu’ils viennent d’obtenir. On se doute, qu’il n’y aura alors plus personne dans les rues pour lutter à leurs côtés. L’on observe tout de même que la parole donnée en politique n’a rien de commun avec la probité, l’intégrité, qui d’ailleurs ne sauraient être des valeurs politiques viables, en un temps où la corruption est devenue la pratique usuelle.
Le projet de réforme des retraites est inabouti, incertain, particulièrement régressif pour tous et très injuste, contrairement aux bonnes paroles émises par ces spécialistes de l’enfumage.
Il est bien évident que nous devrions être tous solidaires et donc présents lors des manifestations, pour exercer une pression sur l’état-major autoritariste dont nous ne subissons que trop les sordides intentions.
Le capitalisme libéral est l’ennemi de nos sociétés, des citoyens et de nos conquis sociaux. L’accumulation des dividendes favorisée par l’exploitation du monde salarial n’a désormais pour unique bénéficiaire qu’un très petit nombre d’individus, ce qui est fondamentalement injuste. Le ruissellement évoqué par Emmanuel Macron, se révèle être une illusion insultante, il n’a strictement aucune existence. À contrario, il caractérise très clairement l’argent spolié aux salariés, artisans, commerçants pour abonder les comptes des actionnaires qui sont des inactifs, des prédateurs. Il existe donc un ruissellement institutionnel depuis toujours, abondant les castes dominantes, expropriant les producteurs de richesses ; richesses résultant du travail, des talents, de la créativité d’une vaste majorité de citoyens. Le plus souvent ce sont les ouvriers qui se trouvent spoliés des ressources qu’ils génèrent, bien pire encore, de leur santé physique… et de plus en plus de leur santé psychologique. Ainsi bientôt les vrais producteurs de la mirifique opulence de nos sociétés expropriatrices n’auront plus de droit à des années de retraite en bonne santé, et même éventuellement, assez souvent, pas de retraite du tout. Si cela n’est pas un ruissellement abject, alors que l’on me dise ce que c’est ? La réforme des retraites à points, au delà d’être un marché de dupe, est une escroquerie honteuse et en définitive criminelle.
Notre adhésion à la CGT ne devrait jamais être un réflexe d’autoprotection ou d’autopromotion, mais découler d’une volonté irréductible de participer à un mouvement global, en faveur d’intérêts collectifs, pour sauvegarder des droits conquis ou pour en conquérir de nouveaux. C’est tardivement que j’ai rencontré un jeune homme, qui avait alors 24 ans, doté, de par son ADN, son milieu familial, sa culture, de tout ce que l’on peut espérer à cet âge là, s’intéressant non pas égoïstement, narcissiquement, à lui-même, ce qui peut s’excuser chez un post-adolescent, mais regardant les plus petits d’entre-nous, ceux que l’on aperçoit sans les voir, sans souhaiter les voir, et rechercher les mots qui régénèrent, qui fortifient, qui donnent existence à ceux qui en ont fort peu et qui, avec le temps et l’habitude, participent à leur propre reniement. Je n’avais pas ce regard respectueux et bienveillant. Pourtant, je l’avais déjà observé, il y a fort longtemps, chez un autre inspecteur du travail, dans les années 70. Il était communiste et cégétiste. Sans le suivre dans ses appartenances, je l’admirais immensément pour son attitude qui allait de pair avec une fabuleuse intelligence, celle du cœur s’ajoutant à celle de l’esprit. Il n’y a pas d’authentique intelligence, sans cette complétude.
 |
| Mathieu Le Roch, Manif du 25 janvier 2020 |
Dans le combat collectif, nous n’avons qu’une importance relative, cependant considérable, lorsqu’elle s’ajoute à celle de tous les autres. Cette synergie est celle du combat constructif, des luttes persévérantes, des victoires solaires et de la solidarité fraternelle. Nous sommes parfois déçus, amers, car ce n’est pas toujours, ni bien souvent, que nos idées prédominent, le goût de l’anarchie individualiste perd alors ses droits et ses sortilèges. Sommes-nous là pour avoir raison CONTRE tous ou avoir raison AVEC tous ? L’objectif d’un authentique syndicalisme est toujours fédératif ; c’est toute l’exquise saveur du FAIRE ENSEMBLE.
 |
 |
|
| Manif du 9 janvier 2020 avec José Correa | Dessin de José Correa | |
Observateur de nos défilés, mon cher camarade José Correa, me dessine en porteur de deux drapeaux symboliques. Comme il le sait, un libre penseur tel que moi, rejetant tout cloisonnement, dogmatisme, se refuse à tout enrôlement ! Si j’ai une grande sympathie pour nombre de communistes en commençant par le grand résistant et maire que fut mon presque voisin, Roger Ranoux, je n’adhère qu’à la CGT, afin de poursuivre mon engagement professionnel à défendre les exploités, l’injustice m’ayant toujours révolté. Et si je suis venu au syndicalisme, fort tardivement, c’est grâce à l’exemple de Mathieu Le Roch, car son intégrité totale au service des autres est hautement convaincante. Ce n’est pas tous les jours que je rencontre des êtres aussi droits dans leurs bottes et dévoués à l’intérêt général.
 |
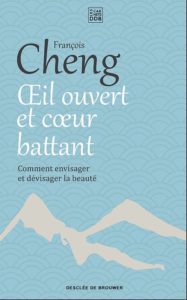 |
|
Dans La Grande Librairie de François Busnel, mercredi, sur France 5, l’invité d’honneur était François Cheng, que m’avait fait découvrir un ouvrage, Cinq méditations sur la beauté, offert par Monique Selva, il y a quelques années. À ses cotés, se trouvaient Christiane Rancé et pour moi, un total inconnu, Daniel Tammet.
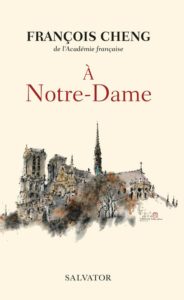 |
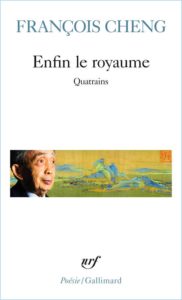 |
|
Nonagénaire, François Cheng par la passion qu’il met dans sa vie, nous montre la voie d’une longue existence, dans laquelle la fraîcheur d’esprit demeure inaltérable. Le sens de la vie est un de ses sujets essentiels de réflexion.
Daniel Tammet (né Daniel Paul Corney, en 1979, dans une famille modeste), un des génies des temps présents, est un personnage qui ne saurait laisser quiconque insensible. Anglais de naissance, enfant épileptique, jeune adulte détecté autiste Asperger, il est capable de tout ce qui nous échappe et nous échappera toujours, parlant treize langues, possédant une mémoire phénoménale. L’ouvrage qu’il présentait Fragments de paradis (Éditions Les Arènes), relate sa conversion au christianisme, à l’âge adulte. Né sous le spectre autistique (non reconnu ou défini à cette époque-là), il l’exprime ainsi : « Je me sentais étranger, même dans ma langue maternelle. » Comme il le dit encore « L’important n’est pas de vivre comme les autres, mais parmi les autres ». Et d’ajouter ailleurs : « Pour moi, la plume doit mettre en relief les failles et les fêlures, non les gommer. En commençant par les miennes : celles d’une enfance à Londres sous le spectre autistique et ma longue lutte pour apprivoiser le langage, les codes sociaux. À travers chaque brèche dépeinte, remémorée, je découvre une nouvelle ouverture sur le monde. »
 |
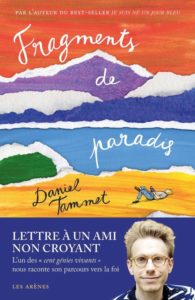 |
|
Finalement, j’ai laissé ce message sur la page Facebook de Daniel Tammet : « Je voulais regarder François Cheng et je vous ai découvert émerveillé. C’est ce que je pensais en observant un petit cousin de 4 ans, reconnu autiste, mais qui à mon avis sera bien autre chose qu’un enfant différent, silencieux, absent, perdu. Il possède quelque chose de spécial, et lorsque je vous ai entendu, j’ai compris que les plus beaux espoirs étaient permis pour ce magnifique enfant que certains rejettent et qui me fascine, car il possède ce qui sera toujours inaccessible pour nous. MERCI beaucoup, je vais lire vos livres. Vous étiez au diapason de cet homme merveilleux qu’est François Cheng, ce qui n’est pas rien ! C’est comme si, soudain, une fenêtre s’ouvrait toute grande sur un monde clos ! » ♦
Dimanche 26 janvier 2020
Comme un air de printemps au cœur de l’hiver
 |
| Page dédiée à ma Camarade Christine Soteras-Sudeix |
| Merci à nos camarades photographes |
Au retour de notre très belle et soleilleuse manif depuis le Palais de Justice jusqu’à la Gare de Périgueux de vendredi[1], j’étais privé d’accès à internet. Il me faudra attendre lundi 27 pour en principe, y revenir. Le temps d’un autre texte !
Hier samedi, comme vendredi, nous respirions comme un air de printemps même si les artilleurs du gouvernement fourbissent leur texte anti-démocratique, suicidaire pour LREM et son Pinocchio ostentatoire autant que ridicule. Dans son article, Périco Légasse, Cette andouillette qui fleure bon la France[2] on peut penser que le gouvernement est visé comme andouille, surtout à la lecture de la phrase d’Édouard Herriot[3] réputé pour son franc-parler : « L’andouillette, c’est comme la politique, ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop. » Sans aucun doute ce gouvernement de blanches-neiges corrompues a dépassé les limites qui rendent la recette recevable et l’odeur soutenable.
 |
 |
|
En début de manif, je recevais deux numéros de Marianne de la main de Christine Sudeix qui avait remarqué ma passion dévorante pour Jacques Offenbach. Le numéro précité sous la plume de Myriam Perfetti nous décrit l’historique de la reconstitution des Contes d’Hoffmann étapes après étapes, patientes recherches et découvertes. Le numéro 1161, du 11 au 20 juin 2019, propose un texte de Benoît Duteurtre[4] – un amoureux, peut-être un peu superficiel –, Offenbach, le Français universel[5], dans lequel il rappelle cependant un fait essentiel sur le compositeur, peu souvent évoqué : « Son influence mondiale sera foudroyante. Si l’Italie avait inventé l’opéra au XVIIe siècle, la France du XIXe siècle crée avec lui un genre aussitôt imité, adapté, réinventé dans chaque pays. À Vienne, l’autre capitale musicale du temps, Johann Strauss et Franz von Suppé s’inspirent des succès parisiens pour inventer l’opérette viennoise. En Angleterre, Gilbert et Sullivan raillent la société victorienne avec une frénésie héritée du compositeur de La Grande Duchesse de Gérolstein. La recette fait fureur jusqu’au États-Unis où Offenbach accomplit un grand voyage. Reçu comme un roi, il contribuera par ses œuvres à influencer ce genre encore hybride qui va devenir la comédie musicale. »
Pierrette interrompt ma rédaction : elle déborde de joie en m’annonçant que Julie et David Rivière ont fait le choix qu’elle devienne la marraine de Yann Rivière, de Monsieur la joie ! Ce petit bonhomme d’un peu plus d’un an, galope, parle et rit avec entrain, débordant de vitalité ; il est l’enfant le plus joyeux que j’ai vu dans ma longue vie. À côté de son frère aîné, le très sage Tom, voici un fort joyeux drille ! Pierrette est déjà la marraine du pâtissier par excellence de la famille, Alexandre Rivière, frère de David, l’heureux papa.
 |
 |
|
| Avec Christine Soteras-Sudeix | Avec Jacques Offenbach, manif du 24 janvier 2020 | |
Revenons-en à notre manif fort ludique de vendredi ! Déjà, pour la première fois, Jacques Offenbach a manifesté à mes côtés… preuve par l’image ! J’imagine qu’il eut apprécié d’assister sur le parvis de la gare à ce ballet en bleu, gants jaunes, foulards rouges (qui n’était cependant pas le Train Bleu[6]) exécuté par les jolies filles du cortège, sur des paroles nettement modifiées de la célèbre chanson « À cause des garçons » devenant, on s’en doute, « À cause de Macron ». Ce tube de la fin des années 80, est de nouveau, en ce moment, à la mode dans toute la France !
 |
| « À cause de Macron », 24 janvier 2020 |
Natacha Polony dans la rubrique « Notre opinion » de ce même numéro consacre un papier au Scandale des ‘faux steaks’, Le cauchemar du capitalisme low cost[7] : « À chaque scandale alimentaire, c’est la même litanie. On s’indigne, on nomme les coupables, on promet des contrôles bien plus sévères… et tranquillement on passe à la suite […] Que le Secours populaire et les Restos du cœur se retrouvent à distribuer des produits ignobles ne mobilise pas les foules. Les pauvres peuvent bien manger de la merde. C’est même toute la logique du système… » Et la journaliste de s’attaquer, un peu à la manière d’Attac France, du libre-échange, de la libre circulation des capitaux, des traités européens (il conviendrait d’y rajouter les traités internationaux, Tafta, Ceta…), formalisant l’acmé (apogée) de cette logique pour en arriver au triste constat : « Une société du moins-disant est une société qui s’appauvrit, non seulement économiquement puisque seuls les organisateurs de ce système en tirent profit, mais surtout humainement puisqu’elle se prive des savoir-faire, de la conscience, de la fierté professionnelle qui font le sel d’une existence. Elle fait du mensonge son fondement ontologique, en considérant que l’étiquette et la dénomination d’un produit n’ont aucun lien avec ce qu’il est réellement. Elle pousse les individus à accepter que les pauvres mangent de la merde, portent des vêtements jetables et soient mis en concurrence avec de plus pauvres encore. Le capitalisme du low cost repose finalement sur la destruction ultime de tout ce qui fait une vie digne et belle. Il est notre cauchemar contemporain. »
Nouvelle interruption d’écriture. Mais cette fois c’est une visite surprise de Pierrette et de sa belle-sœur Annick, visite pleine de joie et de présents ! Nous passerons un grand moment à parler de Yann et de Tom, photos et vidéos à l’appui. Je suis fasciné par Tom qui est le plus bel enfant au monde, blotti dans un monde secret qui préserve de manière inaltérable son absolue beauté. C’est un enfant magique.
Le journaliste Guy Konopnicki dépose une bombe dans l’urne funéraire avec son titre intitulé La privatisation des cendres[8] : « … La crémation étant un marché en pleine expansion, son développement éveille l’intérêt des sociétés privées […] alors même que l’entreprise municipale se montre des plus compétentes, la maire de Paris, qui semble toujours officiellement socialiste, entend confier ce marché à une entreprise privée. Question de principe : un service public menaçant d’être rentable ne saurait échapper à la privatisation[9]. » Le journaliste montre assez bien comment cette perspective est à l’image de toute la politique menée par la ville de Paris, tous âges de la vie confondus. Il conclut ainsi : « Le fric nous poursuivra jusqu’au bout. Tant pis pour ceux qui espèrent échapper au privé et ne pas procurer de bénéfices à une entreprise au moment de quitter ce monde. La brûlerie des morts sera privée, le profit fait feu de tout, même de nous-mêmes[10]. »
 |
 |
|
Mon cadeau de Noël retardé on ne sais trop comment, puisqu’il n’y pas de grève des transports en ce moment ! est arrivé vendredi dans ma boite aux lettres. L’écoute dans l’après-midi qui suit cette manifestation mémorable, est un enchantement. Offenbach colorature explore un Jacques Offenbach inspiré en permanence, y compris dans les œuvres les plus inconnues ou confidentielles. Ce nouvel album édité par le label Alpha Classics et le Palazzetto Bru Zane, spécialiste du répertoire romantique français, est entièrement consacré aux « sentiers peu fréquentés » empruntés par l’inépuisable maestro. On connaît trop ses galops, ses marches, ses polkas, un peu moins ses valses, ses romances, et en définitive le poète, maîtrisant l’art de la demi-teinte, qui se cache derrière les très voyants Oreste (turbulent, impertinent) et Mercure (primesautier, aérien). Personne ne connaît les joyaux que renferme Boule de neige (1871), première œuvre, fort décriée, représentée après la guerre de 70. On connaît assez peu Robinson Crusoé (1867), Vert-Vert (1869) deux opéras-comiques. Fantasio (1872) entre longtemps après sa création au répertoire de l’Opéra Comique. Ce disque est celui du bicentenaire tant il nous éclaire par la voix de colorature de Jodie Devos de l’inventivité du compositeur même lorsque le succès ne fut pas au rendez-vous. Les valses de Mesdames de la Halle (1858), Un mari à la porte (1859), Robinson Crusoé (1867), Boule de Neige (1871) savent nous convaincre de son talent pour un rythme que l’on attribue systématiquement aux compositeurs viennois. Ce disque a reçu éloges et récompenses et il faut s’en féliciter, il les mérite !
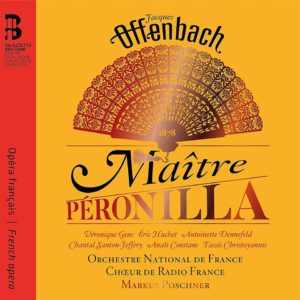 |
Et aujourd’hui, dimanche 26 janvier, Lionel, l’expéditeur du disque m’apprend que Maître Péronilla (1878) donné une seule fois en juin 2019 au Théâtre des Champs-Élysées en version de concert et retransmis sur France Musique, était désormais disponible en disque. On se doit d’en espérer autant de Madame Favart (1878) représentée à l’Opéra Comique à Paris, puis en province (nous l’avons vue à Limoges) une des ultimes partitions du maître. Les deux ouvrages étant soutenus par le Palazzetto Bru Zane. ♦
[1] Vendredi 25 janvier 2020, une manif très ludique sous un soleil printanier.
[2] Périco Légasse, Cette andouillette qui fleure bon la France, Marianne n° 1187, du 26 juillet au 1er août 2019, p. 82-83.
[3] Édouard Herriot, président à plusieurs reprises du Conseil, président de la Chambre des députés, puis de l’Assemblée nationale de 1905 à 1957 (un vrai règne).
[4] Benoit Duteutre, écrivain, présentateur de l’émission du samedi matin sur France Musique, Étonnez-moi Benoit. Il est le petit-fils du président René Coty.
[5] Benoît Duteutre, Offenbach, le Français universel, Marianne n° 1161 du 11 au 20 juin 2019, p. 66-68.
[6] Le Train bleu, ballet en 1 acte de Bronislava Nijinska, musique de Darius Milhaud, livret de Jean Cocteau, décors d’Henri Laurens, costumes de Coco Chanel. Le rideau de scène est peint d’après Deux femmes courant sur la plage, un tableau de Pablo Picasso. Création par les Ballets russes de Serge de Diaghilev au Théâtre des Champs-Élysées, le 20 juin 1924.
[7] Natacha Polony, Scandale des ‘faux steaks’, le cauchemar du capitalisme low cost, Marianne n° 1161 du 11 au 20 juin 2019, p. 3.
[8] Guy Konopnicki, La privatisation des cendres, Marianne n° 1161 du 11 au 20 juin 2019, p.58.
[9] Ibid., p. 58.
[10] Ibid., p. 58.
Du samedi 18 au mercredi 22 janvier 2020
Mobilisations, luttes sociales
 |
 |
|
|
Texte dédié à mon Camarade Mathieu Le Roch, pour ses 36 ans, et son engagement sans faille |
||
Clément Couzy le disait fort limpidement à Saint-Léon-sur-L’Isle : « Le néo-féodalisme macronien à la botte du capitalisme mondial, continue de privatiser le pays et ses institutions. Il ne cesse de paupériser les classes moyennes et affaiblit les plus fragiles à coups de réformes antisociales. C’est ainsi que les travailleurs, chômeurs, retraités nous nous voyons dépouillés, chaque jour, un peu plus […] Oui, le capitalisme tue, et il tue brutalement. Il n’a ni remord, ni regret et surtout il en veut toujours plus. Cette maladie broie l’humain, les familles, les rêves. Nous savons tous, nous ici présents, qu’un autre modèle de société est possible… »[1]
 |
 |
|
Il est bien évident que d’autres modèles sociétaux sont possibles. Cet accaparement des richesses est proprement scandaleux, d’une sordide malhonnêteté et effectivement n’hésite pas à détruire et à tuer sans beaucoup d’états d’âme pour atteindre ses objectifs. Le modèle des dictatures sous des formes plus insidieuses fonctionne en permanence dans nos sociétés vouées à la domination de l’argent.
 |
 |
|
| Cortège, Jean-Baptiste Evrard en chat perché © José Correa | Cortège et Robert Puydebois, animateur © José Correa | |
Depuis le 5 décembre 2019, des foules, sans doute encore insuffisantes[2] vu l’enjeu, foulent les rues de nos villes, pour contester la réforme des retraites par points, une infamie, qu’avait évoqué, lors de la présidentielle de 2017, François Fillon, devant le Medef, c’est dire si cette réforme comble d’aise les « premiers de cordée » autrement dit, les arnaqueurs. Si nous étions 7000 au départ, nous sommes toujours désormais entre 2000 et 3000 sur Périgueux, ce qui n’est pas mince, lorsqu’on observe la densité et la longueur des cortèges. Malgré une impopularité qui instaure désormais tous les dangers, le président qui nous a été concocté par les financiers, les usuriers et un patronat encouragé par les largesses du précédent quinquennat, sous la présidence d’un traître, François Hollande, n’est que mépris et arrogance ! C’est depuis, entre le 49.3 et un État d’Urgence permanent, le déni de toute démocratie. Si bien que la marionnette folichonne du Capital a un peu de mal à enfumer le territoire de ses discours aussi vides que sa cervelle de petit bourgeois exalté par sa narcissique sottise.
 |
| Manif du 16 janvier 2020, cliché Jean-Baptiste Evrard |
 |
| Manif du 16 janvier 2020, photo Pierre-Yves Besse |
Dans un texte intitulé Pauvres esclaves, publié, en 1937, dans ‘Le Figaro’, le poète Léon-Paul Fargue évoquait la faillite de l’humanisme : « Il n’y a pas si longtemps, nous, les hommes, étions encore maîtres des événements petits ou grands, du temps, de la durée et du cours des choses. Nous étions les seigneurs d’une vaste classe qui nous obéissait. La toute-puissance était humaine. Les sommets étaient humains […] Aujourd’hui ce sont les événements qui nous dirigent. Ce que nos pères appelaient les grands faits sont devenus des êtres qui jouent à la main chaude avec des populations désarçonnées[3]… » Si le poète attribue ce changement à la nouvelle souveraineté qu’impose le téléphone précipitant et brouillant tout dans la vie des humains, depuis, d’autres pièges s’y ajoutent, en ruinant toute indépendance d’esprit et en particulier la fourberie des médias tous ou presque aux mains des magnas de l’argent, des milliardaires, s’érigeant en promoteur d’une propagande ne connaissant ni scrupule, ni honte.
 |
En décembre 1995, en plein mouvement social contre le « Plan Juppé », Pierre Bourdieu contestait, dans une intervention à la gare de Lyon, la certitude technocratique du Premier Ministre en ces termes : « Cette noblesse d’֤État, qui prêche le dépérissement de l’État et le règne sans partage du marché et du consommateur, substitut commercial du citoyen, a fait main basse sur l’État ; elle a fait du bien public, un bien privé, de la chose publique, de la République, sa chose. Ce qui est en jeu, aujourd’hui, c’est la reconquête de la démocratie contre la technocratie : il faut en finir avec la tyrannie des « experts », style Banque mondiale ou FMI, qui imposent sans discussion les verdicts du nouveau Léviathan, « les marchés financiers », et qui n’entendent pas négocier, mais « expliquer » ; il faut rompre avec la nouvelle foi en l’inévitabilité historique que professent les théoriciens du libéralisme ; il faut inventer les nouvelles formes d’un travail politique collectif de prendre acte des nécessités, économiques notamment (ce peut être la tâche des experts), mais pour les combattre et, le cas échéant, les neutraliser.[4] »
Vingt cinq ans après, le texte de Pierre Bourdieu n’a pas pris une ride, au contraire il dépeint le tableau exécrable de ce que nous vivons : une phase avancée de démolition, cogitation d’une pseudo élite irrécupérable et particulièrement dangereuse. Je ne crois plus à d’innocentes ou spéculatives intentions, mais à une volonté d’appropriation du bien collectif pour engraisser des intérêts privés (que le système du pantouflage facilite et favorise). Nous sommes donc face à des prédateurs, à des escrocs. L’accélération du processus sous la présidence Macron est propre à faire mieux saisir cette captation, son ampleur et la disparition des services publics que subissent les usagers. Ce dont le prince-président se félicite avec ses commanditaires et comparses, me semble les mettre à nu devant la colère et la vindicte populaire. Avec pour conséquence de ne plus pouvoir se déplacer qu’avec une armée titanesque de policiers, ce qui n’est pas vraiment bon signe. L’injustice poussée en ses extrêmes est d’un danger sans nom pour toutes ces boursouflures. Vouloir le pouvoir et s’en glorifier est une chose, assumer la pression sans trêve du Capital en est une autre, qui pourrait s’avérer mortelle.
 |
 |
 |
||
| Le JOINT © Chantal Montellier | Le POING © Guy Hervy | |||
 |
 |
|
| Nad LAM | ||
En réplique à la couverture plus que provocatrice du Point, Chantal Montellier publie une excellente parodie du journal qu’elle intitule Le Joint :
« Comment Macron enfume la France, corruption, dilapidation, pognon, millions, additions… »
Le Point, sur son site Facebook, invite à répondre à un sondage « VOTEZ. Selon-vous, la CGT ruine-t-elle la France ? » tout en affichant des images désobligeantes du leader de la CGT, voulant tenter de prouver que la France en a assez des mouvements sociaux. Déçu du résultat, le sondage renouvelé est toujours défavorable à leur propagande et suscite de très nombreuses réactions. La mienne allume le feu ! La voici :
« SUGGESTION POUR UN PROCHAIN SONDAGE : La servilité honteuse et propagandiste de certains médias sous emprise du Capital manipulateur et destructeur, ruine-t-elle la crédibilité de toute la presse ? »
Il convient de savoir qu’il y a deux journalistes, que je pense honnêtes, dans ma famille proche !
Ensuite, j’ai tenté de donner quelques explications à des détracteurs incisifs en passant par les félicitations d’une dernière réaction sous signature « Cyril Cyril » avec ce texte un peu amendé et la volonté de le rendre encore plus explicite :
« Merci, mais je n’attends pas d’éloge ou quoi que ce soit. J’étais contrôleur du travail pendant plus de 40 ans. J’ai contrôlé les entreprises et durant 20 ans les demandeurs d’emplois. Au départ j’étais assez neutre, pensant que tout le monde devait agir pour le mieux (j’étais, allons disons-le, naïf !). Je me suis syndiqué vers l’âge de 30 ans pendant 3 ou 4 ans à la CFDT qui offrit, sans exception, à mes collègues qui y sont restés un tremplin promotionnel impressionnant (certains avaient du mérite). Puis, petit à petit, j’ai observé, l’humiliation, la souffrance, l’exploitation des gens, qui d’ailleurs acceptent assez souvent leur destin sans trop vouloir en causer, parfois en éprouvant une certaine honte. La vie concrète m’a enseigné autre chose que la bienveillance que je voulais trouver partout. La lucidité n’est pas confortable, elle entraîne une vraie souffrance et une profonde remise en question. Certes, j’ai rencontré des patrons honnêtes ou sympathiques, en cohésion avec leurs salariés, mais aussi et surtout beaucoup de tricheurs, d’exploiteurs et de saligauds. Le monde est ainsi, vorace et sans morale. Je ne crois pas que le profit mérite que nous renoncions à ce qu’il y a de plus fondamental en nous-même : l’intégrité. J’ai essayé de protéger et d’aider les plus faibles, les moins armés, il me semble que c’est notre devoir à tous. Je n’étais pas syndiqué et peu enclin à le redevenir. J’observais lors des commissions de recours gracieux, où étaient contestées certaines de mes décisions d’exclusions temporaires ou définitives du revenu de remplacement, peu nombreuses et tempérées de l’avis général (ce à quoi je m’efforçais), le désir, non pas d’équité, mais de faire tomber une décision fondée, par volonté de sauver les fautifs d’une sanction méritée sous l’étendard de tel ou tel syndicat qui avait été saisi et se faisait un devoir de leur obtenir gain de cause ! Finalement j’avais résolu de régler directement les contestations (avec un suivi du plaignant) évitant ce que j’appelle une mascarade de justice, aussi finalement il n’y avait plus de commission. J’aime le syndicalisme franc et honnête, celui qui est épris de justice, d’équité, exempt de favoritisme, c’est ainsi qu’à la veille de ma prise de retraite, en 2009, j’ai suivi à la CGT un jeune inspecteur du travail qui incarnait cet idéal. »
J’admire beaucoup les ouvriers, les grands indispensables, ceux grâce à qui nous pouvons vivre. Les milliardaires sont des exploiteurs, le film de François Ruffin, Merci, Patron le prouve de manière fort amusante et probante. C’est pour les productifs, les vaillants, les habiles, les ouvriers de manière générale, que je reprends le qualificatif de M. Macron : ‟Premiers de Cordée”. La CGT est faite de gens imparfaits comme toute organisation humaine, mais elle défend les plus fragiles et même ceux qui n’osent pas se défendre.
Je comprends bien la volonté de faire cesser la révolte sociale, elle n’est pas le fait de Philippe Martinez (vouloir en faire une bête noire, un bolchevique réfractaire, est ridicule), mais d’une foule de gens qui n’en peuvent plus et exigent que l’on renonce à les priver toujours plus de leurs modestes droits. C’est la base qui décide des mobilisations à la CGT. Philippe Martinez ne part pas seul dans les rues pour promouvoir des revendications concoctées par une élite syndicale coupée de la base et pour y semer la pagaille. Il n’aurait aucun succès et serait ridicule. Ainsi, vous ne pouvez pas désigner un homme comme responsable, bouc émissaire alors que se manifeste une volonté de grande amplitude du peuple opprimé, malgré toutes les conséquences dommageables des mouvements sociaux. Philippe Martinez soutient le mouvement social issu de la base qui reflète une très grande colère, une vraie souffrance. De plus la CGT bien que tellement plus impressionnante par les foules qu’elle mobilise, n’est pas le seul syndicat à contester, avec leurs adhérents, les incessantes régressions sociales ; les autres sont présents lors des cortèges et participent activement.
C’est leur rôle, les luttes sociales sont justifiées et nécessaires.
 |
| Avec mon copain de toujours Bertrand Kervazo, photo PYB |
Lors de ces colossales et répétitives manifestations, il y a des rencontres qui font réellement plaisir comme celle avec Bertrand Kervazo, mon copain de l’école Saint-Georges, sous la férule de monsieur Rouchou. Nous avions 9/10 ans et la sympathie est passée tout de suite. Ses parents étaient charmants, et Caroline, sa mère, une belle femme au grand cœur qui m’a fait découvrir en les interprétant quelques airs de La Belle Hélène ou de La Périchole, car elle fut cantatrice, avant son mariage. J’avais le virus des recherches archéologiques et chez Bertrand on écoutait de la musique classique en permanence, en particulier Beethoven. Un immense réseau ferroviaire occupait une pièce de leur appartement. Bertrand est devenu docteur en archéologie géologie et moi j’ai pris la musique comme violon d’Ingres ! La passion des trains m’est restée. Lors de chaque marche au stade de Saint-Astier ou sur la voie verte à Neuvic ou Marsac, pas une seule fois je ne manque de m’immobiliser pour regarder passer les TER ou les trains de marchandises, plus rares de nos jours, contresens écologique honteux.
Le plus que sympathique photographe, Pierre-Yves Besse, est aussi un copain de nos vertes années. Plus jeune de quelques années, nous nous rencontrions chez Neyrat-Montaigne autour de Sylvette et Élisabeth et encore chez elles, fin des années 60, début 70. Pierre-Yves et son grand pote Éric Planque étaient subjugués par un espagnol plus âgé, Miguel. ♦
_______________________________
[1] Clément Couzy, Secrétaire de la Section de Saint-Astier du PCF, Vœux à la mairie de Saint-Léon-sur-l’Isle, le 18 janvier 2020.
[2] Mathieu Le Roch me rappelait qu’en 1995, lors des manifestations s’opposant à la réforme des retraites du « Plan Juppé », (auquel le gouvernement avait fini par renoncer), nous n’étions, pas 2000, ni 3000, ni 7500 dans les rues de Périgueux, mais 10000. C’est l’importance des mouvements, d’autant que la CGT peut à elle seule, en mobilisant ses adhérents, saturer nos rues, qui exige une boucle conséquente pour permettre à tous de manifester ! Pierre Bourdieu, évoque cet épisode dans Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-libérale, Paris, 1998, Éditions Raisons d’agir et Serge Halimi dans « Les médias et les grèves de 1995 en France » dans son ouvrage Les Nouveaux Chiens de garde, Paris, Éditions Raisons d’agir, 1997, p. 66-74.
[3] Léon-Paul Fargue, Pauvres esclaves, Ludions no 18, 2019, bulletin de la Société des Lecteurs de Léon-Paul Fargue, p. 7.
[4] Pierre Bourdieu, « Contre la destruction d’une civilisation », intervention reprise dans Contre-feux. Propos pour servir à la résistance contre l’invasion néo-libérale, Paris, Éditions Raisons d’Agir, 1998, p. 31.
Le temps qu’il reste…
12 Janvier 2020
Que puis-je faire du temps que j’ai encore à vivre ?
Matthieu Ricard
Il est toujours troublant de tourner les pages du livre de nos vies. La cérémonie pour accompagner Meg (de son nom de jeune fille : Megan Reynolds à celui d’épouse : Jones) aura laissé orphelins beaucoup de ceux qui constituaient le petit groupe d’amis réunis hier, au Vigan (Lot, près de Gourdon). Meg domine la colline d’en face, tout en lui tournant le dos. Le point de vue, à la sortie du village, est réellement ravissant, comme le faisait remarquer Claire Honegger. Il est pour celle ou celui qui viendra s’incliner sur la tombe de cette petite anglaise qui a tant aimé la France qu’elle a fait le choix d’y demeurer. Nous l’avions totalement adoptée et nous avions tous une très grande tendresse pour cette merveilleuse amie qui avait l’allure juvénile d’une jeune fille, à plus de 90 ans.
« Quand les ermites répètent le mantra magique : « Je n’ai besoin de rien », ils cherchent à se défaire des distractions infinies qui s’emparent de l’esprit et leur laissent le goût amer du temps perdu. Ils veulent désencombrer leur vie pour se consacrer pleinement à ce qui est véritablement enrichissant. Comme nous l’a dit un des maîtres de Mingyour Rinpotché, Nyoshül Khen Rinpotché (1932-1999) : ‟L’esprit est très puissant. Il peut créer le bonheur ou la souffrance, le paradis ou l’enfer. Si, avec l’aide du dharma, nous réussissons à éliminer nos poisons intérieurs, rien d’extérieur ne viendra jamais affecter notre bonheur ; mais, tant que ces poisons demeureront dans votre esprit, vous ne trouverez le bonheur que vous cherchez nulle part dans le monde” »[1]
Ce lieu élevé et ensoleillé me fait souvenir de madame Perpignani qui nous contait joyeusement, il y a des années, son escapade du week-end chez ses neveux à Saint-Jean de Côle où elle repose désormais, après avoir tiré sa révérence, à 101 ans ! C’était dans cette résidence très classe de la rue Wilson, à Périgueux, qui avait pour nom Edilys et qui depuis porte le nom de Villa Occitane. On ne pouvait être plus charmante, enthousiaste, positive, que madame Perpignani, qui allait encore à 100 ans faire de petites ballades, seule, rue Wilson. Devant Émilie Dalençon et moi, ébahis et quelque peu refroidis, elle déclarait : « J’ai vu, avec mes neveux, le caveau où je reposerai ; il est bien situé, en plein soleil ; que j’y serai bien ! » Dans l’esprit du lâcher prise pourquoi ne pas s’avancer jusqu’à notre ultime demeure d’un pas guilleret, mais en évitant tout de même d’y courir au galop !
|
|
| Meg Jones |
Dans le joli petit village du Vigan, il faisait froid dans l’église comme au cimetière. Après une cérémonie protestante où Claire jouait de l’harmonium et où l’on chantait pour accompagner notre amie, la marche jusqu’au cimetière en suivant le corbillard rappelait les convois de jadis, dans nos campagnes. Nous pûmes nous réchauffer dans le petit appartement de Meg où des tableaux et des photos ne manquèrent pas d’évoquer d’heureux temps. Nous étions accueillis avec beaucoup de gentillesse par une nièce de Meg, Sally Hope Johnson et son frère John Reynolds.
 |
| Au revoir Meg, Le Vigan |
Une part de nous repose au Vigan, sur la colline. Il nous faut toute la sagesse de Meg pour nous croire encore vivants après la mutilation que nous impose son départ. Le temps des jeux de jardinage, des rencontres, des amitiés croisées s’achève. Nous qui restons sommes aussi sur la ligne de départ. Les belles années sont achevées, seule une vision détachée de la vie nous permet un recul bénéfique sur notre destinée et sur le temps qu’il reste.
Comment ne pas ressentir de la gratitude pour celles qui ont veillé sur les ultimes heures de Meg. Je pense bien entendu à notre chère amie Claire Honegger, dont la tendresse pour Meg était si grande ; elle a organisé avec les neveux et la nièce de Meg, la cérémonie d’adieu. Puck, grande ami du couple Jones et au-delà de Meg, qui malgré ses épreuves, était auprès d’elle dans ses dernières heures. Tanja qui veillait sur le confort de notre amie chaque jour était auprès d’elle et relayait Puck et Claire, pour ne pas laisser Meg partir seule.
 |
| Puck & Meg, Gourdon © Puck Portheine |
Sue Hamilton qui habite la Corrèze, était une amie de Meg. Elle m’a touché en me révélant que Meg, lorsque Clive a disparu, lui avait confié n’avoir conservé qu’un de ses amis jardiniers, en l’occurrence moi, et qu’elle lui parlait de ce temps si heureux que nous eûmes tous ensemble.
Je reste persuadé que cela aura été le temps le plus exaltant de mon passage sur terre. Quel merveilleux couple. Il était impossible de ne pas éprouver une grande tendresse pour eux. Ils apportaient une bonne humeur et une grâce indéfectibles lors de chacune de nos rencontres.
| L’heureux temps du jardin avec Meg & Clive JONES |
Ce matin, sous un grand soleil, l’herbe était blanche sous l’emprise du gel. Il faut l’énergie débordante du Strauss du nord, Hans Christian Lumbye pour garder le cap et éviter de sombrer dans une humeur morose ! Une musique véloce, vive, preste, et même précipitée, où la trompette, instrument du compositeur danois, se manifeste souvent. Ce Lumbye que je découvrais lors du dernier concert du nouvel An, est un maître inconnu de la musique légère de type viennois et des fanfares militaires. Lors du Concert du Nouvel An 2020, le chef danois dont on parle de plus en plus, Andris Nelson, à la tête de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, usa de sa trompette, pour lancer le Galop du chemin de fer de Copenhague. Une petite merveille d’énergie évocatrice !
 |
 |
|
Je ferai ma traditionnelle marche en plein soleil… soleil ayant renoncé dans l’après-midi.
Mais déjà ce soir, l’artiste José Correa, me communiquait une autre sombre nouvelle. Notre amie commune, Madeleine Marcoux vient d’être victime d’un AVC. Âgée de plus de 95 ans, on peut craindre qu’elle ne s’accroche pas à la vie, convaincue du principe de la réincarnation et refusant tout acharnement thérapeutique. Mardi, après notre nouvelle manifestation, j’irai lui rendre visite à l’hôpital. Madeleine fut un peu comme une seconde mère pour moi et je lui dois beaucoup. C’est une personnalité hors du commun, artiste peintre, elle avait épousé, en premier mariage, le neveu de Marcel Proust avec lequel elle eut une fille disparue tragiquement. Elle épousa ensuite un des plus importants industriels du nord du département. Son beau-père l’appelait la ‘Pasionaria’[2] tant elle prenait à cœur les difficultés du personnel, intervenant pour venir à leur secours. Lors de nos conversations téléphoniques surgit toujours son indignation et sa révolte contre l’ignominie politicienne, la folie du monde. ♦
________________________________
[1] Rinpotché, Yongey Mingyour. De la confusion à la clarté (Documents), Préface de Matthieu Ricard (French Edition) (p. 11). Fayard. Édition du Kindle
[2] La ‘Pasionaria’, Dolores Ibárruri Gómez (1895-1989), est une femme politique basque espagnole. Connue pour son fameux slogan ¡No Pasarán! (Ils ne passeront pas) ou « Il vaux mieux mourir debout que vivre à genoux », slogans qu’elle a repris et popularisés, elle-même ayant été chantée par les plus grands comme Federico Garcia Lorca ou Raphael Alberti. Elle a été secrétaire générale du Parti communiste espagnol (PCE) entre 1942 et 1960, présidente de ce parti entre 1960 et 1989.
Pot-pourri hivernal
Samedi 4 janvier 2020
Trajet ouaté, brumeux, mouillé, pour se rendre sur le marché de Neuvic, déserté de plusieurs stands. Les gastros post ripailles – fêtes de fin d’année obligent –, nous plongeraient-elles dans la diète, le jeune, l’abstinence ? Sauf qu’hier, d’observer et de subir la foule aux caisses du Leclerc de Saint-Astier, entre 11 h 30 et midi, dément tout projet de renoncement à la voracité du consommateur !
Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947), se fit complice d’Igor Stravinsky (1882-1971) pour L’Histoire du soldat (1918) inspiré du mythe de Faust. On y entend cette déclaration hautement philosophique, qu’un auditeur de l’émission France Musique est à vous, rappelait ce matin : « Il ne faut pas vouloir ajouter à ce qu’on a ce qu’on avait, on ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était. On n’a pas le droit de tout avoir : c’est défendu. Un bonheur est tout le bonheur ; deux, c’est comme s’ils n’existaient plus. » Nous n’avons pas, grâce à notre horde politicienne malfaisante, à nous inquiéter d’une trop grande abondance de bonheurs. Si le règne de Vénus, comme le chante Pâris dans La Belle Hélène, est un règne joyeux, celui de Macron est particulièrement grognon et maussade. Le damoiseau n’aime que les très riches, ce qui exclut beaucoup de monde !
Benoit Duteurtre est venu égayer la fin de matinée avec un petit hommage à Suzy Delair qui vient de fêter ses 102 ans, puis en recevant les chansonniers Jacques Mailhot et Florence Brunold qui officient au Théâtre des Deux Ânes dans une revue intitulée On est mal Macron, on est mal ! Nous eûmes droit à un extrait de la prestation de Florence Brunold qui, à travers un épisode horticole, brocarde jardiniers et rosiers, dont le rosier grimpant DSK qui malheureusement est sensible à la gale du poireau !
Dimanche 5 janvier 2020
Un ciel limpide pour la marche de ce dimanche matin, un peu frisquet. J’ai vite quitté la voie verte car des innombrables branches des tilleuls dénudés, ne cessaient de tomber sur la chaussée, des gouttes d’eau glacées, c’était le pic du dégel ! J’ai laissé Alonzo, arrivé avec beaucoup de retard, vaquer sur son immuable parcours.
Après la traversée de la passerelle jusqu’aux stades dont je fais le tour complet, j’ai regagné le pont de Saint-Astier et le parking de la route de Montanceix où j’étais seul, étant descendu par la route de Brujacelle, de Fayolle, Côte folle, Jevah haut et son panorama somptueux sur Saint-Astier dans la lumière cristalline du matin, puis Jevah bas.
Journée relativement immobile : on pouvait se laisser aller à une longue sieste sans que quiconque n’y fasse obstacle ! Classement et rangement occupent une part conséquente de mon temps. Presque une heure de papotage avec Marie-Annick et je reviens vers ce texte hétéroclite où le présent en sa banalité s’invite sans pouvoir rivaliser avec les Carnets de notes de Pierre Bergounioux qui magnifient la sobriété du quotidien, exception faite de très insolites lectures.
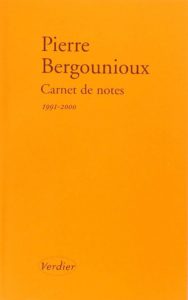 |
Ainsi, écrit-il, à la date du 5 janvier 1992 : « À trois heures de l’après-midi, j’ai fini de dactylographier le gros manuscrit[1]. Je lis L’Enterrement de François[2], que je trouve impressionnant, comme tout ce qu’il écrit[3]. »
Le 5 janvier 1993, description de l’implacable quotidien : « Je reprends (il est enseignant), dans des conditions inhabituelles. Le peu de pluie qui est tombé, hier, sur le sol gelé forme une pellicule de verglas. Pas question de partir en voiture. Rien que de descendre, à pied, jusqu’au portail, est une expédition périlleuse. Je n’y parviens, sans dommages qu’en marchant, avec précautions, le long de la bordure de brique, sur la terre, les feuilles mortes, les brindilles. Mes mésaventures ne sont pas finies. Je me suis engouffré, sans y voir malice, dans la première rame qui s’est présentée, laquelle après Orsay, brûle les étapes et me conduit, bien malgré moi, à Massy-Palaiseau. Je n’ai plus qu’à repartir en sens inverse, jusqu’au guichet. Il m’a fallu une heure pour rallier le collège. Ces voyages, dans les transports en commun, sont une source d’enseignements, d’étonnements, aussi. C’est en pareilles circonstances que le monde, celui de mes semblables, surtout, existe effectivement, se substitue à la représentation vague, anachronique que j’en ai encore, dans mon bureau[4]. […] »
Et le 5 janvier 1994 : « … Je descends chercher Paul (un de ses fils) à midi, sous la pluie qui ne cessera de la journée. J’avance dans Lévy-Bruhl[5] – Les Fonctions mentales dans les sociétés primitives. La fatigue récoltée hier, au collège, me pèse, complique inutilement la lecture[6] […] ».
Reconnaissons à ce 5 janvier 2020, plus d’onctuosité, de douceur, de luminosité, qu’à ceux des années 90, mais ce qui ne saurait refléter une grâce du réchauffement climatique qui présente, la plupart du temps, des visages nettement moins charmeurs ! ♦
___________________________
[1] Sans doute Le Matin des origines, publié chez Verdier, en 1992.
[2] François Bon, né le 22 mai 1953 à Luçon est un écrivain, éditeur et traducteur français. L’Enterrement (récit, publié en 1991, chez Verdier).
[3] Pierre Bergounioux, Carnet de notes (1991-2000), Lagrasse, Verdier, 2007, p. 127.
[4] Ibid., p. 251-252
[5] Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) est un philosophe, sociologue, anthropologue français dont les travaux, au début du xxe siècle, ont principalement porté sur l’étude des peuples sans écriture. Il fut l’un des collaborateurs d’Émile Durkheim. Les travaux de Lucien Lévy-Bruhl s’orientèrent d’abord vers l’histoire de la philosophie, puis après un ouvrage sociologique, il publia une série d’ouvrages ethnologiques.
[6] Pierre Bergounioux, Carnet de notes (1991-2000), Lagrasse, Verdier, 2007, p. 375-375.




