Chroniques de l’année 2020 – septembre à décembre –
| Dimanche 27 décembre 2020 |
|
Les admirateurs d’Offenbach sont comblés d’observer que Fantasio, cette partition majeure et pourtant bien mal accueillie en janvier 1872 à l’Opéra-Comique [une version, avec le rôle principal repensé pour soprano, ne connût qu’un succès d’estime à Vienne], soit enfin reçue et saluée avec autant d’enthousiasme en ce mois de février 2017. Le Théâtre national de l’Opéra-Comique, provisoirement déplacé – en raison de travaux – au Théâtre du Châtelet, est l’instigateur inspiré de cette reprise. Cent-quarante-cinq années se sont écoulées pour vivre cet incroyable revirement, dont avait eu cependant la vision prémonitoire le critique A. W. Ambros qui assistait à la création de l’œuvre à Vienne :
| « Fantasio est un tournant. Jamais Offenbach n’a composé un ouvrage avec autant de soin et d’amour. Il a voulu nous prouver sa capacité à composer un opéra-comique de haute tenue. »[2] |
|
|
Honte à Camille Du Locle, directeur de l’Opéra-Comique en cette année 1872, à qui Jacques Offenbach, cruellement meurtri, écrivait en mars 1872 :
| « […] ce qui s’est passé pour ce pauvre Fantasio est je crois sans précédent dans les annales du théâtre. Ce qu’un directeur ordinaire n’eût osé faire, un directeur extraordinaire, doublé d’un ami, l’a mis à exécution… et de quelle façon. […] Et d’un coup de baguette, vous enlevez ma pièce, tout çà pour pouvoir jouer tranquillement le lendemain Fra Diavolo. Ah, que de vilaines excuses et que je vous plains mon pauvre garçon ! Avez-vous fait au moins quelque chose pour soutenir Fantasio ? […] Vous ne vouliez rien essayer, rien faire pour le faire marcher et vous vouliez à toute force vous en débarrasser et vous l’avez fait avec un sans-gêne qui vous fait le plus grand honneur au point de vue de l’indépendance d’affaires et de cœur. Comme directeur vous n’avez montré aucune énergie, comme ami vous avez agi sans loyauté et sans délicatesse. J’espère que d’autres seront plus heureux auprès de vous – ce qui ne sera pas difficile. Je ne me dis pas moins votre serviteur le plus dévoué. »[3] |
Un peu plus tôt, depuis Vienne, le 10 février 1872, Offenbach adressait une lettre particulièrement sombre, teinté même de désespoir, au même Camille Du Locle :
| « Ici, je travaille comme un “aigre”, je le suis d’ailleurs, aigre, grâce à tout ce que je fais. Boule de neige a eu un vrai succès – Fantasio, mon cher Fantasio, passe cette semaine. Moi, je ne tarderai guère à passer également. Le plaisir de la vie, c’est la lutte et quand on a bien lutté, c’est la mort. »[4] |
Jean-Claude Yon fait cette analyse de l’épreuve vécue par Offenbach devant cet échec :
| « Dans le personnage de Fantasio, il a mis beaucoup de lui-même. L’attrait du jeune étudiant pour la défroque du bouffon et sa fascination pour le rire grinçant et la difformité… ont trouvé un écho au plus profond de lui. […] À bien des moments, Fantasio apparaît comme une préfiguration des Contes d’Hoffmann dont il annonce le désespoir foncier… la partition, écrite avec un soin tout particulier, est d’une exceptionnelle qualité et mêle avec bonheur le grotesque et la poésie. »[5] |
Jacques Offenbach était un romantique qui a dû vivre et faire vivre ses interprètes. Rarement un compositeur fut originaire d’un milieu aussi humble. Venu à Paris avec son frère Jules, c’est avec de très modestes moyens qu’il commença à exercer ses talents. Mais son génie le consacra de manière fulgurante dans la veine de l’opéra bouffe où ses succès et triomphes furent aussi retentissants que réitérés. Songeons au permanent feu d’artifice qui enchanta Paris et toute l’Europe entre 1858 et 1869 : Orphée aux enfers (1858), Geneviève de Brabant (1959), La Chanson de Fortunio (1861), Le Pont des soupirs (1861), Monsieur Choufleuri restera chez lui le… (1861), Les Bavards (1863), La Belle Hélène[6] (1864), Barbe-Bleue (1866), La Vie Parisienne (1866), La Grande-Duchesse de Gérolstein (1867), L’Île de Tulipatan (1868), La Périchole (1868), La Princesse de Trébizonde (1869), Les Brigands (1869).
Tous les théâtres de la capitale, de Vienne et d’Europe étaient acquis aux recettes mirifiques qu’une œuvre d’Offenbach mise à l’affiche garantissait, presque à coup sûr. Au faîte de la gloire, lors de l’Exposition Universelle de 1867, alors que triomphait La Grande-Duchesse de Gérolstein aux Variétés, les autres théâtres parisiens proposaient un opéra bouffe du maître au public !
Un tel succès engendre fatalement de vives indispositions, d’amères critiques, elles furent nombreuses et parfois si virulentes qu’elles n’honorent certainement pas leurs auteurs aussi célèbres soient-ils. Les frères Goncourt s’adonnèrent à leur inéluctable jactance au vitriol, aspergeant ignominieusement les personnages : Hector Crémieux « qui monte et monte, gagne de l’argent avec les pièces qu’il ne fait pas », Ludovic Halévy « pitre juif, bobèche qui maquignonne des couplets de facture », Villemessant et Offenbach « tripotant, vendant un peu de tout, vendant un peu leurs femmes, les mêlant aux acteurs et aux actrices… », Morny « le mécène d’Offenbach, le musicien amateur, homme type de l’Empire, frotté et pourri de toutes les corruptions parisiennes… ». Offenbach doit sans cesse, malgré et sans doute même à cause de ses innombrables succès, prouver, démontrer qu’il est un authentique musicien. Émile Zola lui sera toujours hostile : « J’aboie dès que j’entends la musique aigrelette de M. Offenbach. Je hais les cascades de toutes mes haines littéraires. Jamais la farce bête ne s’est étalée avec une pareille impudence. »[7]. 1878 : nouvelle Exposition Universelle à Paris, et un des rares moments que l’on pouvait interpréter comme de désaffection du public pour le maestro. Zola ne retient plus ses foudres :
| « Songez donc ! M. Offenbach a été roi. Il n’y a pas dix ans, il régnait sur les théâtres ; les directeurs à genoux lui offraient des primes sur des plats d’argent ; la chronique chaque matin lui tressait des couronnes. On ne pouvait ouvrir un journal sans tomber sur des indiscrétions relatives aux œuvres qu’il préparait, à ce qu’il avait mangé à son déjeuner et à ce qu’il mangerait le soir à son dîner. […] Il y a dix ans ! et, bon Dieu ! comme les temps sont changés ! Il faut se souvenir que ce fut lui qui conduisit le cancan de l’Exposition Universelle de 1867. Dans tous les théâtres, on jouait de sa musique. Les princes et les rois venaient en partie fine à son bastringue. […] et voilà qu’aujourd’hui le dieu est par terre. Nous avons encore une Exposition Universelle ; mais d’autres amuseurs ont pris le pavé. Toute une poussée nouvelle de maîtres aimables se sont emparés des théâtres, si bien que l’ancêtre, le dieu de la sauterie, a dû rester dans sa niche, solitaire, rêvant amèrement à l’ingratitude humaine. À la Renaissance, Le Petit Duc ; aux Folies-Dramatiques, Les Cloches de Corneville ; aux Variétés, Niniche ; aux Bouffes, clôture ; et c’est certainement cette clôture qui a été le coup le plus rude pour M. Offenbach. Les Bouffes fermant pendant une Exposition Universelle, les Bouffes qui ont été le berceau de M. Offenbach ! N’est-ce pas l’aveu brutal que son répertoire, si considérable, n’attire plus le public et ne fait plus d’argent ? »[8] |
Et si le théâtre de La Gaîté reprend Orphée aux enfers, dans sa version en 4 actes de 1874, c’est uniquement par charité pour le malheureux maestro, affirme Zola qui prophétise que l’heure du jugement est arrivé pour Jacques Offenbach : « et c’est une terrible chose pour un artiste que cette justice lorsqu’il est encore vivant et qu’il assiste à sa déchéance. […] On se voit enterré avant d’être mort. Je ne connais pas de vieillesse plus abominable. » Peut-on être plus venimeux et plus injuste ? L’avenir mettra en pièce ces vociférations.
Voilà, n’est-ce pas, qui permet de comprendre l’animosité féroce dont Offenbach fut victime pour ses œuvres bouffes. Il n’est alors pas bien difficile d’imaginer l’âpre combat de toute une vie face aux cabales et obstructions permanentes rencontrées par le compositeur pour accéder ou se maintenir sur les scènes officielles de l’Opéra-Comique et de l’Opéra. Il y parvint somptueusement en février 1881, mais sa mort en fut le prix.
| « Nombreuses sont les légendes véhiculées autour de Jacques Offenbach. Une des plus tenaces tend à le présenter exclusivement comme un compositeur de musique légère ayant commis à la fin de ses jours un seul et unique ouvrage sérieux, Les Contes d’Hoffmann. Il n’en est rien. Tout au long de sa carrière, le père de La Belle Hélène proposera à son public des ouvrages beaucoup plus sérieux qu’Orphée aux enfers ou La Vie parisienne. Barkouf (1860), Les Bergers (1865), Robinson Crusoé (1867), Vert-Vert (1869) et surtout Fantasio (1872), ne recevront malheureusement pas le succès qu’ils méritent. »[9] |
* * *
Le 26 novembre 1860, l’Opéra affiche Le Papillon, un des meilleurs ballets romantiques, chorégraphié par Marie Taglioni, devant un auditoire de choix, l’Empereur assiste à l’évènement. Le public réserve un indéniable succès au spectacle que confirment plus de quarante représentations. Le 29 novembre 1860, Stéphen de la Madelaine, critique de L’Univers musical, résume l’interrogation que soulève l’accession du compositeur à l’Opéra :
| « Il y a bien des choses à dire pour ou contre la musique dont M. Offenbach avait eu l’incroyable fortune d’obtenir la commande. En passant, d’un seul bon, de son théâtre en miniature sur notre scène nationale, on peut dire que le compositeur avait réalisé le plus surprenant truc du ballet dont il s’agit. Hâtons-nous de dire que, si le directeur des bouffes-Parisiens n’a point justifié toutes les espérances de ses prôneurs d’office, il n’a point non plus confirmé les mauvais bruits qu’on faisait courir sur les excentricités de sa partition. […] En somme, la musique ne nuira pas au charmant ballet de M. de Saint-Georges, bien au contraire. Elle a du fouet et de l’entrain ; – c’est moins qu’il ne fallait pour un compositeur qui change d’allure : c’est ce qu’il faut pour un ballet. »[10] |
Pour Paul Scudo, ce n’est pas seulement une interrogation, mais une volonté de déloger l’intrus et de la plus obscène façon. Scudo répand de manière nauséabonde sa haine du compositeur et révèle ainsi ce qui se dissimule derrière les moues de dédain de certains critiques moins hardis :
| « … idole de la belle jeunesse et des petits journaux… il a été planté, il a été arrosé et on l’a vu naître sous les yeux de l’autorité, ce beau rosier qui a donné à la France Orphée aux enfers. […] M. Jacques Offenbach est né à Cologne de la race sémitique (comme dirait M. Renan), dont il porte l’empreinte fatale. Ni la muse de la grâce ni celle de la beauté et du sentiment n’ont voulu veiller autour de son berceau.[…] M. Offenbach est une figure légendaire, qui n’est pas sans analogie avec ce Méphistophélès des marionnettes dont parle Goethe dans ses Mémoires : on le vit surgir et se produire dans Paris, vers 1848, au milieu des éclairs et au bruit de la foudre des révolutions, les cheveux longs et en désordre, le regard douteux, le sourire satanique, tenant à la main un violoncelle, dont il jouait comme d’un mirliton. […] Nous avons été surpris de la platitude et du néant de cette muse de fantoccini[11] venant gambader sur le premier théâtre lyrique de l’Europe.[…] On peut dire littéralement, si ce n’est noblement, qu’en abordant l’Opéra, M. Offenbach a perdu son sifflet, et qu’il ne lui reste plus que les yeux pour pleurer sa profonde et légitime disgrâce. »[12] |
Offenbach cultive peu d’espoir de se voir mieux traité à l’Opéra-Comique pour la création de Barkouf, opéra comique en 3 actes, représenté le 24 décembre 1860, après plus de quatre mois de préparation. Aux difficultés avec la censure s’ajoutèrent des défections sur plusieurs rôles, y compris au-delà de la première. La huitième représentation en janvier est même annulée. L’œuvre bien accueillie par le public est victime d’une campagne de presse d’une rare violence. Le livret de Scribe – auteur habituel des livrets d’Auber – est très critiqué pour « ses inepties » et pour le fait d’avoir dévolu le rôle titre à un chien. Tout y passe : « chiennerie musicale », musique faite « d’excentriques harmonies », « wagnérienne » et l’inimitable Scudo qui blâme « les rythmes grimaçants », alors qu’un autre d’un avis tout différent dénonce « le parti pris de démolir, de conspuer ». Jean-Claude Yon de conclure :
| « Il s’agit donc bien d’un combat dont l’enjeu n’est rien de moins que la place d’Offenbach dans la vie musicale parisienne. Toutes les jalousies provoquées par la création et le succès des Bouffes-Parisiens se donnent enfin libre cours. »[13] |
La création au Hofoperntheater de Vienne, le 4 février 1864, de l’opéra romantique en 4 actes, Die Rheinnixen, arrive après des répétitions émaillées de toute une succession de défections. Pour autant, le public lui réserve un vrai succès. Offenbach souffrant ne dirige pas l’orchestre lors de la première, mais se voit gratifié d’une véritable ovation après de nombreux rappels. Dix représentations confirment le succès d’estime réservé à l’œuvre.
| « C’est la critique, et plus particulièrement la presse wagnérienne, qui va essayer de nuire à ce succès. Il faut dire que Richard Wagner, ennemi déclaré du maestro, accepte difficilement que Salvi, le directeur du Hofoper, offre à Offenbach la possibilité de faire jouer Les Fées du Rhin, et ce, en remplacement de son Tristan originellement prévu… »[14] |
Offenbach de retour en France, saisi par une frénésie de commandes suite au succès de La Belle Hélène, ne prendra pas le temps de faire représenter son opéra à Paris. Il faudra attendre cent trente-huit années pour que réapparaissent ces Fées du Rhin. Sur Forum Opéra, Christian Peter, évoque la création de la version française réalisée avec grand soin par Jean-Christophe Keck :
| « …Comme ont pu le constater les spectateurs du concert triomphal donné à Montpellier le 30 juillet 2002, il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre ! Près de trois heures et demie d’une musique absolument somptueuse, d’une formidable puissance dramatique, qui ne génère aucun moment d’ennui et témoigne de l’immense talent d’orchestrateur d’Offenbach autant que de la variété de son inspiration. La surprise est d’autant plus inattendue que, pendant plus d’un siècle, on a considéré cet ouvrage comme une tentative ratée de grand opéra, dont le compositeur s’était résigné à réutiliser les meilleures pages dans ses Contes d’Hoffmann…»[15] |
Lorsque vient l’heure de revenir Salle Favart, l’enjeu est grand pour Offenbach. L’affront de son échec de 1860 avec Barkouf doit être relevé. Après l’immense succès de sa Grande-Duchesse, il est à l’apogée de sa gloire.
| « Il a remporté les plus grands succès auxquels il pouvait rêver ; il lui faut à présent séduire le public dans un registre plus sérieux. Robinson Crusoé doit montrer tout ce qui le sépare des autres compositeurs qui se font jouer sur les théâtres de genre… »[16] |
Le compositeur consacre donc toutes ses forces aux répétitions (interrompues cependant par des crises de goutte) de son nouvel opéra-comique en 3 actes. À la première de Robinson Crusoé, le 23 novembre 1867, le spectacle dure plus de 4 heures. Les traditionnelles coupures vont intervenir rapidement. Savigny dans l’Illustration commente l’œuvre :
| « Vous le voyez, la pièce est décousue, diffuse ; elle se complique de situations les plus inattendues, elle ne se décide ni pour la bouffonnerie, ni pour la gaieté, ni pour le drame. De tout un peu, voilà son défaut. »[17] |
La majorité des critiques reprochent à la partition « des longueurs excessives », trop de soin et d’effort, d’avoir trop voulu prouver une capacité à entrer dans le moule attendu. La critique la plus sévère émane d’Albert Vizentini, pour autant futur collaborateur du compositeur :
|
« Si Robinson Crusoé avait répondu à l’attente générale, la Salle Favart appartenait en toute propriété à ce grand vainqueur du public cosmopolite. Malheureusement, il fallait entrer dans la place en se contentant de modifier un peu son costume peut-être trop primitif pour un théâtre où la distinction a toujours remplacé la charge. L’auteur du Mariage aux lanternes a voulu prendre la livrée de la maison sans s’apercevoir qu’elle était beaucoup trop large pour lui. Qu’importe que son verre fût petit, il fallait boire dans son verre et non se noyer dans celui des autres. […] Ce ne sont ni le poème, ni le cadre qui ont trahi le compositeur, c’est sa propre faiblesse. Au lieu de forcer son talent, il aurait dû rester le premier dans son village. »[18]
|
Gustave Bertrand, lui, reproche au public de tirer le compositeur vers la facilité :
| « La seconde tentative du maestrino Offenbach à l’Opéra-Comique était chose plus grave et de plus de conséquence pour lui que la première. Au temps de Barkouf, il n’était que le roi des Bouffes-Parisiens ; aujourd’hui, c’est une des influences, une des dominations universelles de la musique. […] Ce monde élégant, aristocratique, qui a patronné M. Offenbach et, entraîné par son exemple éclatant, l’immense foule moutonnière, ce monde était surtout pour le gros sel en musique. Ce sont ces patrons-là qui ont poussé le maestro dans le sens de Trom-Al-Ca-Zar plutôt que dans celui de Fortunio ; ce sont eux qui ont tué, par exemple, sa charmante partition des Bergers[19], la meilleure peut-être qu’il ait faite, et ils l’ont tuée sous cet arrêt terrible : « ce n’est pas drôle ! » Eh bien ! ces mêmes gens se déclareront-ils satisfaits ? En se compromettant près de ses amis, le compositeur est-il sûr d’en trouver d’autres aussi nombreux et décidés ? »[20] |
Certes, le public de 1867 n’est plus celui de 1860, il est désormais beaucoup plus favorable au compositeur à qui ses triomphes successifs ont assuré, en quelques années, un indéniable prestige, mais il a surtout applaudi les passages enlevés ou bouffes qui ont fait sa renommée. Quoiqu’il en soit, la première fut un évènement parisien. Robinson Crusoé se solde par un succès d’estime avec trente-deux) représentations, alors qu’Offenbach avait espéré une consécration.
1969 : deux années se sont écoulées lorsque le maestro réapparait à la Salle Favart. Le livret de son nouvel opéra-comique, Vert-Vert est inspiré d’un vaudeville assez leste que le talent de Virginie Dejazet avait rendu populaire. Pour autant, la critique se montre sévère avec ce texte considéré comme démodé, ce qui n’empêche pas le compositeur d’écrire une vaste partition. La création le 10 mars 1969 voit le succès du superbe jeune ténor Vincent Capoul dans le rôle de Valentin, son premier grand rôle. Vert-Vert est joué trente-six fois de suite jusqu’au 31 mai, puis sera redonné dix-huit fois durant l’été. Peu importe pour les ennemis consacrés de Jacques Offenbach que le succès soit notable, ils reprennent leurs sempiternelles admonestations, vilipendant le compositeur et l’invitant à ne plus paraître Salle Favart :
| « Le perroquet n’a pas été plus heureux que le chien à la Salle Favart. Vert-Vert, pas plus que Barkouf, ne fera de vieux os. L’auteur d’Orphée, de La Belle Hélène et de La Vie parisienne fera bien de renoncer à un théâtre que son genre bouffe ne lui permet pas d’aborder. Il fera bien de ne plus se hasarder sur cette scène que de vrais maîtres ont illustrée depuis Grétry jusqu’à Auber ; et de s’en tenir aux trois théâtres sur lesquels les ouvrages que nous venons de citer ont eu le seul succès auquel l’ancien directeur des Bouffes-Parisiens puisse viser. […] On ne cultive pas impunément pendant quinze ans la bohème musicale. Le jour qu’on [sic] veut passer du bastringue au salon, on y est gauche, emprunté, mal à l’aise ; on s’y sent intrus. »[21] |
Fantasio, dont la création était programmée en 1870, arrive à l’Opéra-Comique dans une période particulièrement néfaste pour Offenbach, la guerre l’ayant contraint à s’exiler en Espagne puis en Italie, victime d’attaques virulentes dans les journaux, en raison de ses origines allemandes, de ses satires du pouvoir, de l’armée, et d’un antisémitisme certain. Les répétitions de Fantasio, inaugurant la réouverture du Théâtre de l’Opéra-Comique après la guerre, se déroulèrent donc dans un climat de grande hostilité. Bizet fut un des plus implacables en écrivant à son confrère Paul Lacombe :
| « Il faut que tous les producteurs de bonne musique redoublent de zèle pour lutter contre l’envahissement toujours croissant de cet infernal Offenbach !… L’animal, non content de son Roi Carotte à la Gaîté, va nous gratifier d’un Fantasio à l’Opéra-Comique. De plus, il a racheté à Heugel son Barkouf, a fait déposer le long de cette ordure de nouvelles paroles et a revendu le tout 12 000 francs à Heu (Heugel). Les Bouffes-Parisiens auront la primeur de cette malpropreté. »[22]. |
Le climat entourant cette création, est donc, on le voit, pour le moins délétère !
L’immense succès de la création du Roi Carotte, opéra-féérie en 4 actes, au théâtre de La Gaîté, le 15 janvier 1872, n’avait pas inspiré de critique à Gustave Bertrand, mais l’échec de Fantasio lui inspire un papier qui donne le ton dans Le Ménestrel : « Partout de l’Offenbach ! C’est [de] la production dévorante, absorbante, à l’année, au mois, à la petite semaine. Offenbach s’est fait légion et nous envahit… »[23]
Dans son second texte Offenbach, un romantique ? écrit pour notre livret consacré à Jacques Offenbach[24], Lionel Pons souligne les affinités de l’écriture du compositeur avec Weber, Schubert, Wagner, puis dans un chapitre consacré à Offenbach et Alfred de Musset après avoir abordé l’opéra-comique La Chanson de Fortunio, il s’attache à la partition qui nous importe aujourd’hui :
| « Avec Fantasio écrit pour l’Opéra-Comique, Offenbach signe, sept ans avant Les Contes, une partition véritablement selon son cœur. Le compositeur romantique, qui affleurait dans tant de passages, se livre enfin en toute liberté. Il n’y a guère que le finale du deuxième acte pour rappeler ici l’Offenbach champagne de La Belle Hélène ou La Vie parisienne. Le compositeur, dont Napoléon III confessait que sa musique s’écoutait avec les pieds, cède la place à un romantisme frémissant et pudique, à l’image de son personnage principal qui se travestit en bouffon pour mieux séduire l’héroïne. Jamais Offenbach n’est allé plus loin dans l’identification totale à un personnage, jamais son univers propre et celui de Musset ne se sont à ce point interpénétrés. C’est dire que Fantasio voyait le compositeur renoncer à beaucoup de ce qui avait jusque-là fait son succès le plus large : plus de parodie, le comique n’est plus qu’allusif et l’œuvre ne doit son appellation d’opéra-comique qu’à l’absence de mort violente et à la présence de dialogues parlés. Le public ne comprit pas Fantasio, qui reste l’une des œuvres les plus attachantes du maître. Aucune reprise française n’était venue la tirer de l’oubli depuis plus d’un siècle, et il a fallu à la fois la patiente ténacité, le dévouement de Robert Pourvoyeur et le courage de la direction du Théâtre de Rennes pour que Fantasio nous soit enfin rendu, incarné par Martial Defontaine. La surprise du public s’est renouvelée, tant le climat poétique de l’œuvre d’un bout à l’autre de la partition (écoutez la Ballade à la lune que chante le héros au premier acte) surprend, mais son adhésion et son enthousiasme montrent combien Offenbach avait compris Musset, quelles résonances secrètes il trouvait dans le romantisme de l’auteur de Lorenzaccio. » |
C’était en 2000, qu’eut lieue cette reprise à Rennes, et sur quelques autres scènes françaises, de Fantasio dans une version hybride entre la version pour mezzo-soprano de 1872 de Paris et celle de Vienne pour soprano, toutefois chanté par un ténor, avec des parties réorchestrées. D’autres reprises eurent lieu en Allemagne.
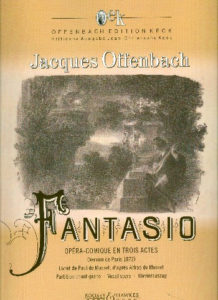 |
Il faudra l’infatigable et passionnel travail de bénédictin réalisé par le musicologue et chef d’orchestre, Jean-Christophe Keck, pour que la version pour mezzo-soprano soit enfin reconstituée, éditée chez Boosey & Hawkes & Bock et donné en version de concert au Festival de Radio-France-Montpellier, en 2015. C’est cette version Keck qui présida à l’enregistrement de l’œuvre chez Opera Rara, en 2013 – avec le soutien du Palazetto Bru Zane –, et qu’a retenu l’Opéra-Comique, pour sa réouverture de 2017.
 |
Nous ne serons jamais assez reconnaissant à Robert Pourvoyeur (1924-2007) et plus encore à Jean-Christophe Keck d’avoir rendu possible la résurrection historique de ce chef-d’œuvre.
 |
Il est relativement commun de posséder la carte bénéfique d’une bonne naissance, un peu moins celle de posséder du talent, ou encore celle d’avoir eu l’opportunité de poursuivre de brillantes études et de posséder de sérieuses connaissances musicales, pour autant celle du génie les surclassent toutes lorsqu’elle se manifeste, faisant fi de tout le reste, et ce malgré toutes les réticences et les embûches soigneusement distillées. Il aura fallu qu’Offenbach disparaisse à 61 ans pour que ses Contes d’Hoffmann surclassent les œuvres de ses rivaux excédés, amers, sans doute jaloux de l’abondance intarissable de sa source et encore 145 années de rejet, d’oubli, puis de patiente reconstruction pour que Fantasio, cet autre joyau du maestro, soit couronné à l’Opéra Comique et prenne sa place au grand répertoire.
Et dire que cela se passe à Paris en 2017… qui s’apprête, d’ici 2 ans, à fêter le bicentenaire de la naissance, en 1819, de Jacob Eberst à Offenbach-sur-le-Main, près de Francfort, de celui qui devint le « Mozart des Champs-Élysées » ou le plus parisien des compositeurs, un des plus considérables génies du théâtre musical de tous les temps, que l’on en soit dépité ou enchanté !
______________________________________
23 au 29 novembre 2020
Régression, répression, « animaux à matraque »
|
Texte dédié à Cathy SCHMITT pour la pertinence et la limpidité de ses analyses, redoutables pour les enfumeurs Remerciements à la photographe bsaz, pour l’impertinence de ses remarquables clichés |
Nous avons subit la phase initiale, celle de l’orgueil, avec trouble, tristesse, résignation, puis dégoût et révolte, il y eut le soulèvement des Gilets Jaunes, la vive réaction des syndicats (qui se respectent) fin 2019, début 2020. Voici venir la chute d’un triste sire, arbitraire, arrogant et cynique.
 |
||
| Cliché © Bsaz photographe | ||
« Il y a quelque chose d’absurde à voir le Président de la République, une fois par mois, nous détailler solennellement nos vies et prendre des airs compassés pour nous fournir un échéancier de la crise. » alerte Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne.
Sur la première page du bulletin de l’UD CGT de novembre 2020, on peut lire sous la plume de Mathieu Le Roch, Responsable à la Qualité de Vie Syndicale de l’Union Départementale CGT 24, ces lignes :
« Nous revoilà de nouveau officiellement confinés. Officiellement, parce qu’officieusement, la réalité est moins lisible. S’il est exigé des citoyens qu’ils restreignent et justifient chacune de leur sortie du domicile, les mêmes individus, en tant que travailleurs, sont sommés de continuer, pour l’écrasante majorité d’entre eux, à en sortir pour se rendre à l’entreprise, en dépit du pic de contamination annoncé. La décision de reconfinement n’a donc pas changé fondamentalement la donne pour la majeure partie d’entre eux en termes de présence au travail, mais s’est par contre accompagnée de mesures gravement liberticides, prises par le seul Gouvernement, s’asseyant allègrement sur tout débat démocratique préalable. »
D’évidence ils font leur méchante popote entre potes, nous infligeant comme de vieux curés réactionnaires des sommations, des flagellations, des privations, des mises à l’épreuve ! Tous les mois nous attendons de savoir ce qu’il en sera de notre sort : ce qui nous sera autorisé, ce qui ne le sera pas, sous menaces de sanctions cuisantes, quand ce n’est pas une bastonnade. Enfin, une loi vient exonérer les « animaux à matraques » de toute possibilité de contestation sur leurs abus, parfois, d’une extrême violence.
 |
||
| Cliché © Bsaz photographe | ||
Qu’est devenue la promesse d’Emmanuel Macron d’éradiquer les SDF, avant la fin 2017 ? Il y a aujourd’hui 10 millions de précaires et de pauvres dans ce pays. L’usurpateur avec son maniement d’expert de la supercherie, dont celle du ruissellement, n’aura fait qu’accroître la triste réalité qui l’attendait au moment de son élection et comme cela advient systématiquement sous tous les régimes néolibéraux. Ce qui est grave et détériore la confiance, c’est le permanent mensonge d’État.
Sur les réseaux sociaux, Muirguel Desrois s’indigne : « Quand Macron promettait qu’il n’y aurait plus de gens à la rue, on tire les migrants de dessous leurs abris de fortune, on les pourchasse toute la nuit pour qu’ils ne puissent se reposer, on les gaze, on les matraque. Méthodes de nazis !!! » Triste réalité qui indigne la France entière.
Dans un texte publié le 17 novembre, ayant pour titre Loi sécurité globale, la France dans le viseur des rapporteurs aux Droits de l’Homme, Cathy Schmitt, sur les réseaux sociaux expose la dangerosité de cette loi hypocrite, fielleuse, liberticide :
« Alors que l’Assemblée nationale examine le 17 novembre le projet de loi dit ‟de sécurité globale” porté par la majorité LREM, de nombreuses sociétés de journalistes, ONG et instances internationales tirent la sonnette d’alarme. Après la Défenseure des Droits, Amnesty International et la Ligue des Droits de l’Homme, c’est maintenant au tour du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU d’interpeller le gouvernement français sur un texte pouvant « entraîner des atteintes importantes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ». L’article 24, notamment, qui propose de punir d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende la diffusion d’images d’un policier ou gendarme en intervention dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique est pointé du doigt. Outre le flou qui entoure la notion ‟d’intégrité physique et psychique”, l’ONU rappelle que la documentation et la diffusion d’images d’intervention de police est essentielle pour le droit à l’information et, en outre, légitime dans le cadre du contrôle démocratique. Les atteintes à la vie privée par de nouveaux moyens de surveillance (drones, caméras) et à la liberté de se rassembler sont également dénoncées. »
 |
||
| Recyclons ! © Bsaz photographe | ||
Je n’ai participé qu’à des manifestations sereines, à Périgueux, Guéret ou Bordeaux. Je n’ai donc connaissance de ce contexte de violences, dénoncé dans les grandes villes, que par les réseaux sociaux et ce que les télévisions décident d’en dire ou montrer. J’ai été impressionné par l’exemplarité de l’analyse de Cathy Schmitt et j’ai voulu reproduire son texte pour bien souligner ce qui est inacceptable dans certains comportements policiers, incités probablement par le pouvoir drapé dans son hypocrisie, mais où l’on perd la notion de limites. Cette loi décriée par tant d’instances, d’associations, de syndicats, d’individus, ne serait-elle pas une stratégie politique pour 2022, afin de s’attirer les bonnes grâces d’une partie de l’électorat du RN et des partis d’extrême droite, car l’électorat de gauche (sauf traîtres) ne sera pas au second rendez-vous de la supercherie « ni de droite, ni de gauche ». Tout le monde a compris où se situe la doctrine du parti qui exerce si détestablement le pouvoir.
 |
||
| Les Petites canailles © Bsaz photographe | ||
Plus récemment, le 22 novembre, Cathy Schmitt toujours, publiait un texte qui m’a vivement interpellé par la manière dont elle sépare ordres supérieurs, y compris répugnants – on ne peut plus en douter –, et comportements individuels de certains policiers d’une violence honteuse tel que la remarquable photographe Bsaz en assume les reportages parisiens, avec assez souvent des photographies d’un humour décapant :
« Je vais le redire : tu es flic ou de la BAC, on te donne des ordres, tu n’as pas le choix, tu le fais.
MAIS : faire du zèle, tabasser, éborgner, mutiler, humilier, handicaper, aveugler, asphyxier, piéger des centaines de manifestants qui demandent juste une vie digne et meilleure, EST UN CHOIX.
Le fait d’envoyer la grenade juste sur la tête du manifestant est un choix.
Gazer des gens à moins d’un mètre est un choix.
Tabasser une femme, à 10, en la traînant par terre, est un choix.
Viser les yeux des manifestants pour les éborgner est un choix.
Humilier et tabasser des mômes et les envoyer à l’hosto est un choix.
Coincer une personne et la tabasser à coups de pieds sur son visage est un choix.
Blesser des milliers de personnes, les aveugler, les asphyxier, les piéger, les ‟nasser”, les mutiler et les ‟handicaper”, est UN CHOIX.
Et celui qui choisit de faire ce genre de choix n’est pas un être humain MAIS UN ÊTRE QUI A PERDU SON HUMANITÉ. »

|
||
Stupeur : « Le choix de coincer une personne et la tabasser à coups de pieds sur son visage » nous venons d’en être témoins, avec le tabassage d’une rare violence de Michel, producteur de musique à Paris. Ce qui ne peut que nous conforter dans l’analyse qu’en fait Cathy Schmitt : «Les images du tabassage en règle d’un homme noir révèlent ce que nous sommes nombreux à savoir déjà. Cette violence sans frein de la police n’est pas un accident, une bavure ou un dérapage. Il existe des milliers de Michel qui n’ont pas eu la chance d’avoir des vidéos leur permettant d’échapper aux poursuites et à l’incarcération après avoir été tabassés. La police est au-dessus des lois car les gouvernements savent très bien qu’ils ne tiennent plus que par elle. L’article 24 de la LSG illustre encore une fois que ce sont les flics qui font directement les lois par l’intermédiaire de leurs syndicats. Et les gouvernements sont aux ordres. Filmer les policiers dans leur saloperie est une arme qui peut servir à les neutraliser. Il faut donc neutraliser cette neutralisation et l’interdire.
Le tabassage de Michel nous montre à quel point les vidéos sont précieuses et nécessaires.»
 |
||
|
Extrait de la revue satirique «L’Assiette au beurre» n° 150 du 13 février 1904 , intitulé «Circulez» Dessin de Henri Gustave Jossot |
||
Plus précisément, la responsabilité de toutes ces violences abjectes revient au chef de l’État comme le rappelle la sénatrice EELV de Paris, Esther Benbassa : « Macron dit avoir honte de sa police. C’est de lui-même qu’il doit avoir honte, de ses ministres et préfets, qui ont trahi les citoyens. Il y a des années que nous dénonçons ce scandale. Si nos FDO (Forces de l’ordre) étaient exemplaires, y aurait-il eu autant de Gilets Jaunes blessés, mutilés ? »
En fait, rien ne change vraiment, de cette collusion entre pouvoir politique, religieux – un peu moins aujourd’hui (une chape de honte est tombée sur leur ostentatoire puissance) –, institutionnel et social pour exercer une domination délibérée et entretenue, d’une classe sur l’autre. La lutte des classes est toujours d’une criante actualité. Paul Nizan[1] dans les années 30 écrivait des textes d’une grande lucidité, assaisonnés de beaucoup d’humour, si ce n’est d’insolence. Hier, comme aujourd’hui, comment pourrions-nous avoir du respect pour des politiciens d’opérette qui sont trop souvent ridicules ou indignes de leurs responsabilités. La réponse à leur interrogation sur notre manque de respect est toute entière contenue dans l’impudence et la provocation de leurs comportements. Les siècles passent et rien ne change vraiment dans l’exploitation et le mauvais traitement infligé aux populations. Au sujet de la police, et d’un méchant préfet de police, Paul Nizan publiait dans l’Humanité du 20 janvier 1933, un texte intitulé Jean Chiappe[2] : Paroles d’ordre :
« Ce petit livre date de 1930, je l’ai trouvé par hasard dans une boîte des quais et je ne regrette pas mes cinquante centimes. Il a paru dans une collection nommée « Paroles du XXe siècle » : en voici quelques titres : Paroles françaises, de Poincaré ; Paroles humaines, de Doumer ; Paroles vécues, de Barthou ; Paroles sociales, de Paul-Boncour ; Paroles, enfin, par Pie XI. Admirable collection où s’unissent les curés à mitre et à tiare, les policiers, les traîtres, les maréchaux, les fabricants de guerre, les radicaux, les fascistes et l’Armée du Salut : la bêtise bourgeoise s’y étale avec une merveilleuse satisfaction de soi-même, elle est grasse comme Herriot, vaniteuse comme Boncour, elle a une suffisance de la sottise qui fait vraiment plaisir à voir.
Chiappe se définit : « Main ferme et cœur généreux » : il ne parle malheureusement pas de sa grosse épouse… La police réprime, la police prévient, la police assure la circulation avec beaucoup d’amour pour le piéton, la police veille à la beauté des monuments publics, la police veille sur les spéculateurs, sur les opérateurs de cinéma dans la rue.
On trouve dans les bureaux de la rue des Saussaies (Siège du ministère de l’Intérieur) « d’inoubliables fêtes de l’esprit ». Mais avant tout, principalement, la tâche de M. Chiappe et de ses animaux à matraque vise les communistes, ces étrangers, ces coloniaux, ces fous, ces assassins : il les dénonce, il les hait, son modèle dans ces matières d’ordre, c’est M. Thiers, dont il connaît, par cœur, les textes : quel exemple pour le nain de la Préfecture que celui de l’autre Nain de soixante et onze, du massacre d’ouvriers : que la haine réponde à la haine. […]
On sait le rôle qu’ont joué dans ces propagandes pour le policier et le provocateur, la presse « d’information » à laquelle M. Chiappe rend un hommage qu’elle n’a vraiment pas usurpé, les fêtes organisées par madame Chiappe et les hommes politiques soucieux de la santé et de la belle humeur de leurs bouledogues. Il est tout à fait significatif que, récemment, en Sorbonne, MM. Lebrun, Chautemps et quelques autres aient officiellement honoré la police, à propos du Cinquantenaire de l’Amicale de la Préfecture de police[3]. »
En démocratie, le rôle du citoyen consiste à observer, à surveiller le fonctionnement des institutions, et, si nécessaire, il lui appartient de dénoncer les abus de pouvoir que viendrait à exercer l’État. ◊
[1] Paul NIZAN (1905-1940), romancier, philosophe, journaliste français. D’abord tenté par le royalisme en raison de traditions familiales, il s’engage dans le Parti communiste français, dont il devient l’un des principaux intellectuels dans les années 1930, et qu’il quitte en 1939 à la suite du Pacte germano-soviétique. Cette rupture lui vaut les foudres du PCF, qui l’accuse longuement d’avoir toujours été un traître et un vendu. Cet état de fait contrarie pendant une vingtaine d’années la réception de son œuvre, jusqu’à sa « réhabilitation » symbolisée par la préface de Jean-Paul Sartre lors de la réédition de son ouvrage Aden Arabie. Agrégé de philosophie, il obtient surtout du succès pour ses romans, mais aussi pour son pamphlet Les Chiens de garde. Son œuvre comporte également de nombreuses critiques littéraires parues chaque semaine dans le journal L’Humanité, ainsi qu’un ouvrage de vulgarisation philosophique et des traductions de l’anglais et de l’allemand. Sa mort à trente-cinq ans en fait pour Jean-Paul Sartre un auteur éternellement jeune, qui n’a pas connu les compromissions de l’après-Seconde Guerre mondiale, et qui parle toujours aux jeunes révoltés : « À présent, que les vieux s’éloignent, qu’ils laissent cet adolescent parler à ses frères ». La célèbre phrase introductive du roman Aden Arabie : « J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie » devint un des slogans des étudiants en Mai 68. Paul Yves Nizan est le fils de Pierre Nizan, ingénieur des chemins de fer, et le petit-fils d’un ouvrier d’origine bretonne. Son appartenance à la petite bourgeoisie sera, pour lui, difficile à supporter, comme il ressort du portrait qu’il fait de son père dans Antoine Bloyé. Il effectue ses études secondaires au lycée de Périgueux, où il est remarqué pour ses talents scolaires, puis au lycée Henri-IV, et ses études supérieures (hypokhâgne et khâgne) au Lycée Louis-le-Grand, où il a pour camarade Jean-Paul Sartre, qui devient rapidement son meilleur ami. Reçu à l’École normale supérieure en 1924, il se lie aussi d’amitié avec Raymond Aron. Sartre se souviendra plus tard de Nizan comme d’un beau jeune homme, toujours bien habillé et plaisant aux femmes : « Je ne me rappelle pas que personne ait désapprouvé les toilettes de Nizan ; nous étions fiers d’avoir un dandy parmi nous ». Les deux amis passent leur scolarité à travailler ensemble, à refaire le monde au bistro et à marcher dans Paris, si bien que Sartre note ironiquement que tout le monde les confondait, comme Léon Brunschvicg, qui le félicita pour Les Chiens de garde, ouvrage de Nizan. Sur le plan politique, Paul Nizan cherche sa voie. Arrière arrière-petit-fils d’un royaliste fusillé pendant la Révolution française, il s’inscrit aux Camelots du Roy, les jeunes de l’Action française. Il participe en 1925 au Faisceau de Georges Valois., premier parti fasciste français aux accents syndicalistes-révolutionnaires. Il s’intéresse à la prise de pouvoir de Benito Mussolini en Italie, porte parfois la chemise du mouvement et invite un des économistes du groupe Le Faisceau à l’École normale pour le présenter aux élèves socialistes (Mussolini étant un ancien socialiste, l’idée existe d’une parenté entre fascisme et socialisme au moment de son arrivée au pouvoir), mais la réunion tourne mal. En cette année 1924, il lit également Lénine, qu’il emprunte à la bibliothèque de l’École, et dont le programme lui semble moins fantaisiste. Georges Valois lui-même dissout très rapidement son groupe en considérant s’être trompé sur les vertus sociales du fascisme. La même année, Nizan voyage en Italie, alors qu’il s’est déjà rapproché du communisme, et ses lettres à sa fiancée Henriette Alphen montrent surtout son intérêt pour la résistance des communistes face au fascisme. En 1926-1927, indécis politiquement et en proie à une dépression, il se rend comme précepteur à Aden (Yémen). À son retour, il adhère au Parti communiste et épouse Henriette Alphen (1907-1993), une cousine de Claude Lévi-Strauss née dans une famille juive bourgeoise. Ils auront deux enfants, Anne-Marie (1928-1985), future épouse du journaliste Olivier Todd et mère du sociologue Emmanuel Todd, et Patrick (1930). Il passe son Diplôme d’études supérieures avec un mémoire sur « la signification », puis traduit avec Sartre la Psychopathologique générale de Karl Jaspers. Sa réputation grandit dans le milieu universitaire. Il participe notamment à la Revue marxiste et à Bifur. En 1929, il est reçu 5e à l’agrégation de philosophie. Il fait son service militaire en 1930, puis l’Université réclame ses services et l’envoie comme professeur à Bourg-en-Bresse. La publication en 1931 de son premier ouvrage, Aden Arabie (qui débute par les deux phrases devenues célèbres : « J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. ») lui permet de se faire un nom dans le milieu littéraire et intellectuel. Il est nommé professeur de philosophie au lycée Lalande de Bourg-en-Bresse, dont il brossera le tableau dans Présentation d’une ville. Nizan se présente aux élections législatives de 1932 (dans la circonscription de Bresse rurale) comme candidat du parti communiste et recueille 2,7 % des voix. La même année, il publie Les Chiens de garde, réflexion sur le rôle temporel de la philosophie et pamphlet contre ses anciens maîtres, en particulier Henri Bergson et Léon Brunschvicg. En 1933, il publie Antoine Bloyé, où il évoque la « trahison de classe » (comment un homme en vient à « trahir » son groupe d’origine en gravissant les échelons sociaux). Ce livre est considéré par la critique comme le premier roman français relevant du « réalisme socialiste ». La même année, il participe au lancement de Commune, revue de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (A.E.A.R.), à laquelle collaborent Henri Barbusse, André Gide, Romain Rolland, Paul Vaillant-Couturier et Louis Aragon. Il traduit également coup sur coup, toujours en 1933, L‘Amérique tragique de Dreiser et Les Soviets dans les affaires mondiales de Fisher. Le premier livre analyse la situation des États-Unis pendant la crise financière, et appelle à imiter l’URSS pour s’en sortir ; le second fait le récit des relations internationales de l’URSS depuis la paix de Brest-Litovsk jusqu’à la victoire de Staline sur Trotsky. En 1934-1935, Nizan et son épouse Henriette séjournent un an en URSS ; fréquentant surtout les apparatchiks, ils ne croient pas à la réalité des famines soviétiques, ni au goulag. Nizan participe au premier congrès de l’Union des écrivains soviétiques, et est également chargé d’organiser le séjour d’écrivains amis, tels André Malraux (avec qui il devient très lié), Louis Aragon, Romain Rolland. Après le congrès, il s’efforce de maintenir la « flamme antifasciste » et de renforcer l’image d’une Union soviétique humaniste. Il développe dans différents articles notamment les thèmes de la naissance de « l’Homme nouveau », le bonheur de la jeunesse soviétique au travail ou encore la volonté de paix de l’URSS. Alors que des voix commencent à dénoncer l’absence de liberté d’expression en URSS et que certains s’inquiètent de la nature policière du régime, Nizan propage les mérites du « socialisme humain » au pays de Staline et fait partie de ceux qui permettent au Parti de sortir de son isolement. Ses publications se succèdent durant les années suivantes : Le Cheval de Troie, La Conspiration (prix Interallié, 1938) ainsi que les contributions à différentes revues et journaux d’obédience communiste : il écrit dans L’Humanité entre 1935 et 1937, puis dans le quotidien Ce soir entre 1937 et 1939. Il rédige notamment des articles sur la politique étrangère et des critiques littéraires. En août 1939, il rompt avec le PCF à la suite de la signature du pacte germano-soviétique. Sa lettre à Jacques Duclos est très sèche : « Je t’adresse ma démission du P. C. français. Ma situation de soldat mobilisé me dispense de rien ajouter de plus. » Son motif n’est pas un jugement moral contre l’URSS, il reproche au contraire au PCF d’avoir manqué de cynisme. Au fond, selon Simone de Beauvoir avec qui il est lié, il se sent trahi. Ses camarades communistes ne lui avaient pas soufflé mot de ce qui se tramait : il pensait qu’ils l’avaient délibérément maintenu dans l’ignorance et il en avait été blessé à mort. Dans une lettre du 8 décembre 1939 à Jean-Paul Sartre, il commente encore l’épisode : « Tout cela est impubliable avant longtemps. Les romans mêmes sont censurés d’une manière qui donne le vertige et je ne pourrais point expliquer maintenant les raisons qui m’ont fait démissionner du Parti communiste. » Le 23 mai 1940, il meurt au combat au château de Cocove à Recques-sur-Hem, au début de la Seconde Guerre mondiale, lors de l’offensive allemande contre Dunkerque. Son dernier manuscrit n’a pas été retrouvé. Il est enterré à la nécropole nationale de la Targette, à Neuville-Saint-Vaast (carré B, rangée 9, tombe no 8189). À la suite de sa rupture avec le communisme, il subit des attaques nombreuses et violentes de la part du parti : en mars 1940, Maurice Thorez signe, dans le journal Die Welt, l’édition allemande de l’organe de la Troisième Internationale, un article intitulé « Les traîtres au pilori », et qualifie Nizan « d’agent de la police ». Durant l’Occupation, un texte émanant du PCF clandestin parle du « policier Nizan ». L’offensive s’amplifie après la guerre ; Louis Aragon participe activement à la marginalisation de Nizan avec son livre Les Communistes (1949), roman dans lequel il apparaît comme un traître sous les traits du policier Orfilat. La réédition, en 1960, d’Aden Arabie, avec une préface de Jean-Paul Sartre, ouvre la voie à une « réhabilitation » de l’écrivain. Sartre décrit ainsi l’acharnement du Parti communiste à l’encontre de Nizan : « C’était la faute inexpiable, ce péché de désespérance que le Dieu des chrétiens punit par la damnation. Les communistes ne croient pas à l’Enfer : ils croient au néant. L’anéantissement de Nizan fut décidé. Une balle explosive l’avait, entre-temps, frappé derrière la nuque, mais cette liquidation ne satisfit personne : il ne suffisait pas qu’il eût cessé de vivre, il fallait qu’il n’eût pas du tout existé. On persuada les témoins de sa vie qu’ils ne l’avaient pas connu pour de vrai : c’était un traître, un vendu. » En 1966, pour la réédition des Communistes, Aragon supprime le personnage d’Orfilat. Quant au PCF, il réhabilite Paul Nizan à la fin des années 1970. Quant à son œuvre en dehors de ses ouvrages, préfaces et traductions, Paul Nizan, de 1932 à 1939, écrit régulièrement (presque chaque semaine sauf pendant son voyage en URSS) des critiques littéraires (environ 800) pour L’Humanité et Ce soir. Ses articles sont très courts et souvent incisifs. De fait, Nizan ne se considère pas comme un théoricien de la littérature, il écrit sur le vif, pressé par le temps, mais ses remarques vont souvent droit au but. Il y analyse avec finesse des auteurs qui lui sont contemporains, certains très connus aujourd’hui tels Louis-Ferdinand Céline, Marcel Proust, André Gide, Roger Martin du Gard, Jean Giono ou les Surréalistes. Il est l’un des premiers grands connaisseurs de la littérature anglaise et l’un des premiers intellectuels français à avoir remarqué la jeune littérature américaine dont William Faulkner, Erskine Caldwell, John Steinbeck, Eugene O’Neill.
[2] Jean Baptiste Pascal Eugène CHIAPPE (1878-1940), est un haut fonctionnaire et homme politique français. Entré au ministère de l’Intérieur après des études de droit, il a fait toute sa carrière au sein de ce ministère, où il entre en 1899 comme secrétaire de l’administration pénitentiaire. Il était reconnaissable à ce qu’il portait toujours une écharpe blanche et qu’il était de petite taille. Il devient ensuite chef du cabinet du secrétaire général du ministère (1909), secrétaire général du ministère en 1925 et directeur de la Sûreté générale de 1924 à 1927 année où il obtient le poste de préfet de police de Paris, où il réprime les manifestations communistes et cultive des amitiés parmi les milieux d’extrême droite dont l’Action française, Maurice Pujo fondateur des Camelots du roi… Il est populaire auprès des policiers pour avoir amélioré leurs conditions de travail et de vie. Ainsi, il facilita l’emploi des épouses de policiers comme concierges dans les immeubles de Paris. Il créa également une clinique qui existe encore et qui se nomme aujourd’hui « Hôpital des Gardiens de la Paix ». L’influence du préfet de police à cette époque était considérable : en 1934, Chiappe « commandait environ quinze mille hommes, soit plus d’un quart de la totalité des effectifs de police et de gendarmerie en fonction sur l’ensemble du territoire ». Plusieurs gouvernements successifs tenteront vainement de déloger ce haut fonctionnaire proche des milieux monarchistes. En 1930, il est à l’origine de la censure du film L’Âge d’or de Buñuel ; plus tard, ce dernier fera scander dans son Journal d’une femme de chambre le nom de Chiappe lors d’une manifestation d’extrême droite. Les socialistes ayant mis comme condition pour leur soutien au gouvernement la révocation du préfet, le radical Édouard Daladier, nouveau président du Conseil, le démet le 3 février 1934, l’accusant également d’avoir freiné l’instruction de l’affaire Stavinsky, impliquant pourtant le député-maire radical de Bayonne, Dominique-Joseph Garat, dans le scandale des faux bons de caisse du Crédit municipal. Pour éviter l’apparence d’une décision partisane, Daladier lui propose le poste de résident général au Maroc, l’un des postes les plus prestigieux de la IIIe République, que Chiappe refuse. En protestation contre cette éviction, qui eut lieu avec la prise de fonctions comme nouveau préfet de police du préfet de Seine-et-Oise, Adrien Bonnefoy-Sibour, trois ministres démissionnent, de même que le préfet de la Seine. Édouard Renard. Les ligues antiparlementaires (Croix-de-feu du colonel François de La Rocque, Action française, Camelots du roi, Solidarité française, Jeunesses patriotes) organisent quant à elles une grande manifestation de soutien le 6 février 1934 qui dégénère vite en émeute contre la République et le gouvernement et entraîne la chute de Daladier, affaibli par la démission des ministres de centre-droit en soutien au préfet de Police, qui reprend son poste. Jean Chiappe est élu, en 1935, président du Conseil municipal de Paris. Aux législatives de 1936, son élection à Ajaccio est invalidée, mais il se fait élire député de la Seine et rejoint et rejoint le groupe conservateur des Indépendants républicains. Le 10 juillet 1940, il ne prend pas part au vote donnant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui le nomme le 25 novembre suivant haut-commissaire de France au Levant. L’avion d’Air France qui le mène au Liban et en Syrie est piloté par Henri Guillaumet, célèbre pionnier de l’Aéropostale survivant légendaire des Andes. Cet avion est abattu le 27 novembre au-dessus de la Méditerranée, entre la Sardaigne et l’Afrique du Nord, par l’aviation italienne alors engagée dans une bataille aéronavale contre les Britanniques. Pierre Laval, vice-président du Conseil, protestera auprès des Britanniques et les accusera, comme certains journaux italiens, d’avoir abattu l’appareil (cette thèse est toujours discutée aujourd’hui, Chiappe pouvant avoir représenté une menace pour les intérêts britanniques au Proche-Orient. Guillaumet, ainsi que les autres membres de l’équipage, dont Marcel Reine, et les deux passagers, Jean Chiappe et son directeur de cabinet, sont tués. Il est alors cité à l’ordre de la Nation par le maréchal Pétain. [Source Wikipédia].
[3] Paul NIZAN (L’Humanité, 20 janvier 1933) chronique sur l’ouvrage Paroles d’ordre, publié aux éditions Figuière, sous la plume de Jean Chiappe, préfet de Police de Paris. Articles littéraires et politiques, volume I (« Des écrits de jeunesse au 1er Congrès International des écrivains pour la Défense de la Culture », 1923-1935). Textes réunis, annotés et présentés par Anne Mathieu, avec une préface de Jacques Deguy, Nantes, Joseph K, 2005, p. 194-196.
2, 6, 9, 12 & 13 novembre 2020
Léon-Paul Fargue, le magicien du verbe
Debout de bonne heure. Le jour se levait. Les rayons du soleil imposaient une intense lumière automnale, caressant la cime des grands arbres. Le ciel était d’un bleu outremer presque noir, comme si nous attendions un gros orage. Le contraste était saisissant. À plusieurs reprises des vols de palombes tournoyèrent en arc de cercle, leurs ailes argentées scintillaient sur l’anthracite du ciel.
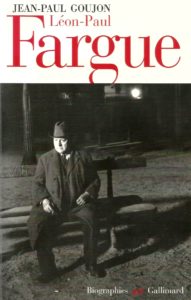 |
||
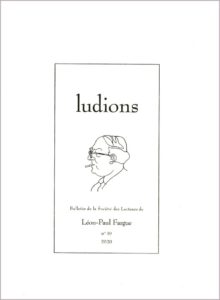 |
||
La veille, j’avais trouvé un peu difficilement les deux dernières publications que signalait le bulletin reçu récemment de La Société des Lecteurs de Léon-Paul Fargue, Ludions no 19 : Une Saison en astrologie (première publication : L’Astrobale, 1945) et Paris Nabi : Bonnard, Denis, Vuillard et les autres. Ces ouvrages sont toujours publiés, dans la continuité, chez Fata Morgana.
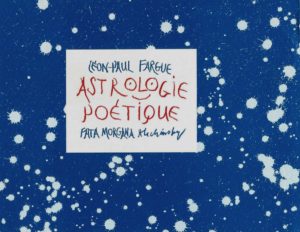 |
||
Pour autant, l’annonce majeure de ce Ludions, est l’aboutissement d’un travail colossal réalisé par Barbara Pascarel, avec la publication d’un volume, de près de 750 pages, intitulé Léon-Paul Fargue, L’esprit de Paris, édition intégrale des chroniques parisiennes. Cette somme considérable, établie et annotée par la présidente de la Société des lecteurs de Léon-Paul Fargue, réunit des textes publiés en volumes tel Le Piéton de Paris, mais aussi, et c’en est toute la vertu, des chroniques publiées dans des journaux ou des revues, non rassemblées, et que nous découvrons pour la première fois avec un bonheur qui méritera que nous y revenions. Mais ce n’est pas tout : Barbara Pascarel travaille sur deux autres volumes à paraître qui nous offriront ainsi les œuvres complètes de cet orfèvre du verbe.
 |
||
Allongé, baigné dans cette atmosphère féerique, je relisais le fascicule qu’avait édité, en 2004, Laurent de Freitas, Présence de Francis Jammes, aux éditions Sous La Lampe. La fatalité veut que ces deux poètes me touchent et donc ce que Fargue dit de Jammes, est cela même que je ressens. Il n’existe pas de prose plus intuitive, fertile, étincelante, poétique, que celle de l’auteur de Haute Solitude, la lecture est un authentique festin, une ivresse du sensible. Si bien que j’en ai ressenti une joie indicible, une volupté d’être, sensation rare, mais pas orpheline, en découvrant ou relisant des textes de Fargue. L’instant jubilatoire.
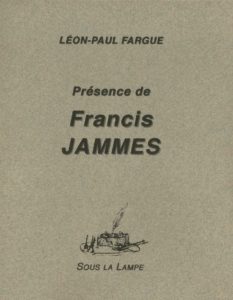 |
||
Ce petit ouvrage est le recueil de quatre textes, deux ayant été publiés du vivant du poète béarnais, les deux autres étant des hommages posthumes. Le premier de ces textes sous la plume, en 1894, d’un Fargue de 18 ans, évoque Sources, alors que Jammes était un poète provincial inconnu[1] du milieu littéraire parisien : « C’est tout le possible du monde et le pépiement de la vie simple… Ce grand poète est resté prince d’un « cas » provincial, dont il se moque bien d’ailleurs, n’ayant que très peu de goût pour les classements. Nous dirons, nous, prince d’une situation dominante, éloignée, superbe, et telle que celle du chêne solitaire régnant sur des kilomètres de froment ou de bruyères. Sa source profonde, sa source personnelle aux bruissements si honnêtes ne le rattache à rien de ce qui constitue nos casernes parisiennes. Il ne voulut point entendre parler de certains ouvrages parfaits, du canon parnassien, des sonnets de Heredia, du Taylorisme poétique des Écoles. Il ne voulut qu’être poète, follement poète, poète spontané, familier, rafraîchissant, uni par d’incroyables nuances aux oiseaux, aux épis, aux nuages, tournant le dos aux échafaudages de l’hommedelettrie, ne tolérant dans son jardin béarnais ni sonorités de cabinet de travail, ni machineries de strophes, cherchant Dieu en toutes choses, et merveilleusement doué pour continuer, à l’intention de notre cœur, les charmes de la gaucherie divine… Aussi la simplicité de ses poèmes est-elle miraculeuse. Elle laisse voir à nu son âme profonde, calme et candide. »
Le poète meurt à l’automne 1938. Le dernier texte de Fargue sur son ami disparu fut publié dans les Nouvelles Littéraires du 20 mai 1939. Et Fargue de conclure ainsi son hommage : « Nous ne regretterons jamais assez une telle présence. Mais pour maintenir entre sa fraîcheur errante et nous des rapports de nuages à ciel et d’instants à éternité, revenons souvent à lui, et rappelons aux barbares de toutes entrailles qu’il y a, au-dessus des conflits, des appétits, des lâchetés, des convoitises, des arrivismes et de la frénésie, une suprême noblesse poétique[2] ».
* * *
Le texte de David Galand, Le flair de fargue – l’olfactif dans les poèmes et les chroniques, publié de la page 69 à la page 83 du dernier Ludions [no 19, 2020] m’a particulièrement intéressé tant l’auteur a su explorer, à travers toute l’œuvre, les si nombreuses et suggestives notations de Fargue sur l’olfactif. Voici ce que nous confie cet agrégé de lettres modernes, docteur de l’université Paris 3 : « Poète ‟vertical”, qui grâce à ses mots ‟artésiens” ‟jubile, flaire, écoute, fouille et fait parfois sortir une source[3]”, Fargue voit dans la senteur ou le parfum, volatils mais rémanents, la possibilité d’une résurgence du passé qui réduise, passagèrement, la distance avec les absents. Tantôt il s’agit d’un phénomène – proustien – de mémoire involontaire, tantôt d’une anamnèse qui prend la forme d’une quête inquiète. […] Élégiaque, Fargue se sent appelé par les voix chères qui se sont tues, mais également par le parfum d’un monde enfui : « Il semble que des voix vous hèlent par-dessus les barrières et les chants des âges, et que des odeurs, comme des veilleuses, et que des fougères d’étoiles s’allument[4].. » La solitude n’est pas, pour Fargue, le vide, mais une nuit odorante, presque matérielle, peuplée d’absents : « Une odeur nocturne, indéfinissable et qui m’apporte un doute obscur, exquis et tendre, entre par la fenêtre ouverte où je travaille » écrit le poète. C’est pourquoi elle a l’agrément d’un parfum : « alors, je débouche ma solitude, fourrée d’une science durement acquise, et je la respire dans les ténèbres[5] ».
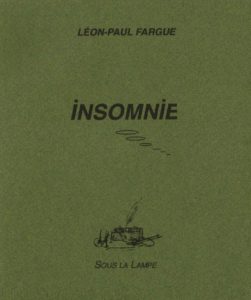 |
||
Une autre publication de Laurent de Freitas aux éditions Sous La Lampe, en 2005, nous révèle un texte du début des années 1930, pressenti pour faire partie d’un recueil devant initialement s’intituler Histoire de ressort, puis Déchiré, mais bien que plusieurs fois annoncé, il n’a jamais été publié. Le chapitre Insomnie devait paraître dans la Nouvelle Revue Française, et bien que les épreuves furent même composées, il ne parut pas non plus. Ultérieurement, des extraits éparpillés et fortement modifiés de ce texte furent intégrés dans deux chapitres de Haute Solitude, celui qui porte le nom du titre générique et dans « Je rêvais » ! Évidemment et comme toujours chez Fargue, l’olfactif se manifeste comme élément du sensitif. Je ne citerais pas toutes les phrases qui en font mention, uniquement celles qui me semblent les plus marquantes :
« Je me vois aussi rentrer à la maison au bras de ma bonne anglaise… Puis aux Champs-Élysées, jouant avec mes camarades. Puis avec ma mère, dans les grands magasins, rompu de fatigue, la tête malade, dans l’odeur chaude des tissus, du linoleum et du rayon de la parfumerie[6] ».
« … Ils sont tous comme ça, dans toutes les villes, dans toutes les maisons, avec leur robinet, leur cuisine, leur tête agitée, leur cœur qui s’éclaire et se fonce sans qu’on puisse jamais le voir, leur tête qui embrouille ses bourrelets, ses ficelles, ses filets de rainures, ses caillots de sang, leur cœur qui se met à sauter, à cogner à la porte, l’odeur des malles, du camphre et du poivre, au moment des départs en vacances[7]… ».
« Oui, j’aurais dû noter tout cela, j’en étais plein. Ces odeurs du matin. Quand j’étais jeune, l’odeur de fer de la main chaude frottée sur le balcon, l’odeur du café qui nous attend de l’autre côté, l’odeur de miel du soleil, tout au bout du parquet ciré, l’odeur de miel du soleil, tout au bout du parquet ciré, l’odeur soucieuse de la rue, de la cave, le courant d’air du côté de l’ombre… Je sais bien que beaucoup d’hommes sentent vivement, quelques-uns sont des magiciens et des prophètes[8] ».
 |
||
Avec un frontispice de Jean Cortot[9], le jour de la Saint Léon, le 10 novembre 2009, Laurent de Freitas, publiait dans ses prestigieuses éditions Sous La Lampe, un très bel opuscule In memoriam Léon Fargue 1909†-2009, père du poète, sous le titre Déchiré[10] que nous avons déjà évoqué, sans Insomnie publié séparément en 2005 et que nous venons d’évoquer. Quatre titres constituent cette publication : Aeternae Memoriae Patris, Et les jours succédaient aux jours…, Les Compagnons, Cimetière. L’olfactif lié aux pertes et déchirures apparaît dans le second texte, Et les jours succédaient aux jours… :
« Et les jours succédaient aux jours, il y eut de ces journées où nous sentions si fort les odeurs, l’odeur échauffée de la course, de la main salie de travail, d’un verre bu d’un coup par une grande chaleur, des fleurs dans un jardin, des journées aux odeurs d’abeilles – il y eût aussi ces hivers lavés de grandes pluies, l’odeur des vêtements d’hommes mouillés, où se réveillait l’odeur des bêtes, et toutes ces fenêtres qui cachaient les yeux, bleues sur l’appartement, allumées la nuit, ces départs, ces dénouements d’êtres qui s’aiment, …ces rassemblements, …ces départs, tant de jours avec cette odeur du café le matin, tant d’étés avec cette odeur aux approches de la mer[11]… »
* * *
Jean-Paul goujon, dans sa biographie définit Fargue comme « un homme inconsolable de la douleur d’être homme[12] ».
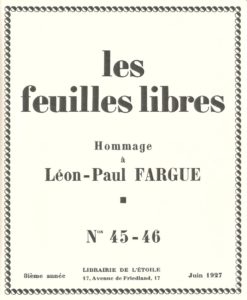 |
||
Claudel avait participé, en 1927, dans Les Feuilles Libres, à un hommage collectif au poète dans lequel il l’évoquait sous le titre Nascuntur poetæ [13] : « S’il y eut jamais un poète né, c’est-à-dire, non pas un spectateur, mais un faiseur de vie, non pas un copiste, mais un associé et un collaborateur de la création, quelqu’un à qui la Fée a remis un grain de sel et une étincelle de feu, pour qui tout ce qu’on lui montre est à la fois du délicieusement connu et du tout frais, et qui, haut le pied, dans le remue-ménage universel, connaît juste le moment d’intervenir dans un jet de cocasserie splendide, c’est notre ami. Quand on se penche sur un texte de Fargue, la ligne ne reste pas comme une passementerie inanimée, c’est tout le carré de la page qui se met à marcher et à bouillir, agitée d’une espèce de mouvement colloïdal, comme une place un samedi de marché… On voit danser, tourner, pousser… une foule de petits êtres prodigieusement actifs et vivants, faits d’un nom et d’un adjectif, d’un verbe et d’un adverbe… Et quelquefois c’est le Mardi-Gras, tout le monde a changé de chapeau et la trogne la plus banale sous le plumet intempestif a pris un caractère exorbitant ! Point de secret de la découpure et de la projection que n’emploie cet expert de l’amalgame humain, cet entremetteur ubiquitaire du geste et de l’idée… »
Vingt années se sont écoulées, ce 29 novembre 1947 – quelques jours après la disparition de Fargue – lorsqu’on peut lire dans le Figaro littéraire, le nouvel hommage, d’une clairvoyance inspirée, de Claudel :
« … Ce que Fargue apportait avec lui, tout simplement, c’était le génie.
C’est beau, le génie ! C’est un privilège, de serrer la main droite d’un de ces hommes exceptionnels de qui on est constamment en droit d’attendre l’inattendu ! qui ne fabriquent pas artificiellement des bibelots, mais qui, tout à coup, ouvrent la porte à l’un de ces visiteurs sacrés, à l’une de ces phrases qui vous font vibrer des pieds à la tête, et qu’on pourrait appeler un ange verbal […] C’était la Pythie intérieurement travaillée par l’obsession du dieu, je dis la conscience et la recherche avec lui de rendez-vous obscurs[14] ».
Voici pourquoi, ce qui m’attache à Fargue, au-delà d’une commune nostalgie du temps enfui, « Tout ce qui me touchait disparaît », des affections envolées, c’est de toute évidence une grande tendresse… « Seuls, tous les deux, sur la route, au bout des confins, au bord de la nuit[15]… »
[1] Dans Portrait de Francis Jammes, Fargue écrit : « J’ai été, je peux bien le dire, tout à fait le premier à parler de lui. », puis de nouveau dans Prolongements de Jammes – ce Virgile, ce Hugo, ce Mistral d’Orthez : « …J’ai rappelé que j’avais été le premier à penser du bien de lui, à dire du bien de lui, il y a très longtemps, dans le Mercure de France. Je ne le rappellerai plus pour ne pas abuser de ce privilège de plume et de souvenir. Mais ce que je tiens à préciser c’est que, dès le début, pour moi, Jammes, ce fut un dieu. ». Léon-Paul Fargue, Présence de Francis Jammes, Sous La Lampe, Graveson, 2004, ouvrage non paginé.
[2] Léon-Paul Fargue, Présence de Francis Jammes, Sous La Lampe, Graveson, 2004, ouvrage non paginé.
[3] Léon-Paul Fargue, Suite familière, « Bruits de café », éditions de la Nouvelle Revue Française, 1929, p. 33-34 & Poésie [Tancrède, Ludions, Poëmes, Pour la musique, Espaces, Sous la lampe (Suite familière, Banalité)], Paris, Gallimard, 1963, p. 266.
[4] Suite familière, op. cit., « Dans la rue qui monte au soleil », p. 81, & Poésie [Tancrède, Ludions, Poëmes, Pour la musique, Espaces, Sous la lampe (Suite familière, Banalité)], Paris, Gallimard, 1963, p. 96.
[5] L.-P. Fargue, Épaisseurs, « La drogue », Poésies, Paris, Gallimard, 1963, p. 174
[6] Léon-Paul Fargue, Insomnie, Sous La Lampe, Graveson, 2005, ouvrage non paginé.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Jean Cortot (1925-2018) est un artiste peintre et illustrateur français, fils du pianiste Alfred Cortot. Il fréquente jeune les milieux littéraires, et notamment Paul Valéry. Il fut l’élève d’Othon Friesz à l’Académie de la bGrande Chaumière à Paris. En 1943, il est recruté par l’administration des Beaux-Arts et réalise l’inventaire d’oeuvres mises à l’abri au château de Brissac, en Maine-et-Loire. À la Libération, il s’installe dans un atelier du quartier de Montparnasse, rue Lebouis, qu’il occupe tout au long de sa carrière. Il est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts en 2001. [Source : Wikipédia].
[10] Les textes de Déchiré ont été assemblés afin de célébrer le centenaire de la mort de Léon Fargue père, disparu en août 1909. Ce témoignage est le reflet de l’attachement profond et sensible du poète à ses parents et en particulier à son père.
[11] Léon-Paul Fargue, Déchiré, « Et les jours succédaient aux jours… », Sous La Lampe, Graveson, 2009.
[12] Jean-Paul Goujon, Léon-Paul Fargue, Paris, Biographie nrf Gallimard, 1997, p. 280.
[13] Les Feuilles libres, hommage à Léon-Paul Fargue, nos 45-46, Paris, Librairie de l’Étoile, juin 1927, p. 81-82.
[14] Paul Claudel, Léon-Paul Fargue, Le Figaro Littéraire du 29 novembre 1947.
[15] Léon-Paul Fargue, Déchiré, « Cimetière », Sous La Lampe, Graveson, 2009.
Juin, août et octobre 2020
Françoise Decroix, Jardinière
11 juin 2020. Monflanquin, un très charmant village du Lot-et-Garonne. Ce matin, sous un ciel gris, en l’église Saint-André, sa famille, ses amis accompagnaient une Dame que j’ai rencontrée maintes fois, appréciée, et pour laquelle j’avais une grande estime. Une relation qui a fleurie au temps où j’édifiais le jardin des Rolphies entre 1985 et 2000. Françoise Decroix nous a quittés dans sa quatre-vingt-quinzième année.
 |
||
| Mélia Azédarach © Photo Laurent Bessière, 2020 | ||
Mon texte de quatre pages était achevé, lorsqu’il a disparu de l’ordinateur avec une page supplémentaire de notes. Le réécrire sera toujours pour exprimer ma reconnaissance. Il me faut dire la gratitude que j’éprouve pour cette Dame réservée, généreuse et impliquée dans son métier de jardinière. Je ne lui aurais peut-être fait aucun cadeau, que cependant elle méritait mille fois. Elle a été l’ange qui a suivi en quelque sorte l’édification de ce lieu de vie, sans jamais y être venue ; lieu faisant de moi un pauvre, vivant tel un prince. C’est d’ailleurs mon collègue de travail à la trajectoire professionnelle fulgurante qui me qualifiait ainsi. Mais au temps de sa réalisation, le prince était aussi le principal jardinier, ainsi que je lui en fis la remarque. Tout paysan, provisoirement propriétaire d’un morceau de notre vaste terre, n’est-il pas en quelque sorte un prince pauvre en son royaume ?
C’est à la fin des années 80 que je fis la connaissance de Françoise Decroix. J’avais déjà exploré tout ce que comptait de pépiniéristes le département de la Dordogne et je commençais à rechercher des raretés au-delà de ses limites. J’avais noté à la date du mercredi 3 juin 1987 une prise de contact téléphonique lors de laquelle, elle m’avait indiqué travailler avec Jean-Louis Cousin des Pépinières Saint-Georges, dans la Somme, qui proposait des végétaux de collection.
À la recherche de ‟Rastouillac” au-dessus du Moulin de ‟Boulède”, ma première visite à Monflanquin, eut lieu le lundi 8 juin 1987. Françoise vivait dans cette belle demeure dont elle occupait une partie, ses deux sœurs un peu plus âgées occupaient d’autres parties de la longère. Elle s’occupait du jardin florifère et ornemental et entretenait elle-même des jardins. Elle avait son propre jardin, sur le côté sud de la maison. Sa sœur Claire réalisait des pots-pourris enchanteurs avec des plantes aromatiques et des pétales de fleurs. Françoise était particulièrement affable, à l’écoute, et désireuse de conseiller modestement un novice enthousiaste ; elle fut toujours une très attentive et pertinente conseillère. Ce jour-là, il fut question d’iris et donc de Lawrence Ranson à Hautefage-la-Tour. Elle proposait également des bulbes.
Je revins la visiter le 15 août, puis le vendredi 27 novembre 1987, après une visite à Nojals-et-Clotte, lieu-dit ‟Riotte”, chez monsieur Hervé Borie, qui était le maire de cette petite commune. Monsieur Borie, excellent homme, apiculteur, tenait une pépinière de végétaux mellifères de grand intérêt où je trouvais de quoi réjouir nos amies les abeilles tout en me faisant plaisir !
Grâce aux conseils de Madame Decroix, je connus des adresses d’un intérêt majeur : les établissements Vielmont à Tonneins où le responsable avait une sainte mère et des prix très démocratiques, sans doute même préférentiels, les pivoines Béderède, les Établissements Latour-Marliac à Temple-sur-Lot, le Gotha des plantes et fleurs aquatiques. Pour moi, la plus précieuse fut celle des établissements Courserant, à Bias (Villeneuve-sur-Lot) qui me fournirent un Melia Azédarach[1] que je recherchais et qui me comblait de plaisir que ce soit par sa floraison mauve odorante, sa fructification, comme son feuillage découpé, de toute beauté à l’automne, avant qu’une tempête de vent ne le dessouche, à ma très grande tristesse.
 |
 |
|
| Floraison odorante du Mélia Azédarach | Fructification du Mélia Azédarach | |
 |
 |
|
| Floraison printanière et fructification de la saison précédente | Feuillage d’automne | |
Françoise me conseilla encore de visiter l’Arboretum de l’École Du Breuil[2], le parc départemental de la Roseraie de l’Haÿ-les-Roses[3], et la roseraie de Bagatelle[4], deux lieux merveilleux pour ceux qui aiment les roses, et qui comme moi désiraient réunir une collection ; collection aujourd’hui très dispersée ! Je fis, sur ses recommandations, ces visites enthousiasmantes, au mois de juin 1987.
 |
||
| Abbaye et Jardins de VALLOIRES | ||
 |
 |
|
| Les jardins de l’abbaye de Valloires (Somme) — Paysagiste Gilles Clément | ||
 |
 |
|
| L’Abbaye de Valloires et ses jardins, été & automne | ||
Comme elle commandait pour moi des plans auprès de Jean-Louis Cousin qui transférait sa collection à l’Abbaye de Valloires[5], je fis le voyage le 13 septembre 1988, pour en ramener quelques raretés. J’eus le privilège d’y rencontrer Jean-Louis Cousin après avoir visité les jardins et fait le choix de quelques végétaux rares. En soirée, j’admirais Le Touquet. Le lendemain je fis halte aux Jardins de Cotelle à Derchigny-Graincourt, près de Neuville-les-Dieppe, une pépinière qui proposait une vaste collection de vivaces. Le vendredi 16 septembre je découvrais en matinée le ‟Bois des Moutiers” à Varengeville-sur-Mer, le cimetière marin avec les tombes du compositeur Albert Roussel et du peintre Georges Braques. L’après-midi ce fut ‟Le Vasterival” (sur la commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer). Je conterai, un prochain jour, ma découverte du plus beau jardin de France et la rencontre avec celle qui le conçut avec tant d’inspiration, la Princesse Greta Sturdza, aux magnifiques yeux bleus de ciel.
Mes visites en 1988, et les Floralies de Casteljaloux du dimanche 4 juin 1989 et du dimanche 15 octobre 1989 étaient de sympathiques opportunités de retrouver les Letoux qui en étaient les principaux organisateurs, Richard Benquet, les pépiniéristes Bentoglio, Bederède… et bien sûr Françoise Decroix, parfois, sa charmante sœur, Claire. J’ai noté ma participation jusqu’en 1993. Il y avait aussi deux manifestations au printemps et à l’automne, à Saint-Nicolas-de-la-Grave organisées par l’association ‟La Salicaire” dont, un temps, je fus membre.
* * *
Ayant retrouvé cette lettre de vœux que je lui adressais début 2012, comme j’en écrivis tellement à cette époque, avant la messagerie d’Internet, montre assez qu’au début de mon temps de retraité, j’avais pleinement conscience de ce que j’avais reçu de Madame Decroix qui m’avait adressé, hors l’usage, cette année-là, ses vœux la première (que je retrouverais peut-être un jour). J’y faisais donc réponse :
« Chère Madame, une autre année nous advient sans doute avec ses joies et ses peines, ses rires et ses pleurs. Ainsi va notre monde, bien incohérent. J’apprécie toujours autant vos délicates pensées. Ainsi que vous le savez le temps raréfie progressivement et souvent sévèrement nos relations, alors que les gestes d’amitié deviennent plus essentiels quand sonne le temps d’une solitude accrue.
Ici le calme m’environne toujours même si les constructions en campagne courent le long de nos routes autrefois innocentes d’habitations si ce n’étaient quelques fermes dont les fonctions ancestrales ont aujourd’hui cessées.
Olivier et moi-même avons repris le jardin qui était devenu touffu, confus. Chaque végétal reprend ses marques et laisse un peu de lumière aux autres. Olivier est paysagiste et travaille ici depuis plus de dix ans. Il n’y a plus cette infinie suite de petits jardins, qui caractérisaient les lieux, mais un seul jardin avec des perspectives plus vastes et étagées. Olivier est passionné par son métier et construit son propre jardin qui évitera tous les défauts du mien… ce sera un autre charme, différent.
J’espère que votre santé vous autorise toute la richesse de vos activités humaines, sociales, de jardinière dont vous êtes le plus noble exemple que je connaisse, tant vous êtes en harmonie et fusion avec l’élément végétal que l’humanité maltraite si dangereusement.
Il me semble qu’il en est de la nature comme des oiseaux du ciel, il nous appartient de leur apporter la protection que mérite la richesse fabuleuse de leur présence autour de nous. Enfin vous connaissez ces mystères et grâces mille fois mieux que moi !
Recevez, chère Madame, mes souhaits les meilleurs pour 2012. Que cette année vous apporte tout ce à quoi aspire une belle âme. Croyez à ma fidèle et affectueuse estime. »
Une ultime visite eut lieu le mercredi 12 juin 2013, à son nouveau domicile, 22 rue de la République à Cancon, après un périple qui nous avait conduit aux établissements Latour-Marliac au Temple-sur-Lot, afin de choisir pour mon nouveau bassin réalisé par Olivier, deux nénuphars, et de lui offrir la variété ‟Black Princess” pour le remercier de sa conception et réalisation. Ce fut un moment émouvant pour moi, riche d’émotion, mais aussi de sérénité. Plus probablement une leçon de sagesse : l’art d’exister avec la plus grande sobriété, lorsque le devoir est accompli et que l’on s’apprête à s’en aller, en vivant sereinement dans un retrait d’absolue modestie.
La générosité de Françoise dans sa vie de Jardinière par excellence, auprès de ses sœurs dont elle prit soin lorsque cela devint nécessaire, par son investissement auprès de malvoyants, et tout ce que je n’ai jamais su de son désintéressement, méritait cet humble hommage dont je crains, comme pour quelques autres, qu’il soit tristement unique. C’est alors une grande injustice, mais elle aura pu s’en aller la conscience en harmonie avec sa foi et son exigence peu ordinaire.
« Il n’y a pas beaucoup de gens comme elle sur la Terre, qui ne trouvent leur bonheur qu’à se dévouer sans interruption et sans fin au bonheur des autres. J’ai eu le privilège de la connaître. C’était plus important que de connaître Einstein ou de Gaulle[6]. »
[1] MELIA AZÉDARACH ou Lilas de Perse, largement planté en Asie comme arbre de temple, est actuellement utilisé en tant qu’arbre de reboisement en Chine, en Inde, en Amérique du Sud et Centrale.
[2] ARBORÉTUM de l’ÉCOLE DU BREUIL. C’est en 1867, que l’Ecole municipale d’arboriculture de Saint-Mandé fut créée, près de la porte Daumesnil, sous l’impulsion du préfet Haussmann. Elle sera transférée, en 1936, au Sud-Est du bois, et baptisée École Du Breuil, du nom de son premier directeur. Les conifères, l’arbre au caramel, le cunninghamia, les bambous… Plus de 2 000 arbres de 800 espèces différentes cohabitent dans l’enceinte de ce musée vivant de l’arbre. Ses collections végétales sont étudiées par les élèves de l’école et les amateurs, petits ou grands, qui peuvent y suivre des cours de jardinage. Guidés par un étiquetage méticuleux, vous ne manquerez pas un seul spécimen digne d’intérêt. [Source : https://www.tourisme-valdemarne.com/patrimoine-naturel/arboretum-de-lecole-du-breuil/]
[3] ROSERAIE de L’HAŸ-LES-ROSES ou Roseraie du Val- de-Marne. Jardin d’agrément, de plaisir et de beauté, la Roseraie du Val-de-Marne est devenue un jardin public mondialement connu. On y découvre une collection de plus de 2 900 variétés de roses, mises en valeur dans un jardin à la française de 1,5 hectare. Ce jardin, homologué ‟Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées” et inscrit à l’inventaire des monuments historiques, a également été labellisé, depuis 2011, ‟Jardin remarquable”. Ces milliers de roses y sont réunis en 13 collections uniques en fonction de leurs origines, de leur histoire et de leurs variétés. Edouard André, Jules Gravereaux et son fils Henri sont les créateurs d’un jardin d’exception : le premier jardin entièrement dédié aux roses. Tous trois ont ainsi inventé un nouveau style de jardin : « la Roseraie ». Ils démontrent qu’un jardin de collection peut aussi être un jardin d’agrément et que le rosier dans sa diversité permet à lui seul de créer un jardin selon les principes du jardin à la française. De nombreuses variétés de rosiers, des supports différents, des éléments d’architecture, des sculptures ainsi que la reprise du vocabulaire du jardin permettent cette réinterprétation. Sa singularité a d’ailleurs été reconnue, la Roseraie du Val-de-Marne ayant été inscrite sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en août 2005. En 1905, Jules Gravereaux rencontre les Rosati, troupe de théâtre créée en 1776, regroupant une société des gens de lettres, célébrant la femme et l’amitié. Gravereaux leur propose d’organiser des représentations dans sa propriété. Ainsi naît le ‟théâtre de verdure” de la Roseraie. Ce théâtre est à l’extrémité sud de la Roseraie. La scène est en plein air, engazonnée et appuyée sur les arbres du Parc. Pendant de nombreuses années, ce théâtre servit de cadre à des spectacles brillants – danse, théâtre – accueillant les plus grandes personnalités du moment. Jardin mondain, il était le témoin du style de vie d’une famille bourgeoise de la Belle Époque. Alors que la rose lui avait livré presque tous ses secrets botaniques, Gravereaux se prend d’intérêt pour sa symbolique et entame le projet de collectionner toutes sortes de documents et objets sur celle-ci. Le bureau et le laboratoire deviennent le musée bibliothèque de la rose. Classés en quatre sections – sciences, lettres, beaux-arts et arts décoratifs – céramiques, peintures, tapis, soieries, timbres et bibelots en tous genres, côtoient une bibliothèque spécialisée en rhodologie (étude des roses, de leur culture) contenant livres, revues, herbiers et dossiers documentaires classés par thèmes. Aujourd’hui, la plupart de ces 11 000 objets sont conservée aux Archives départementales du Val-de-Marne. On y trouve également le fonds Legrand-Cochet comprenant la série complète du Journal des roses créé par Charles Cochet ainsi qu’une édition des Roses peintes par Pierre-Joseph Redouté (1829). Vingt-deux ans durant, Jules Gravereaux fera preuve de permanence, rigueur et modernité dans sa démarche, à l’exemple de l’amateur éclairé des XVIIIe et XIXe siècles. Collectionneur de roses botaniques mais aussi savant rhodologue, il travaille à la création de roses nouvelles par hybridation de types sauvages. Il crée ainsi une vingtaine de roses telles que ‘Mme Ancelot’, ‘Mme Jules Gravereaux’… Ses multiples recherches permettent alors la progression des méthodes de culture. À sa mort en 1916, Gravereaux laisse à la postérité une collection aussi riche et ordonnée que les connaissances botaniques de l’époque le permettent. En 1937, la propriété est vendue au Département de la Seine. En 1968, le Département du Val-de-Marne en reprend la gestion. Depuis, le patrimoine n’a cessé d’évoluer et la collection actuelle comprend 50 % de variétés créées avant 1916 et 85 % de variétés créées avant 1940. Dès le XIXe siècle, les nouvelles techniques d’hybridation des roses ont permis aux obtenteurs de créer des formes de fleurs nouvelles et des couleurs toujours plus éclatantes… Mais ces créateurs ont oublié le parfum ! En 1901, J. Gravereaux est chargé par le ministre de l’Agriculture d’une mission sur les roses à parfum dans les Balkans. Comment développer une activité économique similaire en France ? Après une étude sur le terrain pour étudier les méthodes de culture bulgares, Gravereaux consacrera quatre ans à l’obtention par hybridation de nouvelles roses à parfum et à perfectionner les procédés de distillation. Ces recherches donneront naissance à la ‘Rose à parfum de L’Haÿ’. Aujourd’hui, les créateurs de parfums parcourent la Roseraie en tous sens. Véritable laboratoire vivant en plein air, elle leur offre sa large palette de senteurs les plus subtiles. [Source : https://roseraie.valdemarne.fr/jardin-historique]
[4] ROSERAIE de BAGATELLE. Elle est située dans le Parc de Bagatelle au Bois de Boulogne est l’une des plus importantes et anciennes roseraies de France. Le Parc de Bagatelle est racheté par la Ville de Paris en 1905. Le conservateur des jardins de Paris, Jean Claude Nicolas Forestier, est alors chargé de sa réhabilitation. Il s’attache à en faire un jardin de collections botaniques sans détruire l’harmonie des aménagements précédents et transforme les zones vivrières du parc en jardins de présentation afin d’y exposer des collections florales, notamment la célèbre roseraie de Bagatelle. Chaque année, depuis 1907, en juin, s’y déroule un concours international de roses nouvelles. Cette roseraie est l’une des cinq collections françaises de rosiers, labellisée ‟collection nationale” par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. La roseraie de Bagatelle compte environ 9 500 plants de rosiers représentant environ 1 100 variétés. Elle présente également des espèces et des cultivars de nombreux hybrides de Rosa Wichuraiana et de Rosa Luciae.
[5] ABBAYE et JARDINS de VALLOIRES, Jean-Louis COUSIN, Gilles CLÉMENT. Valloires est une abbaye cistercienne du XIIe siècle, admirablement conservée, situé sur la commune d’Argoulès dans la vallée de l’Authie, dans la Somme. Quelques personnages ont marqué ces lieux dont Thérèse Papillon (1886-1983), infirmière de formation qui sauvera lors de la Seconde Guerre Mondiale des enfants juifs et s’engagea dans la résistance. Elle repose aux côtés de son frère Jean-Baptiste Papillon, dans la chapelle de la Vierge de l’abbaye. Le frère combattant volontaire, à 17 ans, lors de la Grande Guerre, devint prêtre en 1925, aumônier du préventorium de Valloires dirigé par sa sœur et curé des paroisses environnantes. Très actif au sein de la J.A.C., il créa un cinéma rural ambulant. Fait prisonnier en 1940, libéré en 1941, il s’engage dans la résistance où il fut chef militaire de l’Armée secrète et capitaine des FFI. Pilote d’avion et motard, il mourra d’un accident de moto en 1957. L’organiste Marie-Claire Alain (1926-2013) était marraine de l’abbaye et de son orgue, elle venait régulièrement jouer alors que son frère, le compositeur Jehan Alain (1911-1940) y a composé son Choral cistercien pour orgue en 1934. Les Jardins de Valloires (labellisés Jardin remarquables) sont des jardins botaniques et paysagers de Picardie maritime qui s’étendent sur une superficie de huit hectares ; ils présentent une collection unique en France de 5 000 espèces et variétés d’arbustes rares. Véritable écrin de verdure, le parc botanique a été conçu pour faire découvrir au grand public la richesse du monde végétal. Tout au long des saisons, vous découvrirez sur 8 hectares la splendeur des cerisiers en fleurs, l’élégance et le parfum des milliers de roses (dont l’incontournable Rose de Picardie), les lumineuses couleurs d’automne, sans oublier le jardin « interactif » des cinq sens, destiné aux enfants. Le Grand Jardin de l’Évolution est une première en France : partez à la découverte de la vie des plantes depuis 400 millions d’années ! Son origine date de 1981, lorsque le pépiniériste et collectionneur du Pas-de-Calais, Jean-Louis Cousin, recherchait un site pour sa collection de roses et de quelque 3 000 variétés et espèces nord asiatiques et américaines. Parmi les points d’intérêt le jardin de roses présente 80 variétés de roses modernes associées aux plantes médicinales et potagères. Près de 120 variétés de roses anciennes et botaniques se trouvent également dans le Jardin des Iles. En 1985, la Région Picardie, le département de la Somme, le Syndicat intercommunal d’aménagement et de développement du Ponthieu-Marquenterre et le Syndicat mixte de l’aménagement de la côte picarde décident de construire de nouveaux jardins au pied de l’abbaye de Valloires. La collection initiale de J.-L. Cousin ne présentait aucun problème d’implantation puisque les taxons proposés étaient originaires de latitudes tempérées et adaptables aux sols argilo-calcaires. Les collections végétales proposées offrent une grande diversité d’espèces d’arbres, d’arbustes et d’herbacées. Certains sujets sont uniques en Europe. Un des rôles des jardins de Valloires est d’être une collection de référence. C’est aussi un conservatoire spécialisé pour le genre très rarement présenté de Rubus avec une collection nationale agréée, reconnue par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS). À partir de 1987, le célèbre paysagiste Gilles Clément associé alors à Philippe Niez, signe à Valloires son premier grand jardin. Sa conception s’intègre parfaitement à l’environnement « naturel » et au caractère historique des lieux, sans pour autant reprendre tous les codes du jardin monastique. Valloires est un jardin contemporain, où les plantes sont classées non pas par espèce ou horizon géographique mais selon des critères de couleurs, de ressemblances ou d’autres encore (plantes piquantes, plantes insolites…). Le paysagiste connaît particulièrement les plantes mais également les insectes et en tient compte dans ses réalisations. En 2004, Gilles Clément définissait ainsi sa conception des jardins : « Le jardin en mouvement suppose que le jardin change constamment de forme, mais que le jardinier en est constamment le créateur. » L’originalité des jardins de Valloires tient en une collection préexistante, multiple ; à cette contrainte inhabituelle, le paysagiste a choisi « d’opposer un tissu de formes simples. »Les jardins de Valloires ont été inaugurés en 1989 après deux années de travaux. Les jardins de Valloires sont inclus dans le projet du futur Parc naturel régional Baie de Somme-Picardie Maritime. [Source Wikipédia].
[6] BARJAVEL, René. Si j’étais Dieu (French Edition) (p. 18). FeniXX réédition numérique. Édition du Kindle.
20 & 21 octobre 2020
Inutile de nier ce qui n’est rien
Vendredi, le meurtre sauvage de ce professeur à proximité d’un collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, est une horreur. L’assaillant est un jeune homme de 18 ans, abattu par la police. Deux morts inutiles, violentes et cruelles qui m’ont plongées dans une tristesse sourde, inhabituelle, surtout après avoir pris connaissance du texte qui toujours s’exprime à rebrousse-poil (supprimé de Facebook, sa page aussi semble-t-il : on ne ferait donc pas de différence entre « incitation à la violence » et « invitation à réflexion et à la lucidité. ») de Bruno Adrie, un écrivain, qui à l’habitude, un peu à la manière des psychanalystes, de regarder ce qui se cache derrière les convenances, les idées reçues, les apparences : « Quand j’entends des politiques qui envoient des enseignants en première ligne pour se faire les propagandistes d’une laïcité – qui risque à la longue de s’avérer illusoire – et d’une liberté d’expression – passablement réduite à la liberté d’invectiver – ça me fait penser à Joffre[1] qui, bâfrant assis devant un plat de côtelettes, envoyait les fantassins français tomber, baïonnette en avant, sous les mitrailleuses allemandes alors que les deux peuples, ennemis tous deux de la Haute Banque et de l’impérialisme, auraient dû se jeter dans les bras l’un de l’autre. L’histoire a montré que la concorde n’était pas simple, mais elle a surtout montré que le principal ennemi de la concorde est la classe dominante qui vit du chaos et de la désolation qu’elle entretient dans les sociétés qu’elle gouverne. Parions que nos gouvernants vont tout faire pour tirer électoralement parti d’un crime dont ils sont grandement responsables. »
Je crains beaucoup qu’il ait raison. Certains montrent du doigt l’insanité des relations que nous entretenons avec certains dictateurs du Golfe, Bruno Adrie est de ceux-là et sa réflexion ne me semble pas impertinente (elle aussi supprimée des réseaux sociaux) : « ‟La France va réagir avec la plus grande fermeté” a déclaré le Premier ministre… Que va-t-il donc faire ? Rompre les relations diplomatiques avec les pétromonarchies du Golfe ? Cesser notamment de leur vendre des armes ? Interdire sur le territoire les organisations qui financent et diffusent l’extrémisme ? Cesser de soutenir les terroristes en Syrie ? Il pourrait aussi défendre une liberté d’expression vraie qui n’accepterait pas de se voir confondre avec la publication de caricatures insultantes qui n’ont jamais eu d’autre effet que de jeter de l’huile sur le feu. ‟Avec la plus grande fermeté”, a-t-il dit. Que d’éléments de langage… signature de la Macronie. »
J’apprécie, plus que certains, sans doute, les caricatures, mais pas vraiment celles qui attaquent la religion, leurs prophètes, saints, dieux… Pourquoi ? Parce qu’elles blessent inutilement les malheureux croyants et l’on n’élimine pas aisément, non pas la foi, mais plutôt les superstitions que chacun entretien pour supporter (voire aggraver) sa dépendance, son joug. J’adore Jacques Offenbach qui caricature en musique, de manière très irrévérencieuse, notre société, mais jamais les religions ou les croyances. Ce serait donner des coups de pieds dans les canes des boiteux, des infirmes. Je fus jeune homme fragile et très croyant, Krishnamurti m’a guéri, non sans une vraie souffrance pour y parvenir. Comme Jean d’Ormesson, je me sens totalement agnostique, tout en espérant qu’il puisse exister quelque chose de moins vide que le néant ! Le philosophe français Pierre Magnard, âgé de 93 ans, se déclare croyant tout en précisant qu’il reproche à Dieu, ‟la manière” dont il nous assène ses coups. En pensant à ce crime de Conflans-Sainte-Honorine, à des millions d’autres, à la Shoah… si le Dieu décrit par le Nouveau Testament existe vraiment, alors en effet nous pouvons lui reprocher sa « manière », au-delà de « ses mauvaise manières » !
 |
||
| Pierre Magnard © Radio Courtoisie | ||
Pour moi, si un tel Dieu venait par malheur, à exister, il mériterait, plus que beaucoup de dirigeants du monde, dépourvus gravement de « la manière », de recevoir un coup de pied au cul en lieu et place des traditionnelles prières et louanges. Peut-on imaginer in fine un tribunal planétaire ayant à juger cette ‟divinité” pour non-assistance et crime contre l’humanité ?
 |
 |
 |
||
| Balade chez Marcel Conche – Blog de Jean-Claude Grosse | Jean d’Ormesson & Marcel Conche | |||
| Marcel Conche en Corrèze | ||||
Un autre philosophe français, aujourd’hui âgé de 98 ans, Marcel Conche[2], avait épousé son institutrice particulièrement croyante et pratiquante, alors qu’il ne l’était absolument pas, ce qui ne gêna en rien la solidité de leur couple. L’intelligence et la tolérance autorisent d’heureuses cohabitations.
Conche explique qu’il n’est pas possible d’imaginer un dieu qui couvrirait toutes les horreurs et abjections du monde depuis des siècles, soit par indifférence, impuissance ou désir de châtiment. Il n’est donc pas question pour lui de reprocher à Dieu sa vilaine ‟manière” de s’y prendre avec l’humanité. Dans son ouvrage Orientation philosophique voici ce qu’il dit de l’existence de Dieu : « Je dois refuser d’admettre la possibilité de la légitimité du supplice des enfants. Or croire en l’existence d’un Dieu créateur du monde serait admettre la possibilité de cette légitimité. Ainsi, d’un point de vue moral, je n’ai pas le droit de croire, je ne puis croire en Dieu. Il est donc moralement nécessaire de nier l’existence de Dieu. (…) Il est indubitable, en effet, que le supplice des enfants a été et ne devait pas être, et que Dieu pouvait faire qu’il ne soit pas. Comme Dieu ne s’est pas manifesté dans des circonstances où, moralement, il l’aurait dû, s’il existait, il serait coupable. La notion d’un Dieu coupable et méchant apparaissant contradictoire, il faut conclure que Dieu n’est pas. »
 |
||
En effet, comment imaginer un Dieu qui puisse ressentir moins de compassion que certains êtres humains devant les souffrances et les crimes de notre monde ? On penserait alors à un diable et non à un dieu. Ainsi, il n’y a pas à se référer à un Dieu bon où affligé de ‟mauvaises manières”. La simple raison porte à abonder à la vision de Marcel Conche telle qu’exprimée dans son ouvrage Le Destin de solitude : « J’hésite, cependant, à me dire athée, car le mot ‟Dieu” a peu à peu perdu, pour moi, toute signification. Il me paraît sans objet, et je ne crois pas qu’il y ait lieu de nier ce qui n’est rien. »
 |
||
| Rassemblement, Périgueux © UD CGT Dordogne | ||
Nous étions, avec Khadra à Périgueux, à 15 H 00 pour la manifestation en hommage à ce professeur sacrifié. L’UL CGT l’a ainsi relayé : « Hier, entre 800 et 1000 Périgourdins se réunissaient au pied de l’arbre de la liberté de Périgueux, à l’appel de l’intersyndicale CGT educ’action, FSU, UNSA éducation, SGEN-CFDT et FNEC FP FO, afin de rendre hommage à Samuel Paty, enseignant assassiné. Pour la liberté d’expression, pour la fraternité, pour la laïcité. ». Nous avons constaté l’ampleur de cette foule, et retrouvé une pincée de Camarade et en particulier notre Secrétaire Générale Départementale, Corinne. Khadra qui, en raison de ses problèmes de mobilité, ne sort que par nécessité médicale, était heureuse de mettre le nez dehors par ce temps idéal, sans avoir trop à marcher.
L’intervention était sans relief, ni émotion… ratée à mon sens, mais pas seulement au mien. De plus, à l’aller comme au retour, il m’a fallu rouler en sens interdit pour se garer et repartir ce qui n’est pas du tout dans mes habitudes. Il est vrai que l’annonce tardive sur le Facebook de la mairie de Manzac, ne m’a pas autorisé à modifier mon désir de participer à cet hommage et à notre fidélité à la laïcité, en me joignant à ce qui a été fait à l’école de Manzac, dans la plus grande simplicité, ferveur, en présence d’une cinquantaine de personnes. La déclaration de Yannick Rolland, sans apprêt, ni fioriture dit l’essentiel de cet événement et de notre lucidité pour y faire face : « C’est une onde de choc qui traverse le pays à travers l’attaque immonde et lâche envers Samuel PATY. Cet enseignant de la République n’a fait que son travail. Il a voulu expliquer la liberté d’expression à travers des dessins et il en est mort. Il n’était pas islamophobe.
 |
 |
|
|
Rassemblement à l’école de Manzac-sur-Vern, avec Marie-Claude Kergoat (maire de Bourrou) et Yannick Rolland (maire de Manzac) © photos mairie de Manzac-sur-Vern |
||
Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à ce mal profond qui traverse notre pays. Cette idéologie totalitaire doit être combattue avec toute l’énergie et la force qu’il faut pour en finir avec les actes barbares.
La République est une nouvelle fois attaquée. Cette attaque, vise une nouvelle fois la laïcité. Nous devons la défendre et la protéger car elle est l’un des piliers du vivre-ensemble. Je tiens à témoigner tout mon soutien à la famille et au monde enseignant.
Lorsque le fondamentalisme religieux est entré dans l’esprit d’un être humain, il ne conduit qu’à la ruine de celui-ci. »
Ainsi, j’ai donc accompagné Khadra qui était heureuse de s’échapper de son chez-soi, lui permettant de revoir quelques camarades et ensuite de faire les ultimes cueillettes dans son jardin qu’elle avait dû abandonner pour des raisons de santé : il y avait là les fruits oranges d’une passiflore, des grenades, des poireaux, des carottes, une jolie petite citrouille, trois ou quatre concombres et de toutes jeunes courgettes. Elle a généreusement partagé avec moi son charmant butin. J’adore les grenades ! Merci Khadra. ◊
[1] Joseph JOFFRE (1852-1931) est un officier général français de la Première Guerre mondiale. Après un début de carrière marqué par les expéditions coloniales (Tonkin, Soudan français, et Madagascar), il est nommé en 1911 chef d’État-Major de l’Armée, notamment parce qu’il est un spécialiste de la logistique ferroviaire. En 1914, en tant que commandant en chef des armées, il met en œuvre le plan de mobilisation et de concentration, puis fait appliquer le principe de l’ « offensive à outrance », alors enseigné à l’École de guerre, qui se révèle extrêmement coûteux en vies humaines, notamment lors de la bataille des Frontières. Il est ensuite l’artisan de la victoire alliée lors de la bataille de la Marne. Confronté à l’impasse de la guerre de position sur le front ouest, ses offensives de l’hiver 1914-1915 et de l’été 1916 échouent. Fin 1916, il est élevé à la dignité de maréchal de France et remplacé par le général Nivelle. En avril 1917, il conduit avec Viviani, la délégation française envoyée aux États-Unis et convainc le président Wilson de hâter la formation et l’envoi de l’armée américaine sur le front. En 1918, il est élu à l’Académie française. Son rôle dans le conflit fait l’objet de plusieurs controverses. [Source Wikipédia].
[2] Marcel CONCHE est né le 27 mars 1922 à Altillac en Corrèze, c’est un philosophe français, spécialiste de métaphysique et de philosophie antique. Il est le fils de Romain Conche, modeste cultivateur corrézien, et de Marcelle Farge, décédée peu après l’accouchement (Alice Farge, sa tante maternelle, fut la seconde épouse de son père). Il commence sa scolarité au cours complémentaire de Beaulieu-sur-Dordogne et aurait dû la poursuivre à l’École normale primaire de Tulle, mais les ENP ayant été supprimées par le gouvernement de Vichy, il étudie au lycée Edmond-Perrier de Tulle comme élève-maître (1940-1943). Il étudie ensuite au Centre de formation professionnelle de Limoges (1943-1944) puis à la faculté des lettres de Paris où Gaston Bachelard est l’un de ses professeurs. Il obtient successivement la licence en philosophie (1946) et le diplôme d’études supérieures de philosophie (1947). Après avoir passé avec succès le concours de l’agrégation de philosophie en 1950, Marcel Conche enseigne successivement aux lycées de Cherbourg, d’Évreux et de Versailles. Il est ensuite assistant puis maître-assistant de philosophie à la faculté des lettres de Lille puis maître-assistant (1969-1978) et enfin professeur (1978-1988) à l’université de Paris I. Il y a dirigé l’unité de formation et de recherche. Depuis 1988, il y est professeur émérite. Agrégé de philosophie et docteur ès lettres, Marcel Conche a produit une œuvre à la fois abondante et variée, qui traite de nombreuses questions de métaphysique. Dans ses premiers ouvrages, il a développé une métaphysique générale et vaste, avec des études sur la mort (La Mort et la Pensée, 1975), le temps et le destin (Temps et destin, 1980), Dieu, la religion (Nietzsche et le bouddhisme) et les croyances, la nature, le hasard (L’Aléatoire, 1989), la Liberté enfin. Dès son plus jeune âge, la notion de Dieu perdit toute espèce de consistance aux yeux de Marcel Conche : « L’expérience initiale à partir de laquelle s’est formée ma philosophie fut liée à la prise de conscience de la souffrance de l’enfant à Auschwitz ou à Hiroshima comme mal absolu, c’est-à-dire comme ne pouvant être justifié en aucun point de vue. » Bien qu’élevé dans le christianisme, Conche a très tôt rejeté l’explication théologique du monde. Sa philosophie ne conçoit pas l’existence de Dieu ; en cela, il est philosophe athée. Néanmoins, si la philosophie se coupe par essence de la théologie, elle ne doit pas se constituer en science ni prétendre vouloir le faire. Conche soutient (en prenant pour base son expérience personnelle) que le questionnement philosophique naît « par l’essor spontané de la raison » : « La philosophie, c’est l’œuvre de la raison humaine et elle ne peut pas rencontrer Dieu. » C’est pourquoi il s’est toujours senti proche de la philosophie grecque qui commence avec Anaximandre, « le premier écrivain philosophe ». Conche s’est beaucoup intéressé à l’œuvre de l’humaniste Michel de Montaigne. Selon Conche, les grands penseurs modernes (Descartes, Kant, Hegel) ne sont pas des philosophes authentiques, car ils ont voulu utiliser « la raison pour retrouver une foi pré-donnée ». Ils n’ont pas compris ce qu’est la philosophie comme métaphysique, mais ont tenté d’en faire une science, ce qui apparaît à Conche comme une erreur fondamentale : « La philosophie comme métaphysique, c’est-à-dire comme tentative de trouver la vérité au sujet du tout de la réalité, ne peut pas être de la même nature qu’une science. Elle est de la nature d’un essai, non d’une possession : il y a plusieurs métaphysiques possibles, parce qu’on ne peut trancher quant à ce qui est la vérité au sujet de la façon de concevoir la totalité du réel. La métaphysique n’est donc pas affaire de démonstration, mais de méditation. » Le vrai philosophe de l’époque moderne serait Montaigne, car il a réussi, de l’avis de Conche, à écrire son œuvre indépendamment des croyances collectives de son époque (tout à la fin des Essais, Montaigne recommande non son âme, mais la vieillesse, non au dieu chrétien, mais à Apollon). Dans son naturalisme, Conche soutient la physis grecque, la nature au sens le plus englobant du terme : « L’absolu pour moi, c’est la nature. La notion de matière me paraît insuffisante. Elle a d’ailleurs été élaborée par les idéalistes et c’est hors de l’idéalisme que je trouve ma voie. Il est très difficile de penser la créativité de la matière. […] La nature est à comprendre non comme enchaînement ou concaténation de causes, mais comme improvisation ; elle est poète. » Il retrouve sur ce point la pensée des présocratiques, avec lesquels il ne cesse de dialoguer sur le tout de la réalité (en particulier dans Présence de la nature, 2001) : « L’homme est une production de la nature et la nature se dépasse elle-même dans l’homme. En donnant des aperçus sur la nature qui se complètent, les présocratiques sont tout à fait différents des philosophes de l’époque moderne qui, eux, construisent des systèmes qui s’annulent. Parménide nous révèle l’être éternel, Héraclite, le devenir éternel, Empédocle, les cycles éternels. Il y a une complémentarité entre eux. De la même façon, les poètes se complètent. La physis grecque ne s’oppose pas à autre chose qu’elle-même, alors qu’au sens moderne, la nature s’oppose à l’histoire, à l’esprit, à la culture, à la liberté. La physis est omni-englobante. » Soucieux du devenir de la planète, il se revendique « en faveur de ce que l’on appelle la décroissance ». Parmi ses très nombreux ouvrages : Montaigne ou la conscience heureuse, Seghers, 1964, 1966, 1970 ; Mégare, 1992, PUF, 2002, 2007, 2011 ; Lucrèce et l’expérience, Seghers, 1967, Mégare, 1981, 1990, 1996, Fides, coll. « Noésis », 2003 ; PUF, 2011 ; Pyrrhon ou l’apparence, Mégare, 1973, 2e éd. remaniée et augmentée, PUF, 1994 ; Épicure (texte, traduction, introduction et notes Marcel Conche), Lettres et maximes, Mégare, 1977, PUF, 1987,1990, 1992, 1995, 1999, 2003, 2009 ; Héraclite (texte, traduction et commentaires Marcel Conche), Fragments, PUF, 1986, 1987, 1991, 1998, 2003, 2011 – Prix Langlois de l’Académie française, 1987 ; Anaximandre (traduction, introduction et commentaires Marcel Conche), Fragments et témoignages, PUF, 1991, 2004, 2009 ; Heidegger résistant, Mégare, 1996 ; Nietzsche et le bouddhisme, Cahiers du Collège international de philosophie, no 4, novembre 1987 ; Nietzsche et le bouddhisme, Encre Marine, La Versanne, 1997, 2007, 2009 ; Lao Tseu (traduction et commentaires Marcel Conche), Tao te king, PUF, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011 ; La Mort et la Pensée, Mégare, 1974, 1975 ; L’Aléatoire, Mégare, 1989, 1990, 2e éd., PUF, 1999 et 3e éd. augmentée ; Présence de la nature, PUF, 2001, éd. augmentée, PUF, coll. « Quadrige », 2011 ; Quelle philosophie pour demain ?, PUF, 2003 ; Philosopher à l’infini, PUF, 2005, 2006 ; La Liberté, Les Belles Lettres, coll. « Encre Marine », 2011 ; Fondement de la morale, Mégare, 1982, 1990 ; PUF, 1993, 1999, 2003 ; Vivre et philosopher : réponses aux questions de Lucile Laveggi, PUF, 1992, 1993, 1998, Livre de Poche, 2011 ; Confession d’un philosophe : réponses à André Comte‑Sponville, Albin Michel, 2003, Livre de Poche, 2003 ; Heidegger par gros temps, Les Cahiers de l’Égaré, 2004 ; Oisivetés. Journal étrange II, PUF, 2007 ; Corsica. Journal étrange V, PUF, 2010, 2011 ; Le Silence d’Émilie, Les Cahiers de l’Égaré, 2010 ; Ma vie (1922-1947) : un amour sous l’Occupation, HDiffusion, 2012 ; Épicure en Corrèze, Éditions Stock, 2014. [Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Conche].
Du 3 octobre au 10 octobre 2020
Le Jardin se met au vert à Manzac-sur-Vern
|
Texte dédié à Yannick Rolland, jeune maire de Manzac-sur-Vern, à ses Adjointes et Adjoints, au Conseil municipal, investis avec conviction dans un projet de renaissance vertueuse de ce village du Périgord Blanc, ainsi qu’à Benoît Perret, Naturopathe, Guide nature écologiste. |
Alors peut-être modestement, le monde rural, moins dense
que les métropoles, peut permettre de trouver des conditions
favorables à la coopération, parce que tout le monde se connaît et que
l’agressivité y est souvent moins exacerbée. Avec l’espoir que les processus
de développement local, l’accueil de nouveaux habitants, l’association
de toutes les parties prenantes au projet d’un village soient
les ferments d’activités nouvelles, complexes et respectueuses
du vivant. Elles permettront de faire plus facilement face
aux crises ultérieures et de procurer à chacun de grands
moments de joie et de fraternité, là aussi, sources de vie.
Sylvie Le Calvez, L’accueil et la coopération[1]
L’écologie progresse, en dépit des ambitions dévorantes d’un melon pro capitaliste ou de celles illimitées de l’Altesse du « En même temps » qui va et vient, avec grande agilité verbale, au gré des vents contraires, défiant toute logique, avec le plus décomplexé des opportunismes.
Certains s’arc-boutent et se mobilisent : comment ne pas réagir au vue des catastrophes météorologiques récurrentes ? Que de responsabilités honteuses porte ma génération, béate, sidérée, avachie dramatiquement par l’impact des « Trente glorieuses » !
Aujourd’hui, les alternatives se multiplient face aux menaces considérables du réchauffement climatique et de l’imbécillité criminelle du consumérisme dogmatique.
J’observe donc ceux, qui conscients, optent pour d’immédiates transformations de nos modes de vie, de consommation… Et ceci en dépit de la désorganisation écologique mondiale qu’évoque ma sœur Françoise, qui avec son compagnon, achevait il y a une semaine, à bicyclette, le parcours du canal du midi depuis Agen jusqu’à Sète. Et il est vrai que ce qui se fait ici, là ou ailleurs ne semble être que la « part du colibri ». Une part précieuse et exemplaire cependant qui est en train de conquérir de plus en plus d’esprit éveillés. Si l’on en croit Benoît Perret (que j’évoquerais ultérieurement) : « Quand les activités humaines perturbatrices cessent, la vie sauvage retrouve rapidement un certain équilibre. Il est donc toujours temps de mettre en place des actions pour lutter contre l’érosion de la biodiversité. Laisser des zones non tondues dans son jardin, fabriquer un gîte à insectes ou créer une petite mare sont des actions simples qui participent à la sauvegarde de la biodiversité[2]. » Et quoiqu’il en soit, nous devons penser à ceux qui viennent d’arriver sur la planète terre en méditant sur cette déclaration d’Hubert Reeves : « Ce n’est pas la Terre qui est en danger ; elle va continuer à tourner sur elle-même et autour du Soleil. Ce n’est même pas la vie qui est menacée. Elle est robuste et les espèces ont déjà connu cinq extinctions majeures. C’est nous qui sommes en péril. Plus exactement nos descendants, enfants et petits-enfants. »
Je ne sais plus comment je suis venu la première fois sur le marché de Manzac qui est le village le plus proche de mon domicile (3 kilomètres), offrant l’avantage des circuits courts. C’est très certainement la mention bio sur les banderoles qui avait retenu mon attention lors d’une traversée du village, il y a quatre ou cinq ans. L’horaire inhabituel de 16 h 30 à 19 h 00 avait été choisi pour permettre au flux des travailleurs libérés après leur journée de travail, qui traversaient le village, durant cette plage horaire, de faire halte et de prendre au passage des provisions alimentaires. Lucette, membre du Conseil municipal d’alors, n’était pas vraiment soutenue dans son initiative. Sa fréquentation était des plus agréables, elle était toujours pour nous tous un vrai rayon de soleil, ce qui compte presque autant que ce que nous trouvions sur les étals. Nous connûmes trois maraîchers bio, le très sympathique Fabrice avec sa roulotte et son cheval, puis un temps limité, le courageux Stéphane, et enfin un jeune sportif, fiable et déterminé, David, qui nous apportait, semaine après semaine, l’essentiel de notre consommation en légumes. Une aubaine très appréciée de tous, et son stand était toujours très sollicité. Il y avait aussi Josette, fidèle et joyeuse, avec ses viandes et charcuteries maison, d’excellents fromages, et à certains moments des fruits et des légumes, la charmante Corinne proposait ses fruits rouges et en saison des tomates, melons et haricots verts ainsi que les conserves de canard de leur ferme. Avec son ravissant sourire, Claire Lamargot apportait ses miels et sa bonne humeur. Épisodiquement d’autres vendeurs non négligeables participaient à notre petit marché. Nous traversâmes quelques moments de doutes du fait de l’irrégularité de la fréquentation. À mes yeux, c’était le marché le plus convivial du secteur, nous avions de véritables échanges entre nous et avec les commerçants, ce qui était bien un des objectifs de Lucette.
Lucette avait dit qu’elle ne se représenterait pas au Conseil municipal, en 2020, alors qu’elle savait que le candidat à la succession au mandat de maire, était très favorable à ce marché.
Et ce fut bien le cas, non pas vaguement favorable, gentiment tolérant, mais soutenant activement le projet, le faisant progresser grâce à son investissement, celui de son adjointe, la belle Claire Vertongen. Sous sa férule, notre marché a su accueillir de nouveau stands, la fréquentation se fidélise et s’accroît, signe que nous allons dans le bon sens. Yannick Rolland y venant pour lui-même aussi souvent que possible comme sa Première Adjointe, militante convaincue. Heureuse surprise, Yannick est un partisan de la cause écologique, non pas par opportunisme politique, mais par réflexion et conviction. Son programme affichait ses objectifs écologiques pour Manzac et j’observe qu’il s’y emploie, à la dextérité propre aux jeunes et aux actifs. Nous ne sommes plus dans le choix, qui longtemps fut le mien et celui de pas mal d’autres, de consommer autrement pour préserver notre propre santé, mais dans une volonté collective et citoyenne, pour le bien-être de tous les habitants de ce lieu de grand passage vers Périgueux, Saint-Astier, Vergt, Villamblard et Bergerac.
Il y eut à Manzac, deux fêtes populaires particulièrement réussies, le 14 juillet, puis le 1er août.
Récemment, le député LREM, Philippe Chassaing, est venu rencontrer le maire de Manzac, après quoi, il fit une déclaration dont je retiens ce paragraphe : « Il m’a entretenu de ses projets en faveur de l’écologie et du vivre-ensemble qu’il mènera durant son mandat, pour proposer plus de produits bio et locaux dans le restaurant scolaire de sa commune, pour installer un rucher municipal, un verger collectif, des jardins partagés, des projets de très court terme puisqu’un lancement officiel aura lieu samedi 26 septembre lors d’une manifestation autour du jardin et de la flore. »
Le député est revenu discrètement pour la fête du 26 septembre. Manifestation sympathique quelque peu embrumée par le mauvais temps qui, frais et humide, fut nettement pire le lendemain. Imaginons que leurs deux rencontres et conversations aient pu avoir quelque influence sur le récent vote de Philippe Chassaigne à l’Assemblée nationale, contre la réintroduction des néonicotinoïdes, tueurs, en autres, des abeilles.
Dans un texte intitulé Divine abeille, Hélène Renoux, médecin homéopathe nous confie : « …Leur efficacité naturelle n’aurait besoin que de s’exprimer sans intervention pour continuer de fournir le miel tout en pollinisant arbres, fleurs et autres graminées. Outre ce rôle primordial de pollinisation qui semble tout droit issu d’une mission divine de perpétuation de la vie terrestre, les abeilles offrent généreusement les produits de leur ruche pour divers usages connus de mémoire d’homme. Gelée royale et propolis sont d’irremplaçables remèdes adaptogènes et immunomodulateurs. Les dilutions homéopathiques d’Apis sont réputées pour leur action antiallergique immédiate, et pas que chez les homéopathes. Mais ces derniers savent bien que les vertus de ce remède sont beaucoup plus étendues. […] C’est sans doute pour satisfaire ces buts élevés que la nature a pourvu les abeilles d’un équipement de radars sophistiqués, leur permettant de repérer les pollens odorants puis de retrouver le chemin de la maison dans un ballet géométrique aussi complexe qu’harmonieux.[3] »
Dans une correspondance privée, Benoit Perret, rappelle à juste titre, que « l’abeille domestique ne joue qu’un rôle mineur dans la pollinisation des végétaux comparativement aux plus de 950 espèces d’abeilles sauvages. L’abeille domestique est surtout à saluer pour les produits de la ruche qu’elle nous offre si généreusement. Mais concernant les pesticides, toutes les abeilles, sauvages ou domestiques, en subissent les conséquences dramatiques que nous observons depuis trop longtemps. Les pesticides n’étant qu’un aspect du problème. »
Christophe Gatineau sur son site où il présente son ouvrage écrit : « En France, il y a quasi 2 fois plus d’espèces d’abeilles que d’oiseaux, mais une seule espèce produit du miel en grande quantité, l’abeille mellifère. En revanche, pour la reproduction des plantes, la pollinisation, toutes les espèces sont requises, complémentaires et indissociables. » [https://www.lejardinvivant.fr/2020/03/08/il-y-a-970-especes-dabeilles-en-france/]
 |
||
 |
||
 |
||
Le Jardin se met au vert, est une fête avec des activités fédératrices et pédagogiques, puisqu’elle fait la plus grande place à l’écologie dans nos vies de citoyens. Des expositions : « Le développement durable » (Bibliothèque départementale de prêt), coin librairie (prêt de la Bibliothèque de la Ville de Coursac), sur le thème écologique. Présence de stands liés à l’écologie : LPO Dordogne sur le thème Les oiseaux utiles au jardin, un autre sur le compostage et Jardinez sans pesticides de l’association Pour les enfants du pays de Beleyme.
Une buvette et une restauration étaient à la disposition de tous à des prix particulièrement démocratiques. Excellente tisane de thym, gingembre et miel que je pris pour me réchauffer au retour de la balade découverte de l’après-midi.
 |
 |
|
| Buvette et restauration, Les Amis du RPI des écoles de Grignols et de Manzac | Marie & Jordan sont prêts à passer à table ! | |
|
|
||
 |
 |
 |
||
| Coin librairie (Bibliothèque de la Ville de Coursac), Développement durable (Bibliothèque départementale de prêt), Second stand de SMD3 | ||||
 |
 |
|
| Stand compostage du SMD3 | ||
 |
||
| Bourse aux plantes | ||
 |
 |
 |
||
| Sous la main innocente de Valentin, tirage de la tombola qui fit de nombreuses heureuses | ||||
De 14 h 00 à 17 h 00, s’ouvrait une bourse des plantes qui eut beaucoup d’adeptes. Puis la journée s’achevait par le tirage des lots, sous la main innocente de l’adorable Valentin, tombola au profit du rucher de l’école. Objectif atteint, et un maire qui a le sourire, chaque objectif devant trouver sa réalisation !
 |
||
 |
 |
 |
||
| Seconde balade découverte en début d’après-midi avec le guide nature Benoît Perret | ||||
Pour autant, la vraie découverte, fut le guide nature Benoît Perret qui conduisit deux balades découvertes sur le thème Plantes sauvages. Benoît Perret[4], est un personnage simple, éminemment sympathique, chaleureux et surtout… surtout d’une éblouissante compétence en son domaine, dépouillé de prétention ou d’ostentation. Il possède une élocution assurée, limpide, ininterrompue, sauf pour répondre à nos questions. Son langage articulé, accessible à tout un chacun s’avère particulièrement audible et convaincant. Que voilà un excellent pédagogue ! En peu de temps on apprend beaucoup sur diverses espèces auxquelles nous n’avons jamais prêté beaucoup d’attention, sauf pour quelques initiés qui cependant se montrèrent enthousiastes. Ses connaissances et compétences encyclopédiques sur les plantes, l’univers végétal, autorisent un retour à l’autonomie alimentaire et médicale grâce à un rapport étroit avec la nature ! Il ne se suffit pas de répéter ce qu’il a appris, ayant payé le prix fort des études privées, mais a expérimenté l’autosuffisance à la manière de Henry David Thoreau[5]. Il y a une absolue nécessité d’en revenir à l’essentiel : en dehors du contexte nature, faune et flore, nous n’avons qu’une existence artificielle. Krishnamurti et d’autres l’ont dit mille fois, la vraie spiritualité est là, nous ne sommes rien d’autre qu’un des éléments du cosmos… et ce n’est pas rien !
 |
 |
|
| Le guide nature Benoît Perret et son ouvrage, Les plantes sauvages comestibles de nos jardins | ||
Après notre balade nature, rafraîchissante à tous points de vue, Benoît Perret, nous présentait son ouvrage Les plantes sauvages comestibles de nos jardins qui permet de confirmer ce qu’il nous a appris et à enrichir nos connaissances sur d’autres espèces que nous n’avons pas rencontrées sur un espace limité. Cet ouvrage est entièrement conçu par son auteur, écriture, photos, mise en pages… Il se veut clair et accessible y compris pour le néophyte. François Couplan[6], ethnobotaniste en a rédigé la préface dont je relève ce passage : « …Comme l’affirmait le philosophe américain Ralph Emerson[7], il n’y a pas de mauvaises herbes, il n’y a que des plantes dont nous ne connaissons pas (ou plus) les vertus. Et pour moi, ces adventices (en langage policé) sont l’expression de la nature, qui couvre la terre nue pour y faire pousser une succession d’herbacées, d’arbrisseaux, d’arbustes, puis d’arbres menant à la forêt[8]. »
Le texte était intitulé Le salsifis des prés aux tendres boutons ; dans un Plantes & santé (n° 169 – juin 2016), François Couplan, qui écrit dans maintes revues, évoquait sa passion pour les beignets de salsifis que cuisinait sa mère : « …Les beignets de salsifis me transportaient littéralement de plaisir. Imaginez de grosses racines bien droites à la peau brunâtres, toutes blanches une fois pelées, que l’on trempait dans une pâte onctueuse avant de les jeter dans la « grande friture » où les beignets rissolaient quelques minutes. Ils en ressortaient dorés à point, croustillants à l’extérieur, moelleux et croquants à l’intérieur, avec une saveur d’une finesse extrême. Il y avait toutefois un « hic », c’était l’épluchage. Comme tous les cousins du pissenlit, le salsifis, qu’il soit sauvage ou cultivé, renferme un latex caoutchouteux… ». Il me reste quelques souvenirs d’un plaisir tout semblable !
Parmi les astéracées, on trouve le Tragopogon pratensis, c’est-à-dire le Salsifis des prés, qui possède des particularités dégustatrices un peu différentes. Benoît Perret nous dit dans les toutes dernières pages de son guide : « Les racines se mangent avant le développement des tiges (Note de l’auteur : il faut bien savoir alors où se trouve, ce pied !). Elles s’ajoutent aux salades, crues, découpées en rondelles ou hachées. Elles sont douces et légèrement sucrées. On peut également les cuire à la vapeur ou les faire sauter à la poêle. Les jeunes feuilles se consomment au printemps. Elles sont bonnes, crues en salade ou cuites comme légumes. Les fleurs en bouton sont sucrées. » Les descriptions de Benoît sont plus culinaires et permettraient en cas de disette de survivre avec un certain nombre de ces adventices, presque en gourmet !
♦ ♦ ♦
 |
 |
|
| Hotel, restaurant, ‘Le Suquet’, sur l’Aubrac (Aveyron) | Restaurant panoramique, ‘Le Suquet’ | |
Comment n’aurais-je pas été interpellé et enchanté par l’avant-dernière partie de la diffusion du mercredi 7 octobre, sur France 3, de l’émission Des Racines et des ailes (Passion patrimoine : terroirs d’excellence en Occitanie) où l’on accompagne la journée du chef cuisinier Sébastien Bras[9].
 |
||
| Une fabuleuse complicité entre père et fils, Michel & Sébastien Bras | ||
Il est le digne héritier et complice de son père Michel (élu meilleur chef du monde, en 2016) étoilés et célèbres à juste titre, dans cet hôtel-restaurant d’ardoise et de verre dominant le haut plateau de l’Aubrac, Le Suquet. Terre magnifique s’il en est, dessert vert, se refusant a plus de 3 habitants au km2 ! Et lorsque je rends visite à mon amie Marie-Hélène Douat, à Saint-Laurent-d’Olt, je ne suis pas bien éloigné de Laguiole ! Ces deux personnages sont fascinants de par leur passion, non seulement en raison de leur éblouissante inventivité, mais surtout pour leur curiosité doublée d’un émerveillement propre à l’enfance. On adhère au commentaire d’une cliente familière des lieux : « On trouve ici l’âme d’enfant de la famille Bras ! » Voilà qui détermine le droit à de tels personnages de vivre centenaires ! Une passion aussi vibrante et exceptionnelle que celle que j’observais dans le regard et dans nos échanges avec Madeleine Milhaud, lorsqu’elle évoquait la musique de Darius, entre 96 et 99 ans ; elle s’en est allée à 106 ans ! J’ai adoré leur jardin d’herbes avec 200 espèces de plantes et de fleurs venus du monde entier et les cueillettes qui font l’objet d’un rituel presque sacré. Ce n’est pas uniquement de la décoration raffinée et artistique de l’assiette, c’est avant tout l’art des associations subtiles. Il faut un nez, le goût des alliances et une grande pratique pour réunir dans une même assiette les légumes habituels ou moins, avec l’Achillée, la Pimprenelle, le Plantain, l’Oxalis, l’Aigrelette ou Oseille sauvage, l’Ail des ours, le Gaillet jaune ou blanc, le Thym serpolet (propice à valoriser la saveur des desserts à base de cerises et d’abricots), la Livèche, les fleurs de Bourrache, la Silène, la Tanaisie… Quel plaisir encore de voir des salariés heureux et épanouis dans leur activité professionnelle. Voilà un établissement qui sera passé de 4 salariés en 1992 à 75 aujourd’hui : impressionnant ! Mon unique réticence sera pour la peau de lait, « le petit Jésus en culotte courte », passion de Sébastien ; j’ai connu cette peau de lait chez mes grands-parents, elle me faisait immédiatement fuir ! Mais si çà ne me séduit pas, je n’ai pas à en dégoûter les autres !
 |
 |
 |
||
| Les assiettes flamboyantes de la cuisine végétale du ‘Suquet’ | ||||
Quoi qu’il en soit, le paysage de l’Aubrac est dans l’assiette, ombres et lumières, cette tradition familiale d’une cuisine végétale a de quoi me séduire, elle m’irait même sans canard, porc, bœuf ou poisson. C’est une cuisine vivante qui change tous les jours au gré du temps, des saisons, des récoltes au jardin ou des herbes sauvages, des arrivages sur le marché de Rodez, et de la fertilité créatrice de Sébastien et de ses seconds. Selon Michel Bras, cette cuisine qui s’approprie la nature, en totale osmose avec le pays, traduit une émotion, un état, venant de l’âme. Comme la peinture, la musique, elle est une autre forme d’écriture. Alors, il n’y a que du bonheur à aller ainsi par les chemins de traverses, y cueillir des simples sous le regard attendri de quelques vaches maquillées de noir (yeux d’Andalouse), surtout si vous avez en main un bouquet de Cistre !
Sébastien se passionne pour le fenouil sauvage des Alpes. Il fallait assister à la fabrication d’un tome au lait infusé d’une décoction de Cistre[10], chez Lionel Sabrié, l’ami, éleveur en bio. C’est comme un jeu d’enfant : essayer, non sans réfléchir à la densité du goût entre fromage et herbe, à la température de chauffe de l’infusion, pour créer une nouvelle saveur, un nouveau plaisir !
Les tarifs, il est vrai, peuvent modérer notre enthousiasme : les menus vont de 147 € à 395 € (Offre le «Goût du jardin») et la nuitée de 350 € à 630 €.
♦ ♦ ♦
La rencontre avec Benoît Perret résonnait de forts échos de possibles qui se sont manifestés tout au long de mon existence. J’avais 17 ans, lorsque Albert Gazier, guérisseur très réputé à Douchapt, avait voulu faire de moi son aide pour la partie herboristerie de son activité. Vers 28 ans, de nouveau, lorsque après ma mission, et sous l’influence de mon ami Jean-Jacques Beyney, naturopathe, qui avait suivit les cours de Pierre Valentin Marchesseau[11], j’avais envisagé de suivre la même formation. Début mars 2020, quatre jours avant ses 90 ans, mon ami Pierre, de Saint-Astier, guérisseur par les plantes, ayant hérité des recettes de son grand-père – dont j’ai informatisé une partie – s’en est allé, probablement du Covid-19, contracté à l’hôpital de Périgueux.
En observant Benoît, je note qu’il faut, pour mener une telle activité, des capacités intellectuelles colossales, mais aussi une forme physique dont je n’ai jamais bénéficié.
 |
||
| Yannick Rolland, Claire Vertongen, Gisèle Chastanet | ||
Ce qui ne va pas, nous le soulignons, le surlignons même avec amertume et vindicte. Ce qui est positif, souvent, nous le passons sous silence, sans songer à exprimer la moindre gratitude. C’est pourquoi, il me semble indispensable de saluer tous les acteurs de cette manifestation intelligente : exposants, cuisiniers, serveurs, animateurs… organisateurs et sans doute en premier, un Trio d’une grande efficacité : ils ont pour noms Gisèle, Claire et Yannick. Donc merci à eux pour cet heureux moment et pour l’exemplaire intérêt de cette fête villageoise.
 |
||
| Magazine Village, Août 2020, automne : No 145 | ||
La découverte du magazine Village, d’août 2020, aura été riche d’heures de lectures délectables. La boulangère des montagnes à Eyne dans les Pyrénées-Orientales qui trône comme de juste en couverture est le récit de la belle aventure de Marion, cette ancienne ingénieure, qui exerçait à Paris. Des pages plus loin nous découvrons le plus bio village en Occitanie ouest, Lagraulet-du-Gers. Je me promets d’y faire une visite, ce n’est pas très loin d’Agen. Un maire dynamique, Nicolas Méliet, aura transformé, en douze ans, son village pour le bien général et doublé sa population ! On va dire, le voilà encore parti sur des chemins de traverses… un peu, il est vrai, mais ce paragraphe pourrait nous inspirer : « À Lagraulet, le virage écologique ne concerne pas que l’agriculture. La mairie a ainsi ouvert un Naturopôle dans une vaste maison au centre du village… À l’entrée du bâtiment, les plaques annoncent la présence périodique d’une hypnothérapeute, d’un ostéopathe, d’une sophrologue, d’une masseuse, d’une naturopathe, d’une réflexologue ou encore d’une musicothérapeute… Les cabinets sont proposés à 25 € la journée tout compris[12] ». Pour rentabiliser ce centre, il faudra passer à un taux d’occupation de 60% au lieu des 45% actuels.
Benoît Perret dans la lignée de François Couplan contribue à préserver et à valoriser un patrimoine qui est en train de se perdre à l’échelle de la planète, alors qu’il importe de le faire vivre pour le bien-être de tous. Aussi, ferons-nous nôtre la profession de foi de Benoît Perret : « Encore une fois GRATITUDE envers les plantes et Gaïa, notre mère la terre nourricière. » □
[1] Sylvie LE CALVEZ, directrice de publication du magazine ‟Village”. L’accueil et la coopération, édito du numéro 145, automne 2020, p. 6.
[2] Benoît PERRET, naturopathe, guide nature, formateur en bien-être, sur sa page Facebook : ‟L’Écho de la nature” à la date du 8 avril 2020.
[3] Hélène RENOUX, Divine abeille, revue ‟Plantes & santé” no 164, janvier 2016, p. 74.
[4] Benoît PERRET « est passionné d’écologie et de « photo nature » depuis 2003. Il a travaillé avec les élus pendant dix ans dans la gestion, la protection et la valorisation du patrimoine naturel de la Haute-Saintonge (Charente-Maritime). Il a animé plus de 150 randonnées « découverte nature » destinées au grand public et écrit deux guides de détermination sur les papillons de jour et les Orchidées sauvages de Haute-Saintonge. En 2009, Benoit Perret découvre les plantes sauvages comestibles et fait l’expérience d’une vie en autosuffisance alimentaire. Sa vision holistique de l’humain l’amène à étudier la philosophie, la sociologie et à s’intéresser à la sphère psycho-émotionnelle et au développement personnel. En 2014, il obtient le certificat de Naturopathie à la Faculté Libre de Médecines Naturelles et d’Ethnomédecine de Paris. » [Source : quatrième de couverture de l’ouvrage de Benoît Perret, Les plantes sauvages comestibles de nos jardins].
[5] Henry David THOREAU, philosophe naturaliste et poète américain (1817-1862). Son œuvre majeure : Walden ou la Vie dans les bois est une réflexion sur l’économie, la nature et la vie simple menée à l’écart de la société, écrite lors d’une retraite dans une cabane qu’il s’était construite au bord d’un lac. Son essai La Désobéissance civile, qui témoigne d’une opposition personnelle face aux autorités esclavagistes de l’époque, a inspiré des actions collectives menées par Gandhi, Martin Luther King Jr., contre la ségrégation raciale. Thoreau abhorre l’esclavage des noirs, qui démontre selon lui que le christianisme qui prévaut officiellement n’est que superstition, et que les politiciens ne sont pas motivés par des « lois élevées ». Il envisage une réforme morale de la société par la non-collaboration aux injustices des gouvernements, mais il reste presque toujours à l’écart de toute activité et organisation sociale, quelle qu’elle soit. Après la tentative ratée de John Brown pour lancer une insurrection en faveur de l’abolition, Thoreau le considère comme un sauveur et lui exprime publiquement son appui. Il s’est donc retrouvé à la fin de sa vie, à l’aube de la Guerre civile américaine, en accord avec l’opinion publique de plus en plus commune qui commençait à croire à l’abolition de l’esclavage par la force brute, et ce, sans s’impliquer pour autant davantage lui-même. Surnommé le « poète-naturaliste » par son ami William Ellery Channing, Thoreau est fasciné par les phénomènes naturels et les formes de vie, notamment la botanique, et il consigne dans son journal, qui couvre plus d’une vingtaine d’années, ses observations détaillées et les sentiments personnels qu’elles font naître en lui. Il adoptait avec les années une approche de plus en plus systématique, scientifique, et celui qui était arpenteur à ses heures a pu aussi inventer, un peu, la foresterie et l’écologie. L’amour et le respect de la nature qu’il transmet sont devenus, à mesure que son œuvre a été publiée et connue, une source d’inspiration constante pour des naturalistes amateurs et des écologistes ; tout autant que ses idées économiques et politiques intéressent des activistes sociaux et des adeptes de la simplicité volontaire. [Source : Wikipedia].
[6] François COUPLAN, né le 5 janvier 1950 à Paris, est un ethnobotaniste et écrivain français, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles, qu’il a étudiées sur les cinq continents et dont il est pionnier en Europe. Docteur ès sciences du Muséum national d’histoire naturelle de Paris, Doctor of Science en Grande-Bretagne, diplômé de l’École pratique des hautes études de Paris, François Couplan anime des stages pratiques de découverte des plantes sauvages comestibles depuis 1975 aux États-Unis, où il a vécu pendant dix ans, et depuis 1980 en Europe. Il possède une expérience approfondie de la vie au sein de la nature et de l’utilisation des plantes sauvages, tant en Europe qu’en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Afrique de l’Ouest, au Moyen-Orient, dans le Sud-Est asiatique, au Japon et dans les îles de l’Océan Pacifique où il a recueilli la tradition orale des divers peuples rencontrés. « En Europe, j’en ai répertorié quelque 1 600 dans mon ouvrage Le Régal végétal et j’estime qu’à travers la planète, leur nombre s’élève à environ 80 000. Cela est à mettre en regard de la trentaine de végétaux, tous cultivés, utilisés en moyenne par l’Occidental et au fait que, dans le monde, 29 espèces seulement représentent 90 % des denrées alimentaires végétales. » François Couplan est aussi le pionnier en Europe de la « survie douce », expérience profonde de la vie en harmonie avec la nature. Il a créé l’Institut de recherche sur les propriétés de la flore et préconise une agriculture naturelle visant à « semi-cultiver » la végétation spontanée. Il a mis en place une formation sur trois ans, le Collège pratique d’ethnobotanique (CPE), destinée aux personnes désireuses d’approfondir leurs connaissances sur les plantes et de développer une activité professionnelle dans ce domaine, tout en étant conscientes des enjeux de notre monde actuel. François Couplan continue à explorer le monde à la recherche des utilisations traditionnelles des plantes et à la rencontre des peuples qui les connaissent encore. Il s’attache à faire connaître ses découvertes par le biais de conférences, de stages, de son école et de ses nombreuses publications. Il contribue ainsi à préserver et à valoriser un patrimoine qui est en train de se perdre à l’échelle de la planète, et qu’il importe de faire vivre pour le bien-être de tous. Yves Coppens l’a encouragé à faire reconnaître ses travaux de recherche par un diplôme de l’École pratique des hautes études puis par un doctorat du Muséum national d’histoire naturelle de Paris sur l’alimentation végétale potentielle de l’homme au Paléolithique. En outre, il a participé au développement de la permaculture en France en traduisant les ouvrages de Bill Mollison et David Holmgren. François Couplan a récolté et cuisiné les plantes sauvages depuis son enfance, mais sa rencontre avec le chef cuisinier Marc Veyrat lui a donné envie d’approfondir ses recherches dans son domaine de prédilection et d’en explorer la dimension gourmande. Marc Veyrat dit, avoir été influencé par la transmission de savoir de François Couplan — qu’il considère comme « le plus grand botaniste au monde » — pour améliorer et innover dans sa cuisine à base de plantes sauvages. Ils ont écrit ensemble plusieurs livres de « botanique comestible », en particulier Herbier gourmand. François Couplan collabore dans plusieurs pays avec des chefs cuisiniers étoilés pour la cuisine à base de plantes sauvages et la réhabilitation des saveurs oubliées. François Couplan est l’auteur de nombreux ouvrages sur les plantes comestibles, la nature et la santé, chez plusieurs éditeurs, ainsi que de plusieurs centaines d’articles sur ces sujets parus dans divers magazines. Certains de ses livres sont des références, telle l’Encyclopédie des plantes sauvages comestibles de l’Europe, en trois volumes, et The Encyclopedia of Edible Plants of North America, qui font le tour de la question sur ces deux continents. [Source : Wikipedia].
[7] Ralph Waldo EMERSON (1803-1882) est un essayiste, philosophe et poète américain, chef de file du mouvement trancendantaliste américain du début du XIXe siècle.
[8] François COUPLAN, Préface de l’ouvrage de Benoît Perret, Les plantes sauvages comestibles de nos jardins, Éditions Esprit Sauvage, Montguyon, 2ème édition, 2019, p. 7.
[9] Sébastien BRAS, chef du restaurant Le Suquet, à Laguiole (Aveyron), a pris depuis 2009 la suite de son père Michel. Il déclare : « Cuisiner, c’est se livrer soi-même. », il livre en tout cas sa passion folle pour son terroir et ses richesses. Depuis 2009, c’est le nouveau roi du plateau. Le fils de l’illustre Michel Bras, a réussi une prouesse rare : maintenir les trois étoiles glanées par son père. Fort de ses racines aubraciennes, ce passionné propose une cuisine du vivant, sans cesse réinventée, où l’herbe sauvage est l’ingrédient de choix. Lorsqu’on pense à la gastronomie aveyronnaise, on imagine l’aligot et la saucisse du pays, vision un peu réductrice. Il y a suffisamment de belles tables, qui proposent une cuisine contemporaine. Au marché de Rodez, Sébastien Bras croise de nombreux chefs qui ont tous grandi avec les mêmes racines paysannes. Ils ont su faire évoluer, ensemble, la gastronomie aveyronnaise qui n’est pas déconnectée de leurs racines. « Je suis né dans l’Aubrac. Et l’Aubrac, c’est encore différent de l’Aveyron ! J’aime faire des clins d’œil à un village, un paysage, dans la composition des assiettes. Par exemple, je vais utiliser des olives noires pour évoquer un mur en pierres sèches. Ce sont des références poétiques, artistiques, à ce territoire qui nous inspire. » Sébastien Bras réinvente sa cuisine chaque jour. Une cuisine de l’instant, fruit d’une ébullition permanente autant que de réflexions créatives adjacentes, qui se nourrit d’une image, d’un souvenir de voyage, d’une balade au jardin de Lagardelle, d’une rencontre avec un passionné, ou tout simplement d’un paysage de l’Aubrac. [Source https://www.chefsdoc.fr/rencontre-sebastien-bras/]
[10] La Cistre ou Fenouil des Alpes (Meum athamanticum). Famille des Apiacées (Ombellifères). Cette plante, appelée « Cistre » localement, est l’emblème des prés de fauche du Mézenc. Son habitat : prairies et pelouses fraîches d’altitude, au-dessus de 700 m. Elle est typique de la flore des prairies alpines, on la trouve dans le massif central, les Pyrénées, les Alpes. Utilisations culinaires : jeunes pousses en salades, feuilles hachées pour aromatiser soupes, légumes, sauces, autres utilisations comme le fenouil. C’est l’emblème de Michel Bras à Laguiole. Ses propriétés médicinales : stimulant de la digestion.
[11] Pierre Valentin MARCHESSEAU (1911-1994), d’origine charentaise, professeur d’éducation physique, licencié en philosophie, international de rugby, haltérophile de bon niveau, artiste peintre à ses heures, tel est le profil de cet homme d’exception. Il fit tout d’abord un parcours académique des plus classiques, mais particulièrement complet : doctorat en philosophie, études de droit, médecine. Il fut ensuite au contact des grands naturopathes et humanistes de l’époque, tout d’abord aux USA : Lutz, Mac-Fadden, Krishnamurti, puis en France : Carton, Mono, Dr Georges Rouhet, Edmond Desbonnet, ce qui lui permit de continuer ses recherches et de mettre au point sa synthèse : la naturopathie orthodoxe. Cette synthèse consiste en la réunion de toutes les techniques de ces illustres prédécesseurs, au service de la restauration de la force vitale du patient, ce qui permet à son corps de rétablir naturellement la santé ; c’est ce que l’on appelle l’auto-guérison. Comme souvent, ce fut une épreuve dans le milieu familial qui le força à mettre ses connaissances en pratique : son beau-fils condamné par la médecine (leucémie) qu’il guérit en 2 ans. Le bouche à oreille lui amena ensuite de nombreux patients. Il se sentit obligé de sillonner la France pour soigner et répandre la bonne parole puis, plus tard, le monde entier dans le cadre de la Fédération Mondiale des Naturopathes (qui regroupait 46 pays en 1995). Il créa la première Faculté libre de Naturopathie en France en 1935, puis il dispensa ensuite généreusement la naturopathie sans aucune restriction par ses conseils, sa méthode et ses ouvrages. Il ne vivra que pour elle pendant 60 ans. Il est considéré comme ayant formé la quasi-totalité des chefs d’école actuels de la naturopathie française. [Source : https://www.marchesseau.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=78.]
[12] Axel PUIG, Magazine VILLAGE n° 145 (automne 2020), p. 54-55.
14 au 27 septembre 2020
Saint-Pierre-de-Frugie
Renaissance d’un village éco-citoyen
|
Texte dédié à Monsieur Gilbert Chabaud, architecte de ce projet de renaissance d’un village perdu du nord de la Dordogne porteur de valeurs exemplaires sur les plans de l’écologie, de la vie saine, culturelle et humaniste |
||
|
|
Nous ne sommes ni séparés ni supérieurs à la nature.
Nous faisons partie de la nature et la détruire
revient à nous détruire nous-mêmes.
Tamara Dean, photographe, Kaisen no 39
La nature source de spiritualité ?
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,
mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.
Sénèque
Nous étions aux confins de la Dordogne et de la Haute-Vienne ; topographie et paysages le suggèrent fortement par la densité forestière et encore par l’hygrométrie, qui, malgré les sécheresses liées au réchauffement climatique, accorde quelques privilèges au Périgord Vert, bénéficiant de pluies plus abondantes que le reste du département, soit environ 1000 mm annuellement ! Prairies verdoyantes, forêts denses, riches en feuillus et conifères, étangs nombreux, dans un contexte très vallonné, préfigurent le limousin.
 |
||
| Le charmant village de Saint-Pierre-de-Frugie (Dordogne) | ||
Le nord du département, fut mon secteur professionnel d’activité lors de mon ultime période en inspection du travail, entre 1997 et 2000. N’étant jamais venu dans ce village signifie qu’il n’y avait probablement rien à voir, car j’étais un infatigable explorateur de ce vaste empire victime de la désertification industrielle, après l’effondrement de l’industrie de la chaussure, dont le proche village de Mialet, fut un des fiefs, avec le nontronnais, en particulier sous la direction de Paul Marcoux, l’époux que je n’ai pas connu de notre amie disparue cette année, Madeleine. Un peu plus bas, en dessous de La Coquille, à Saint-Jory-de-Chalais repose nos cousins Andrée et Henri Girardeau, à proximité de l’Institut Éducatif Paul Wilheim, dans lequel, par contre, je m’étais rendu.
Voici un 11 septembre qui n’aura eu aucune des amertumes de quelques autres qui le précédèrent. Grand soleil et chaleur. Nous roulons vers une des premières communes bios de France, première en Aquitaine, un joyau moins célébré que bien des lieux renommés de notre Périgord. Partis de bonne heure, contournant Périgueux et rejoignant la route de Limoges par Bassilac, Escoire et Antonne-et-Trigonant, nous atterrissions, Jean-Michel et moi, à Saint-Pierre-de-Frugie par une route étroite dites « Le Puy Sud » au-delà de La Coquille, nous menant au pied du château de Frugie, et en face, de la petite chapelle funéraire érigée par Dame Labrousse, autrefois propriétaire du château, en mémoire de son mari, disparu en 1837. La tempête de 1999 ayant eu raison de ce qu’il restait de l’édifice, elle a été magnifiquement restaurée, à l’identique, faisant partie du précieux patrimoine de la commune qui lui aussi a été restauré, tel le pont du Moulin de Breuil, un petit joyau médiéval sur la ‟La Valouze”. Restauré également, le ‟Travail à ferrer” les animaux.
 |
 |
|
| La chapelle restaurée à l’identique au pied du château de Frugie | ||
Outre le château de Frugie, il faut mentionner le repaire noble de Viellecour avec château-fort et la chartreuse de Montcigoux, du XIIe siècle, aux limites de la Haute-Vienne. Une grange rénovée de ce domaine permet, dans d’excellentes conditions acoustiques, la tenue de plusieurs concerts (en principe cinq) annuels, de haut niveau.
 |
 |
|
| Le Potager de Frugie, maraîchage bio | Ophélie et Frédérik | |
L’étang, sous le ‟Jardin partagé” de la commune – ce que nous ignorions encore – ajoute beaucoup au charme des lieux. Ce 11 septembre, tout était accueillant, charmeur, ressourçant si ce n’est l’arrière-plan de l’étang fait d’une lisière d’arbres morts et secs, alors que les carpes s’employaient à sauter hors de l’eau, replongeant tout aussitôt, générant toute une série de cercles concentriques. Le château était peu visible. Apercevant une terre cultivée, je fis immédiatement le tour de l’étang, avec sur son parcours des toilettes sèches, ce qui est encore regrettablement peu commun. Deux hommes et une femme s’affairaient derrière l’enseigne de bois gravé et peinte, « Le Jardin de Frugie ». J’eu l’opportunité de causer avec Frédérik et Ophélie, dont le documentaire « Des Racines et des ailes – Passion patrimoine : Le Périgord au coeur » avait évoqué l’installation au pays. Nous les y voyions dans leur maison qu’ils restaurent et avec leur fils, qui s’initie, hors du temps scolaire, en leur compagnie, à la permaculture, sur leur micro-ferme maraîchère. Le couple fournit deux des lieux essentiels du village, l’épicerie et le restaurant, tout en vendant sur place leur production, deux jours par semaine. Ophélie cultive son rêve, indispensable, celui des plantes aromatiques et médicinales.
 |
 |
|
| Un village fleuri d’un grand charme | ||
Un moment après, nous garions la voiture à l’ombre de l’église romane du XIIe et XIIIe siècle, remaniée au XVIIe. La reconstruction du clocher et de la façade se fit en 1898. Elle fut la propriété de l’Abbaye de Boschaud (commune de Villars) que nous vîmes plus tard dans l’après-midi. L’opulente bordure d’hortensia qui la longe sous un ombrage appréciable par cette fin d’été cuisante, prouve assez une hygrométrie importante en ces lieux. Un vieux village de charme, admirablement restauré, où les Gauras et autre Pérovskias enchantent le parcours.
Nous fîmes notre marche à travers le village, l’épicerie ‟Saveur Nature” n’était pas encore ouverte. Anecdote amusante : lors de ma recherche pour connaître les jours et heures d’ouverture de l’épicerie ‟Saveur Nature”, que j’avais confondu, pour être apparue en tête de la page Internet, avec une épicerie bio, portant le nom de ‟Nature & Saveur” sise en Alsace, où officie un joyeux personnage qui proposait des huiles d’olive grands crus et qui m’invitait à le rencontrer sur le marché d’Herlisheim, rue de l’église. Saint-Pierre pour être au nord de la Dordogne, n’est tout de même pas situé en de si fraîches contrées. Nos échanges sur Messenger furent assez savoureux avant que je réalise ma méprise, au demeurant pleine de drôlerie et de sympathie !!!
 |
 |
|
| L’ancienne école devenu gîtes | L’épicerie bio à proximité des gîtes | |
L’ancienne école touchant l’épicerie a été transformée en gîtes pour les randonneurs comme pour les stagiaires de l’Éco-centre. Le village a balisé des chemins pour ce sport tranquille, champêtre, mais aussi selon le parcours choisi, potentiellement d’endurance.
 |
 |
 |
||
| L’enseigne du restaurant Saveurs & Valeurs | La carte du restaurant |
Christine de la Ferme à Philou paysan boulanger et brasseur |
||
 |
 |
|
| Yann, le chef cuisinier du restaurant | Les salles du restaurant | |
Le café-restaurant ‟Saveurs et valeurs” était ouvert. Yann, la bonne humeur incarnée, officiait entre cuisine et salle où un couple prenait un petit déjeuner bio, reconstituant. Le chef de cuisine me confirmait notre réservation pour midi et me remettait la carte du restaurant, ses tarifs pour les chambres d’hôtes et le petit-déjeuner. Arrive alors Christine, l’épouse du paysan-boulanger, tout sourire qui apporte de superbes pains moulés pour les tables de la journée. J’eus l’opportunité de faire une photo de la boulangère, moi qui n’ai pas mangé de pain pendant trente années, pour des raisons digestives, et qui depuis deux ans achète chaque semaine aux paysans-boulangers de notre secteur des pains délicieux, digestes, cuits au levain : à Laura et Jérémie de l’Éguillac de l’Auche, à David et Marianne de Sainte-Alvère et parfois à Manon et Clément de Beleymas. Des Racines et des ailes du mercredi 23 septembre dernier, ayant pour intitulé Un balcon sur l’Auvergne, nous fit découvrir un jeune couple de néo-ruraux installés dans le joli village de Bienne. La passion de Thibault, cet architecte reconverti en boulanger, avec son regard d’enfant émerveillé nous fait comprendre ce qu’est la juste adéquation entre vie professionnelle, vie personnelle et sociale. Comme nous le vîmes émus, dans le précédent épisode de cette passionnante émission, avec le couple Yann et Delphine et leurs trois fils, Achille, Léon et Gaston. Un vrai bonheur à observer : la ballade à bicyclette à Saint-Pierre-de-Frugie et d’autre part le moulin restauré qui produit les farines du boulanger qui récoltera en 2021 ses premiers grains de blés anciens. Le paysan-boulanger avec son épouse Juliette ont découvert la voie royale, l’approche par des gestes simples, de l’essentiel.
 |
 |
|
| L’École Montessori de Saint-Pierre-de-Frugie | ||
Face au restaurant, une jolie pancarte intitulée ‟La Tour rose”, c’est l’entrée de l’école Montessori qui a rendu son autonomie au village. Elle accueille une vingtaine d’enfants. Pour être autonome, il faut au minimum quatre choses : un boulanger, une épicerie, un café et une école ! Nous nous fîmes discrets et poursuivirent notre traversée du village où nous vîmes de belles demeures jusqu’à atteindre la route qui va de La Coquille à Bussière-Galant et Châlus, en Haute-Vienne. Il semble me souvenir que sur la droite, à la sortie est du village devrait s’élever prochainement un ‟projet passerelle” de logements communaux permettant à de futurs arrivants, d’être logés pour un an, avant de s’établir sur la commune de manière autonome.
 |
 |
 |
||
| Aux confins de la Dordogne et de la Haute-Vienne | Deux habitats écologiques | |||
Notre retour par cette route relativement fréquentée nous permit d’admirer le paysage, les forêts denses d’un vert intense, le nouveau cimetière avant de remonter dans le cœur du village, où des bâtisses de type écologique nous firent lever les yeux, puis à droite l’ancien cimetière et nous nous retrouvions devant l’ancienne école. Un jeune homme assis en tailleur, figé, me fit dire : « Je n’avais pas remarqué cette statue tout à l’heure ! » Amusée la statue donna un léger signe de vie ; surpris, je lui demandais : « Êtes-vous artiste peintre ? », « Oui, me répondit-il, mais en ce moment, je ne dessine pas, je lis ! ». Comme l’épicerie était ouverte, j’attendis, masqué, mon tour et je fis mes achats : fromages de chèvres, raisins superbes et peu sucrés, de petites poires savoureuses à un peu plus de 2 € le kilo (un prix très rare en bio), des terrines de poulet, du sel fin rose de l’Himalaya, une crème dessert au café… La charmante Léa, mettait au frais ce qui le demandait et j’emportais jusqu’à la voiture ce qui pouvait supporter une température estivale.
 |
 |
|
| L’épicerie bio Saveur Nature, boutique de producteurs | ||
 |
||
| Léa, l’épicière de Saint-Pierre-de-Frugie | ||
Un couple charmant, qui effectuait des travaux à l’entrée de leur belle demeure, nous invita à rendre visite au ‟Jardin partagé”, puis de poursuivre la route jusqu’à l’Éco-Centre. Cette idée de jardin partagé en libre-service pour les habitants comme pour les visiteurs et assez étonnante et particulièrement conviviale. Des pancartes précisent les objectifs, les engagements communaux, les recommandations. C’est toute une série de petits îlots mettant à profit toutes les pratiques d’une culture écologique, qui invite non seulement au partage citoyen, mais aussi se veut didactique. Une grande place circulaire devant la salle des fêtes, d’une belle architecture, précède un parking pouvant accueillir beaucoup de participants ou de visiteurs.
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
| L’extraordinaire Jardin Partagé de Saint-Pierre-de-Frugie | ||
En contrebas, en descendant vers l’étang, on découvre une statue de feuillardier, un noble métier, en voie de disparition, réalisé par l’artiste Roland Manin. Aux heures enchanteresses du jardin, Louis Terrasson, de Saint Sulpice d’Excideuil, qui était un véritable orfèvre en la matière, réputé et recherché pour les fêtes populaires, les félibrées… m’avait gratifié de superbes réalisations en châtaigner. La charrette, les copeaux et la statue de métal sont un hommage à cet admirable travail artisanal et artistique. On y voit encore toute une série de nichoirs.
 |
 |
|
| Un endroit pour déjeuner, méditer, écrire ou bavarder | Le Feuillardier de l’artiste Roland Manin | |
Alors que nous discutions devant une des tables qui longent le chemin de randonnée, un cantonnier nouvellement retraité (autre beau métier qu’exerçait mon grand-père) s’approche de nous, ouvre la conversation et ne cache pas son admiration pour les réalisations auxquelles il a participé, avec conviction. Il est né sur cette commune et il est fier et heureux du retour florissant des temps anciens, préservant l’écosystème, permettant de vivre en autonomie et d’échapper à la désertification environnante.
 |
||
| Les nichoirs | ||
Jolie route étroite, où l’on aperçoit une adorable maison de garde-barrière pour se rendre à l’Éco-Centre Périgord-Limousin, ouvert en 2001. Nous fûmes accueillis, mais ce n’était pas un jour prévu pour les visites. Une vidéo sur le web autorise d’observer mieux encore l’intérêt de cette structure de 900 m2, présentant toutes les solutions alternatives de l’habitat écologique : matériaux locaux et naturels, accordant une prépondérance au végétal comme la paille (isolant), bio-climatisation par gestion des énergies naturelles. L’éclairage intégré au bâtiment tient compte des variations saisonnières, il est automatisé sur la lumière du jour. La concentration du photovoltaïque et des panneaux solaires thermiques (pour l’eau chaude) sur une seule pente de la toiture, limite les interventions et autorise à végétaliser une partie des surfaces. Le lieu est donc à la fois expérimental et sert de démonstration de tout ce qu’il propose. La pièce centrale est une bibliothèque complète des ressources de l’habitat écologique, des solutions alternatives et des énergies renouvelables, matériaux sains, toilettes sèches… Le lieu sert à l’apprentissage, à la formation, à l’expérimentation, à l’acquisition de compétences. Des salles peuvent être louées pour des séminaires, conférences ou formations.
 |
||
| L’Éco-Centre de Saint-Pierre-de-Frugie | ||
Nous ne vîmes pas non plus l’Éco-hameau situé à proximité, il est réservé aux résidents et fonctionne bien. Il ne se visite que sur demande.
Retour sur le village. Comme l’épicerie ‟Saveur Nature” reste ouverte jusqu’à 13 h 00 et que prévoyant, je m’étais équipé d’une glacière, je récupère mes achats périssables avant que nous nous dirigions vers le restaurant.
Nous voici parmi les premiers installés, tête à l’ombre, à la terrasse du restaurant du village. Terrasse qui sera vite entièrement occupée. Il reste un potentiel de 30 couverts en salle, quelques tables furent sollicitées, une avec quatre motards belge ! Les restaurateurs sont originaires d’une petite ville, distante de 60 kilomètres de Bruxelles. Delphine exerçait la profession d’ostéopathe et Yann était conseiller en environnement. Changement radical s’il en est ! Comme l’explique Yann, sa mère était un cordon-bleu et sa maîtrise de la cuisine savoureuse l’inspire, depuis toujours. Ayant un foie qui me torture tout en me protégeant d’abus inconsidérés, je me classe volontiers parmi les gourmets, mangeant relativement peu, mais appréciant autant la sobriété que l’excellence. Nous étions au bon endroit comme à ‟La Cour des princes” à Eymet, au ‟Saint-Martial” à Saint-Martial de Nabirat… tables subtiles où je fis de parcimonieux passages. Mais avant même que ne débute le service, Delphine traverse la rue et apporte sur un chariot, leur déjeuner bio et sain aux enfants de l’école !
Nous avions faim et nous optons pour le menu du jour à moins de 14 € ! En entrée, nous fut servi un cake salé, à la feta, olives et chorizo. Le plat du jour était un absolu régal : dos de lieu noir de la poissonnerie Ribet-Beyrand de limoges, avec son crumble de riz, sauce diable, accompagné de tagliatelles et légumes bios confits. Le dessert dans sa grande simplicité était savoureux : tarte moelleuse aux prunes. Le cuisinier est en recherche de fruits de saison (pommes, poires et fraises) en bio. Nous ne prîmes ni vins, ni bières bios ou en biodynamie, mais un délicieux jus de pomme, le mien était au cassis. Yann a déniché pour sa plus grande satisfaction des whiskies, du rhum et du gin bios, et en local des apéritifs à la poire ou à la châtaigne !
 |
 |
|
| La terrasse du restaurant | Le fabuleux dos de Lieu noir sauce diable | |
Nous étions sur le chemin du retour pleinement heureux de notre séjour en ce paradis périgourdin nettement moins connu et fréquenté que les villages de la Vallée de la Dordogne ou du Périgord pourpre qui tous participent, malgré leurs indéniables beautés, leur intérêt indiscutable, au cannibalisme consumériste. On s’y divertit fort agréablement, mais y découvrons-nous les clefs d’une vie pleine de sens ? Au coin de la mairie, Jean-Michel remarque un magnifique bouquet de tiges grises et de fleurs bleues odorantes ; je pense à une touffe de Pérovskia. Soulevant les branches, il découvre une ardoise qui nous le confirme. Une voiture venait de se garer devant la mairie et je crus reconnaître monsieur Gilbert Chabaud, d’après mon souvenir de l’émission Des racines et des ailes, le maire et inspirateur de ce miracle rural. Nous nous saluons et nous échangeons en toute sympathie quelques mots sur ce que nous venions de découvrir émerveillés.
* * *
Le 5 octobre 2016, Charlie hebdo publiait un encart savoureux sur ce village qui faisait parler de lui : « En 2007, le village de Saint-Pierre-de-Frugie en Dordogne paraît crever sur le bord de la route, comme 10 000 autres en France… les 400 derniers habitants attendent le passage de la faux. Mais en 2008, un certain Gilbert Chabaud devient maire du mouroir et avec son assistante, Véronique Friconnet se mettent à délirer grave. » Interdiction des pesticides, fauchage tardif, plantation de haies favorisant l’éco système, permaculture, jardin partagé, village et patrimoine restaurés et fleuris, gîte écologique attirant randonneurs sur neuf sentiers balisés. Le bistro ouvre à nouveau avec une table de choix et ne désemplit plus. Une épicerie bio ouvre ses portes avec les productions de tout ce petit monde affairé qui permet de vivre sainement. L’école primaire Montessori accueille une vingtaine d’enfants et même si le collège Montessori est fermé provisoirement en raison de la pandémie, l’autonomie sera bientôt à nouveau totale jusqu’aux études universitaires. Bref, ce que Charlie Hebdo qualifie de « trou du cul du monde » donne le vertige à beaucoup, après la diffusion sur France 3, début septembre 2020. Les médias dans ce cas me semblent utiles, responsables, et même initiateurs. Mais lorsque leur impact sera un peu oublié, demeurera un pays perdu, au charme fou, plein de joliesses, possédant un esprit coopératif et fraternel où il fera bon vivre même lorsque la civilisation de l’imbécillité érigée en dogme aura fait faillite, faute de n’être plus l’hideux miroir aux alouettes qu’elle propose encore malgré l’évidence de sa déchéance… et c’est pour bientôt, pour demain.
L’authenticité des productions est la règle maîtresse de l’activité de ces nouveaux fermiers. La ferme de Philou, paysan-boulanger et brasseur, s’inscrit comme un des socles garantissant l’autonomie du village. L’épouse de Philippe, Christine, tellement dynamique, assure les tournées en campagne (du bon pain et une bise pour les anciens éloignés du village), elle fournit bien entendu, le restaurant et l’épicerie.
Ailleurs, le couple Mathilde et Frédéric soignent leurs brebis et s’emploient à parfaire leurs fromages qui, prenant de la bouteille dans leur cave, développent une succulence idéale.
Il faut rencontrer Viviana et Fabrice au ‟Mas d’Arneix”, à Saint-Priest-Les-Fougères (un bien joli nom !) qui soignent leurs volailles avec amour et produisent entre autres des terrines de poulet incomparables. Et tous les autres encore, qu’il faut découvrir au fil des ballades.
C’est un peu comme si nous visitions une sorte de grande entreprise fonctionnant dans l’économie d’échanges et de services. Dans bien des cas, mais pas uniquement, il s’agit de réinventer le métier noble de paysan. Je l’ai toujours dit et écrit, même au temps de mes grands-parents qui vivaient très modestement, le paysan est un prince pauvre, en son royaume. Venant d’universités célèbres des voix autorisées proclament : « Nous devons attirer des jeunes bien formés des milieux ruraux ou citadins, des jeunes ayant une capacité d’apprendre l’agriculture, qu’ils soient issus du milieu ou non… Des jeunes dont l’idéalisme et l’intérêt pour la nature peuvent apporter une véritable innovation dans la vie rurale et l’activité agricole… » Il y faut des fonctions de production agroalimentaire, culturelle, patrimoniale et sociale, artisanale et résidentielle, le tout dans l’écrin de conditions environnementales adaptées, saines et évolutives.
C’est Philippe Desbrosses un précurseur éminent, qui le propose dans ses conférences et ses ouvrages, dont Manifeste pour un retour à la terre. Le chemin passe par des pratiques respectueuses de l’environnement, en valorisant les petites fermes, le savoir-faire, sans oublier les nouvelles technologies. Il faut s’employer à la sauvegarde des semences, des races locales, au « maintien des savoir-faire traditionnels », tout en assurant la promotion des produits du terroir qui « constituent la richesse et l’âme des régions, mais surtout la sécurité et la souveraineté alimentaire. »
François Plassard, dans La vie rurale, enjeu écologique et de société (Albin Michel, 2003) montre l’amplification qui ne cesse de croître de cet intérêt pour ces nouvelles façons de vivre, de consommer, d’échanger : développement spectaculaire des AMAP, des Cagettes, du SEL, des Jardins partagés, des Jardins de Cocagne… l’inventivité est désormais permanente.
Sans aucun doute, et c’est ce qui interpelle le visiteur, le Saint-Pierre-de-Frugie d’aujourd’hui est la mise en pratique et la réussite de ces paramètres nécessaires à une véritable renaissance vertueuse, un peu comme les villages d’autrefois, vivant en économie circulaire n’ayant pas eut vent des sirènes des zones commerciales encerclant les villes. Ici, on peut créer en symbiose une activité professionnelle rémunératrice, vivre en famille, participer à un collectif coopératif et fraternel qui génère du bien-être pour tous.

| Gilbert Chabaud, maire de Saint-Pierre-de-Frugie, depuis 2008 |
Gilbert Chabaud a pris la cause environnementale à bras-le-corps et point par point, il a restauré l’image idyllique du village d’autrefois qu’un modernisme intempestif avait quelque peu usé et vidé de sa population jeune. Il restait moins de 400 habitants vieillissants lorsqu’il prit ses fonctions de maire, en 2008. Il y fallait aussi, me semble-t-il, la vision pragmatique d’un ex chef d’entreprise. Il propose donc un projet élaboré sur des critères écologiques évalués, avec réalisme, bénéficiant d’un important tissu de producteurs locaux sur 10/15 kilomètres alentour. Lui et le Conseil municipal avancent en large concertation, étapes par étapes vers l’objectif final : redynamiser une région autrefois défavorisée, cependant riche de ressources patrimoniales comme de ressources à développer, un lieu paisible et agréable pour un bien vivre ensemble. La commune aura eu le privilège d’accueillir, sur quelques années, une cinquantaine de jeunes couples ! L’ultime volet d’autonomie écologique est en cours de réalisation, il concerne l’indépendance énergétique du village en priorisant les parties techniques et collectives. Une activité nouvelle en alimente une autre, créant une synergie constructive.
Gilbert Chabaud énonce, afin de garantir le succès d’un projet courageux et profondément innovateur, trois critères indispensables pour y parvenir : CONVICTION, DÉTERMINATION, NE JAMAIS VARIER (carapace indispensable contre les inévitables critiques). Voilà un maire qui m’inspire l’image du patriarche, qui traditionnellement, laissait aux siens un plus grand bien-être que celui qui l’avait accompagné au long de sa propre trajectoire. Ici, le rôle protecteur et incitatif est étendu à toute une commune, à de nombreux foyers, et même à toute une région, (communauté de communes désertifiées), où son rôle de conseiller environnemental reçoit, et pour cause, une écoute attentive, devant le simple choix : renaître ou disparaître ! N’est-ce pas-là un pari audacieux et exaltant ? Une si pertinente gestion mérite notre admiration, elle mérite aussi notre gratitude, car il est désormais démontré que la pratique de cet écosystème vertueux n’est pas une utopie hasardeuse, mais une opportunité historique de redynamisation d’une commune, de sa région, de sauvegarde de notre patrimoine, et le retour à des vies épanouies. Il n’existe pas de société prospère sans une authentique culture. Sans vouloir ériger un quelconque élitisme, c’est ouvrir à tous les portes de l’excellence et du plus grand bien-être. □

