JOURNAL 2019 : Chant des jours [Décembre 2019]
« L’écriture n’est pas un but en soi, mais une façon de chercher et de dire le sens même de la vie individuelle ou collective. »
Francis COMBES, Préface de Ce que signifie la vie pour moi de Jack LONDON.
Journal 2019 : Chant des jours [Décembre 2019]
« Plaindre l’homme, c’est l’estimer plus qu’il ne vaut ; l’accabler, c’est l’estimer moins. »
José CASAJUANA dit ANARIN, Pensées, Nouvelles Éditions Debresse, 1970.
« L’or est le souverain des souverains. »
Antoine de RIVAROL (1753-1801)
« Je suis riche des biens dont je sais me passer. »
Louis VIGÉE ( (1753-1820), Épître à Ducis
28 & 29 décembre 2019
L’art de la simplicité
En cette saison, le recul des marchés de manière globale, et des étals bios, plus spécifiquement, nécessite des visites plus fréquentes à La Vie Claire. Le 24 décembre dernier, celui de Manzac-sur-Vern, de fin d’après-midi, fut un fiasco total. Je fus l’unique client de Josette, moi qui ne mange pour ainsi dire pas de viande ! Tristement, elle a balayé son iphone d’un revers de main, sa chute sur la castine lui fut fatale… 1000 € partis en un clin d’œil. Joyeux Noël ! Et je crois bien que j’en ai éprouvé plus de tristesse qu’elle encore, ce qui a déclenché sans doute cette crise de foie inattendue, le 24 au soir !
Les brumes avaient recouvert tout le paysage de la vallée de l’Isle, ce matin, vers 9 h 00. En quittant le marché de Neuvic – lui aussi un peu désert, Alaric n’y tenant pas son habituel stand bio, mais où je pris des huîtres, de l’huile et des cerneaux de noix à Marie-Christine –, peu à peu en me dirigeant sur Mussidan, un ciel limpide se fit jour, jusqu’à s’imposer souverainement.
De Mussidan où n’étaient présents aucun des deux Clément (pain bio au levain, légumes et plantes médicinales), je m’en revins avec un pain au lin, non bio, et une botte de cresson, faisant halte, sur la route du retour, à Saint-Léon-sur-l’Isle, chez Jean-François où je vis Fanny et Jérémy.
Vendredi soir, en explorant la plus haute étagère de la bibliothèque du bureau, sur laquelle trois rangées de bouquins sommeillent, je mis, enfin, la main sur l’ouvrage de Dominique Loreau, l’Art de la simplicité, et me régalais à nouveau de ses toutes premières pages. Tout un art de vivre sobrement et de jouir d’une simplicité qui signifie LIBERTÉ ! La couverture parle déjà du contenu de ce livre qui résulte de la recherche personnelle de son auteure. Aujourd’hui, j’ai de nouveau recherché l’ouvrage de Thich Nhat Hanh, La Paix en soi, la paix en marche (qui avait été un de mes choix de la fin 2007, au Club Nouvelles Clés). Finalement, je l’ai trouvé en 3ème rangée, au plus haut sommet de la bibliothèque non loin de l’endroit où j’ai récupéré le livre de Dominique Loreau ! D’ailleurs ces deux ouvrages étaient en bonne compagnie, comme par exemple La Voie (Pour l’avenir de l’humanité) d’Edgar Morin.
 |
Dans le chapitre « De la mondialisation à la globalisation », il écrit : « Tout cela contribue à ce que la globalisation développe une crise planétaire aux multiples visages. Comme l’a indiqué Mohamed Arkoun, « le collapsus de l’Union soviétique a été un Tchernobyl socio-politique ». Il a éliminé du globe, pour un temps, la pieuvre totalitaire. Mais il en a fait apparaître deux autres : la pieuvre du capitalisme financier, et celle d’un fanatisme ethno-religieux[1]. » Dans le chapitre suivant, « La crise planétaire », il cite l’ouvrage de Patrick Artus et de Marie-Paule Virard, Globalisation : le pire est à venir (livre écrit après la grande crise de septembre 2008). La présentation de l’ouvrage s’avère prophétique : « Le pire est à venir de la conjonction de cinq caractéristiques majeures de globalisation : une machine inégalitaire qui mine les tissus sociaux et attise les tensions protectrices ; un chaudron qui brûle les ressources rares, encourage les politiques d’accaparement et accélère le réchauffement de la planète ; une machine à inonder le monde de liquidités et à encourager l’irresponsabilité bancaire ; un casino où s’expriment tous les excès du capitalisme financier ; une centrifugeuse qui peut faire exploser l’Europe[2]. »
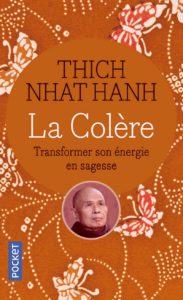 |
Lors de sa dernière venue, début décembre, Olivier, le paysagiste qui gère le Jardin des Rolphies, me parla avec enthousiasme d’un ouvrage qu’il avait d’ailleurs avec lui, La Colère. Transformer son énergie en sagesse, du maître Zen, Thich Nhat Hanh. Le lendemain même, je faisais l’acquisition de ce livre de poche à Périgueux. S’en suivit une promenade peu usuelle pour moi, sur le marché de Noël en compagnie de Marie-Annick sous la caresse d’un soleil généreux. Si cette bible expose les règles du bien-vivre en harmonie avec soi-même et les autres en suivant maints principes que j’ai découverts au cours du temps, je suis toujours frileux sur ces recommandations qui dans l’Église mormone étaient des commandements. Principes alimentaires que l’on retrouve dans nombre de sectes avec même des extensions plus drastiques encore que La parole de sagesse de la LDS Church (pas d’alcool, de thé, de café, de cigarette). Un commandement devenu désuet et cependant me semble-t-il des plus important était de ne consommer de la viande que par temps de grand froid, ce qui sous nos climats nous condamne quasiment au végétarisme. Les recommandations de Thich Nhat Hanh sont plus explicites, détaillées et certainement mieux inspirées par des critères écologiques, psychologiques, spirituels… Les conditions de production des œufs, d’élevage des volailles sont trop souvent la résultante de violences faites aux animaux, violence qu’ensuite nous absorbons. Dans cette chaîne alimentaire nous transportons de mauvaises ondes, ce qui est vrai aussi pour la nourriture issue de la culture intensive. Ici les conseils sont nettement plus vastes et conscients de notre environnement. La modération de la quantité absorbée, la mastication sont encore des critères de vie consciente, applicables à tout ce que nous faisons. Le principe de la compassion qui annihile la colère est plus délicat à appliquer dans un système européen hyper concurrentiel et d’individualisme forcené, ce qui est sans doute moins vérifiable chez la plupart des asiatiques. Ainsi « aider et non punir » s’avère être presque révolutionnaire dans nos comportements où l’égoïsme, l’avidité, la jalousie jouent des rôles prépondérants, excluant la communication fluide et sincère. Il y faut deux bonnes volontés, sans arrière-pensées ou volonté de conserver des prérogatives qui même seraient névrotiques : peur, besoin excessif de sécurité… « Celui qui ne sait pas maîtriser sa propre souffrance la communique à tous ceux qui l’entourent. C’est dans la nature des choses. C’est pourquoi nous devons apprendre à gérer notre mal-être, afin de cesser de le répandre[3]. » Et encore cette réflexion où l’on rejoint Krishnamurti que je citais[4] dans mon texte précédent : « En prenant soin de vous-même, vous veillez sur l’être aimé. L’amour de soi est la base de l’aptitude à apprécier autrui… La capacité d’aimer autrui dépend entièrement de la capacité de s’aimer soi-même, de prendre soin de soi-même[5]. »
Nous relirons les chapitres où il est question de « prendre soin de l’enfant en soi ». De nombreux chapitres de ce manuel invitant à une vie quasi monastique bouddhiste restent encore à lire, tout en précisant que toute vie monacale me restera étrangère !
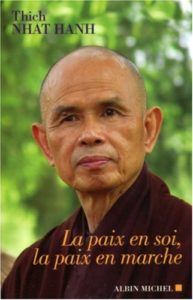 |
Le premier ouvrage de ce sage vietnamien dont j’avais fait l’acquisition en novembre 2007, traite d’un autre sujet, cependant en concordance avec celui que je viens d’évoquer : il s’agit de cultiver la paix en soi, un travail qui peut permettre de trouver plus d’harmonie au sein de sa famille, de la société, de la communauté internationale. Dans le village des ‟Pruniers” en Dordogne, Thich Nhat Hanh avait réuni deux groupes antagonistes d’Israéliens et de Palestiniens pour s’écouter et tenter de trouver une harmonie au lieu d’exacerber des haines réciproques. Expérience hautement délicate.
 |
Nous en revenons à l’ouvrage de Dominique Loreau dont j’avais gardé souvenance tant il m’avait interpellé en septembre 2007. Déjà elle cite en exergue de ce volume un Haïku de Kobayashi Issa, qui illustre idéalement son propos :
Ce printemps dans ma cabane
Absolument rien,
Absolument tout.
Fixée au Japon après avoir été une grande voyageuse, Dominique Loreau explique dans l’Introduction que « c’est par soustractions successives que j’ai petit à petit compris que la quête de la simplicité était la façon la plus juste de vivre à la fois confortablement et selon ma conscience[6]. » Plus loin, je relève cette phrase : « La simplicité, c’est posséder peu pour laisser la voie libre à l’essentiel et à la quintessence des choses[7]. »
Tout le processus d’accumulation et d’enlisement est évoqué : « Nombreux sont ceux pour qui les richesses matérielles représentent le reflet de leur vie, une preuve qu’ils existent. Ils associent consciemment ou non leur identité et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes à ce qu’ils possèdent. Plus ils ont, plus ils se sentent sécurisés, accomplis. Tout devient objet de convoitise : les biens matériels, les bonnes affaires, les œuvres d’art, les connaissances, les idées, les amis, les amants, les voyages, un dieu et même l’ego. Les gens consomment, acquièrent, accumulent, collectionnent. Ils « ont » des amis, « possèdent » des relations, « détiennent » des diplômes, titres, médailles… Ils croulent sous le poids de leurs possessions et oublient ou ne réalisent pas que leur convoitise les transforme en êtres sans vie, parce que assujettis à des envies toujours plus nombreuses[8]. »
C’est une lecture savoureuse et libératrice que je vais prolonger : « Un petit coin parfait, un bon livre et une tasse de thé peuvent apporter une satisfaction extrême[9]. »
Avec elle, nous voudrons proclamer « ne faisons aucun compromis avec l’inutile ». ♦
_____________________________
[1] Edgar Morin, La Voie, Librairie Arthème Fayard, Le Grand Livre du mois, Paris, 2011, p. 20.
[2] P. Artus et M.-P. Virard, Globalisation : le pire est à venir, Paris, La Découverte, 2008, cité dans l’ouvrage d’Edgar Morin, La Voie, Librairie Arthème Fayard, Le Grand Livre du mois, Paris, 2011, p. 21.
[3] Thich Nhat Hanh, La Colère. Transformer son énergie en sagesse, JC Lattès, Pocket, Paris, 2004/2018, p. 37.
[4] « L’individu est le foyer de l’univers. […] Vous devez donc vous préoccuper de l’univers, c’est-à-dire de vous-même, en qui tous les autres existent[4]. », Krishnamurti (1930), cité par René Fouéré, La Révolution du réel, Khrihsnamurti, Le Courrier du livre, Paris, 1995, p. 412.
[5] Thich Nhat Hanh, La Colère. Transformer son énergie en sagesse, JC Lattès, Pocket, Paris, 2004/2018, p. 41.
[6] Dominique Loreau, L’Art de la simplicité, Éditions Robert Laffont / Le Grand livre du mois, Paris, 2005, p. 13.
[7] Ibid., p. 20
[8] Ibid., p. 20-21.
[9] Ibid., p. 33.
25 & 26 décembre 2019
Méditation de Noël sur la sobriété heureuse
Or, l’organisation de la société est fondée
sur un ‟Homo economicus” considéré comme
entité productive et consommatrice,
les deux bielles du moteur de la pseudo-économie.
Dans ce cas, vieillir n’est pas s’accomplir,
fructifier et transmettre avant de s’éteindre,
mais déchoir avant de disparaître.
Pierre Rabhi, Vers la Sobriété heureuse[1]
Noël : un jour de jeûne. Il fallait oser ! Non, j’y fus contraint, sans amertume, ni tristesse cependant.
Lors de notre marche entre 11 h 00 et midi, avec Alonzo, j’ai pu noter que la gabegie des fêtes, ne l’enchantait pas plus qu’à moi. Nous évoquions la dilapidation qu’engendrent les successions permanentes de commémorations propices à nous faire dépenser inutilement notre argent. Il était désolé de tout ce gaspillage, de cette société de consommation à tout crin, qui nous lie indéfectiblement au capital, notre ennemi le plus pernicieux.
Par cette permanente débauche d’achats, nous alimentons les caisses de nos exploiteurs. C’est quasi irrépressible. Peut-être faut-il atteindre un certain âge pour se dépouiller de ce besoin de se faire plaisir, de remplir nos armoires, nos étagères, ou au mieux de faire plaisir aux autres, ce qui ne serait pas une erreur en soi, mais qui se révèle trop souvent telle une tradition obligeante.
Sur le plan psychologique, il faut bien admettre ce qui devient, avec le temps, un rituel d’achats compulsifs, compensateurs – tenter de se faire plaisir pour atténuer un manque affectif. Je n’ignore pas avoir été de ceux-là, atteint par ce ‟cussou” existentialiste qui nous conduit à mourir en laissant une maison pleine de tout ce dont nous n’avons aucun besoin dans l’au-delà. Il y a là un caractère burlesque et tragique. C’est une satisfaction, trop tardive sans doute, d’en prendre conscience. J’avais eu entre les mains un ouvrage, que je retrouverai peut-être un de ces jours (ce qui est advenu le 27 décembre au soir !), qui nous expliquait l’importance de vivre dans une maison quasi vide, sans l’encombrement d’une accumulation invraisemblable de choses qui finissent finalement par nous posséder et nous détourner de l’essentiel.
Je me trouve en adéquation avec l’énoncé de Pierre Rabhi, dans son ouvrage Vers la sobriété heureuse : « On me demande souvent ce que j’entends par cette ‟sobriété heureuse” que je prône comme une sorte d’antidote à la société de la surabondance sans joie dans laquelle les pays dits développés se sont enlisés. […] On ne peut appliquer à une planète naturellement limitée un principe artificiel illimité. […] Le choix d’un art de vivre fondé sur l’autolimitation individuelle et collective est des plus déterminants[2]. »
 |
Il vient un âge où nous devons être, si nous y tenons sans doute, à juste titre, les pourvoyeurs des réunions familiales ou amicales. Les générations antécédentes ont disparu et étant sans descendance, je ne peux compter sur la relève, comme par exemple mes sœurs et mes cousines. J’ai ici organisé, fait relativement rare pour un homme, tant de réunions amicales, culturelles, fêté tant d’anniversaires, que sans le regretter, je n’en éprouve plus désormais l’envie, n’ayant plus la place, ni le désir, ni la force de prolonger ce temps festif et parfois assez superficiel. D’autres y peuvent songer. J’ai horreur de me faire porter et je me suis lassé de porter une éternelle kyrielle d’individus incapables d’initiatives et trop heureux de se laisser porter. Krishnamurti nous explique assez clairement que nous sommes responsables de nous-mêmes et de l’humanité dont nous ne sommes pas séparés :
« L’individu est le foyer de l’univers. […] Vous devez donc vous préoccuper de l’univers, c’est-à-dire de vous-même, en qui tous les autres existent[3]. »
Une ‟amie” qui eut pu devenir, il y a bien des années, mon épouse, issue d’un milieu bourgeois, qui ne m’appelle, en principe, que lorsqu’elle traverse des difficultés ou des épreuves, – et on peut dire que la vie l’en a généreusement pourvue – m’a décrit de long en large la joie et la fatigue de Noël avec ses enfants et petits-enfants, réunis autour d’elle. C’est à peine si j’ai existé quelques secondes dans ce long monologue ; mon Noël, extrêmement sobre, l’indifférant totalement. Il en fut tout autrement lorsque ma cousine Pierrette, en soirée, me passa un long coup de fil pour prendre de mes nouvelles. Elle me fit bénéficier, par ailleurs, des échos de toute la famille réunie le soir du 24 décembre, et sut comment faire pour me donner un peu de la joie si particulière de Noël en me racontant que Yann, âgé d’un an, avait galopé sans trêve en riant et en parlant de mieux en mieux ! Un dégourdi qui apprécie la vie ! Mais ce qui m’a le plus touché, fut d’entendre que Tom déclare maintenant tout de go : « Je suis content ! » et caresse le petit chat de ses cousines avec passion pendant que son petit frère le saisit par le dos et le transporte d’un endroit à l’autre comme un jouet ! Par contre Tom n’a pas ouvert ses cadeaux, il ne sait pas que c’est Noël et ce que cela signifie ! Chaque fois que je vois Tom, j’ai l’impression de voir un ange ; il appartient à un autre monde, mais il pénètre dans le nôtre par le rire et la tendresse. Et dieu merci, il a des parents, des grands-parents, des cousines et cousins qui possèdent le don de l’amour et de la joie.
J’avais décliné, peut-être par prescience, deux invitations familiales. Comment pourrais-je le regretter puisque je fus couché presque toute la journée. On ne va pas chez les autres, pour leur gâcher leur plaisir, comme ma mère s’y employa parfois. Je ne suis jamais malheureux de demeurer seul, au calme, à me reposer. J’ignore ce que l’on nomme s’ennuyer ! Et cette méditation en justifie l’extrême frugalité : seulement deux tasses d’infusion de thym dans la journée. Et si c’était cela un Noël réparateur et un début de sobriété heureuse ! ♦
_____________________________________
[1] Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, Arles, Actes Sud, 2010, p 108.
[2] Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, Arles, Actes Sud, 2010, p 95-96.
[3] Krishnamurti (1930), cité par René Fouéré, La Révolution du réel, Khrihsnamurti, Paris, Le Courrier du livre, 1995, p. 412.
Du dimanche 15 au lundi 23 décembre 2019
Couleur des jours II
Les eaux troubles envahissent nos campagnes et nos villages. Les ruisseaux dont on avait oublié l’existence se répandent dans les prairies détrempées. Les crues se généralisent, nous mettant les pieds dans l’eau ! Nous y sommes moins préparés ou enchantés que l’aulne qui jubile ce matin sur les bords de l’Isle et de la voie verte à Saint-Astier.
 |
 |
 |
||
Jeudi 12 décembre, l’Auvézère était boueuse et torrentielle aux abords de Redrol au Change. Après notre visite à Sandrine et à son père au cœur d’une jungle de chats multicolores, en compagnie d’Orion qui voulut faire un câlin à Marie Annick, le retour par le chemin d’arrivée, submergé, était peu engageant. Nous prîmes un chemin à l’arrière de la maison pour rattraper la route de Cubjac, qui longe l’Auvézère, laissant nos amis assis au bord de l’eau !
 |
La corruption, l’incompétence stigmatisent ce gouvernement d’amateurs, d’apprentis sorciers. Delevoye se couvre de honte, semble-t-il en toute impunité, aux yeux de tous les français qu’il indigne par sa réforme privative et injuste et la multiplicité de ses postes et revenus tenus secrets. Aux yeux du monde, la France sanctifie une pornographie morale comme nouveau mode de gouvernement. Les impuretés, les souillures s’accumulent sur la tête du mirliflore qui se croyait, en 2017, Napoléon ou Louis XIV !
La morosité est de rigueur, mais le 17 décembre, même sous la pluie, nous étions à nouveau dans la rue pour contester ce qui est douteux et toxique. Le chefaillon, bientôt en haillon, tape du pied. Caprice qui exprime tout son mépris pour ce qui n’est pas lui ou de sa caste d’hyper-privilégiés ce qui les apparente à des mafieux, des escrocs. La blanche candeur se pare d’éclaboussures insalubres, hideuses, scandaleuses, nauséabondes.
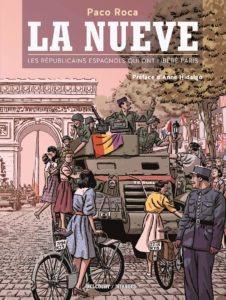 |
Alonzo m’avait prêté un livre, La Nueve (Les Républicains espagnols qui ont libéré Paris) de Paco Roca. C’est une impressionnante bande dessinée publiée chez Delcourt / Mirages, en 2013. Par l’interview de Miguel Ruiz, un vieil anarchiste espagnol, peu communicatif, va se dérouler l’histoire sordide et troublante de ces courageux qui ont combattu, souvent au péril de leurs jeunes vies, les dictatures, celle de Franco, de Pétain, de Mussolini, d’Hitler. Nous sommes témoins de la difficile fuite d’Espagne en cargo, puis de la cruauté des camps, et de l’arrivée en Afrique du Nord. Presque toujours rejetés comme des pestiférés, maltraités par la France déconfite, cette page nous conte l’histoire de ces hommes et femmes, révolutionnaires de la Guerre d’Espagne, trempés dans l’acier. On croise en ces pages le lieutenant Amado Granell, le capitaine Raymond Dronne, le colonel Joseph Putz, le camarade Fabregas… L’histoire d’amour entre Miguel Ruitz et la camarade Estrella, brisée par leur accident tragique. Ainsi tout au long du récit il y a la tombe où repose le grand amour de Miguel. On découvre aussi le retour en Espagne de ce modeste héros, sous Franco. Il ne parvient cependant pas à récupérer l’affection de son épouse Pepa, pas plus que celle de son fils. Les Républicains espagnols n’acceptaient des ordres que de ceux qu’ils respectaient. Le Général Leclerc, le « patron », était de ceux-là. Nous les retrouvons au Maroc formant la deuxième Division Leclerc. Puis c’est l’arrivée en Écosse, la formation, l’invasion de la France et l’entrée dans Paris !
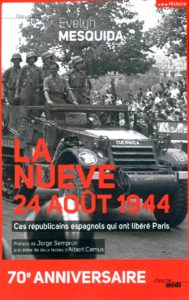 |
En 2011, je m’étais procuré auprès de sa rédactrice, Evelyn Mesquida (ouvrage préfacé par Jorge Semprún), La Nueve 24 août 1944, ces républicains espagnols qui ont libéré Paris (Cherche midi éditeur, collection Documents, 2011). On retrouve dans cet ouvrage nombre des héros de cette épopée et même des photographies.
La préface de Jorge Semprún est éloquente sur la révision historique qui conduisit à une grande injustice : « Certains se demandent encore ce qu’ont pu apporter ces Espagnols au combats français. Comme le reflète bien ce livre sur la Nueve, l’apport des Espagnols se fit à tous les niveaux : et d’abord celui de l’expérience du combat et la préparation militaire et politique ; tout ce qui faisait d’eux des combattants différents des autres, plus politisés, plus énergiques et plus combatifs. Il existe de nombreux documents qui montrent à quel point ils furent efficaces et courageux. […] Quand arriva le moment de réécrire l’histoire française de la guerre, l’alliance communistes-gaullistes fonctionna de façon impeccable. Les uns et les autres marginalisèrent le rôle de tous les étrangers qui avaient lutté à leurs cotés, et ils expurgèrent tout ce qui les gênait. Comme ils devaient expulser de la mémoire française la guerre coloniale en Algérie, usant du même mécanisme…
C’est ainsi que la participation étrangère, et surtout espagnole – qui fut la plus nombreuse –, disparut peu à peu des écrits jusqu’à s’évanouir totalement dans les mémoires. Résultat : des années après, beaucoup de gens s’étonnent quand on leur raconte que Paris a été libéré par les Espagnols en avant-garde[1]. »
Les Républicains espagnols ont montré le chemin de la détermination à l’émancipation des peuples au XXe siècle. Et la reconnaissance tardive de leurs sacrifices innombrables n’a pas encore permis, à ce jour, de soulever le joug de l’oppression d’une caste dominante, dépourvue d’âme.
Comment ne pas être scandalisé de la duplicité de l’Église, alliée à une bourgeoisie méprisante et à la royauté dans ce qui entoure encore aujourd’hui les hommages rendus à un des êtres les plus abjects qui fut au monde, un despote et un assassin. Ainsi le 24 octobre dernier, était exhumée la dépouille embaumée du dictateur fasciste espagnol. Depuis la basilique creusée dans la roche du mausolée de Valle de Los Caidos, le cercueil était porté par huit membres de sa famille dont son arrière-petit-fils, Louis de Bourbon, cousin éloigné du roi d’Espagne Felipe VI, afin d’être transféré au cimetière de Mingorubbio, au nord de Madrid, où repose son épouse.
Lundi 23 décembre, l’Isle est redevenue un fleuve bouillonnant, envahissant rives et champs. Nulle trêve pour les mouvements de grèves, pour les pluies diluviennes et le vent tempétueux. Un joyeux Noël en perspective ! ♦
_____________________________
[1] Evelyn Mesquida, La Nueve 24 août 1944, ces républicains espagnols qui ont libéré Paris, Préface de Jorge Semprún, Paris, Cherche midi éditeur, collection Documents, 2011, p. 12 & 13.
Dimanche 8 & lundi 9 décembre 2019
Couleur des jours
Grise, bien grise, la couleur des jours, avec insistance, jusqu’au dégoût si l’on se réfère au temps épouvantable que nous subissons depuis des semaines, impuissants et écœurés.
Politiquement, socialement, le règne du Mirliflore n’a rien d’enthousiasmant. C’est une OPA de la pègre financière sur la nation française et ses habitants. La France se hérisse, se révolte… à juste titre, me semble-t-il. La manifestation de jeudi 5 décembre, sous un très exceptionnel ciel limpide, était du jamais vu pour moi, cortège sans fin et foule des grands jours. L’exaspération est désormais à son comble.
« Dieu est la seule réponse logique à certaines questions absurdes. » affirme Anarin. Voici un chemin que nous n’empruntons plus pour résoudre l’équation politique. Car l’attitude d’un soi-disant Dieu tout puissant, incarnation de l’Amour infini nous laisse démunis devant ce que peu d’humains peuvent supporter sans crier ou se jeter dans l’action : voir des enfants mourir sous les armes, de malnutrition, vendus, exploités. Ce Dieu misérable, je l’ai abandonné aux crédules encore trop nombreux.
Lorsque je me sens trop triste, je songe à Tom, ce petit gars de 4 ans, beau comme le jour, atteint d’autisme léger, ce qui permet d’envisager une guérison que j’espère de toute mes forces ; il est si bien entouré par des parents et des grands-parents magnifiques ! Cet enfant, grand pour son âge, plongé dans son univers un peu secret, prononçant peu de mots, mais les connaissant tous, retrouve le contact avec la réalité lorsqu’il rit ; la réalité qui lui plait, celle de la joie et du bonheur. Il a un petit frère d’un an, absolument craquant, qui incarne la joie de vivre et le désir d’embrasser la vie. L’approche entre les deux frères est un peu difficile, je ne doute cependant pas qu’elle se fasse, ce sera la guérison ; le plus jeune hyper communicatif entraînera son grand frère vers la vie extérieure, qui ne manque pas d’écueils mais possède le baume du « vivre et faire ensemble ». Je pense que ma frustration de ne pas avoir eu d’enfant à tenir par la main se manifeste là de manière aussi vive qu’inattendue.
 |
Il est une autre joie que je ne pouvais conquérir, celle d’entendre ce week-end à Paris la reprise de l’opéra-bouffe en 3 actes de Jacques Offenbach, Les Géorgiennes dont la création remonte au 16 mars 1864 aux Bouffes-Parisiens (création viennoise de l’œuvre élargie, le 5 octobre 1864). Année faste, puisqu’auparavant, avec succès, le compositeur assistait à la création, à Vienne, le 4 février 1864, de son unique grand opéra, Die Rheinnixen (partition dédiée à l’Empereur François-Joseph). Deux oeuvres en un seul acte avaient ouvert l’année au théâtre des Bouffes-Parisiens : L’Amour chanteur (5 janvier 1864) et une merveille de drôlerie, Il Signor Fagotto (13 janvier 1864). Durant l’été deux autres oeuvres en 1 acte furent crées à Bad Ems[1] (villégiature du compositeur), Jeanne qui pleure et Jean qui rit et Le Soldat magicien ou le fifre enchanté. L’année s’achève sur un triomphe absolu et jamais démenti ; en effet, les Bouffes-Parisiens représentent le 17 décembre 1864, La belle Hélène.
Le sujet des Géorgiennes sur l’ultime coopération d’Offenbach avec Jules Moinaux[2] (père de Georges Courteline) est de facture assez fantasque, n’évitant ni les banalités, la facilité et même la vulgarité. Le sujet cependant est conforme à la vision pro-féministe du maestro. La femme, les femmes en sont les héroïnes et les hommes y sont sévèrement raillés (ici pour leur couardise). Mais la réconciliation finale efface les discrédits survenus au cours de l’action. Pour la musique nous ne connaissons que les thèmes du quadrille composé par Joseph Strauss suite aux représentations de l’automne 1864 à Vienne qui connurent un succès plus manifeste encore qu’à Paris. La Marseillaise des femmes, hymne guerrier, aurait dû passer à la postérité.
 |
Sur Forum Opéra, sous le titre À bas les hommes !, Jean-Marcel Humbert, nous gratifie d’un compte-rendu sur cette œuvre inconnue : « C’est à une formidable redécouverte que nous invite le Groupe Lyrique[3] (du groupe La Poste issu de la Chorale des PTT fondée en 1936), en jouant l’opéra-bouffe en trois actes Les Géorgiennes. Cette oeuvre, qui connut malgré les critiques, un grand succès public à sa création en 1864, fut très vite jouée en Autriche, Russie, Allemagne, Belgique, puis aux États-Unis en 1874, mais jamais reprise après cette date. Donc un bel hommage rendu à Offenbach en cette année anniversaire pauvre d’imagination. L’histoire est simple : dans un Orient de fantaisie, les hommes de la ville de Djégani, au lieu de combattre le pacha Rhododendron qui vient y renouveler son harem, s’enfuient lâchement. Leurs femmes décident alors de prendre le pouvoir, qu’elles rendront aux hommes à la fin. […] C’est l’Offenbach Edition Keck (Boosey & Hawkes), possesseur de la partition manuscrite d’Offenbach, qui a permis cette résurrection, qui comprend de plus deux passages coupés lors de la création parisienne. Le chef et musicologue Laurent Zaïk a réalisé le travail de transcription de la partition, puis son arrangement pour treize musiciens. Il souligne « Musicalement, Les Géorgiennes fait la part belle aux scènes d’ensemble, dans de vastes numéros musicaux dont l’origine provient de l’opéra. En 1863, Offenbach travaillait à son grand opéra romantique, Die Rheinnixen, qui sera créé à l’Opéra de Vienne en février 1864. Cette volonté d’agrandissement du genre de l’opéra-bouffe se retrouve aussi dans le soin apporté à l’orchestration, plus fouillée que dans les ouvrages précédents ou ultérieurs ». De fait, la musique, bien dans la verve d’Offenbach, vive, joyeuse et entraînante, avec quelques touches d’émotion, avait séduit les critiques de l’époque, alors qu’ils faisaient la fine bouche concernant le livret. Mais fort curieusement, on ne sort pas de la représentation avec des refrains dans la tête, à part le « À bas les hommes ! », et quelques mesures qui évoquent La Périchole ou La Grande Duchesse. »
 |
Nous devons à Stéphane Lelièvre, spécialiste du compositeur, une évaluation de la musique propre à mettre l’eau à la bouche : « De fait, la partition comporte plusieurs caractéristiques ayant assuré le succès d’autres oeuvres du maître et qui pourraient tout à fait contribuer à remettre Les Géorgiennes sur le devant de la scène offenbachienne : des couplets militaires (ceux de Nani notamment : « Ah vraiment, / C’est charmant / D’aller à la guerre ») dignes de la « Chanson du régiment » de La Grande-Duchesse ; certaines pages orientalisantes (les couplets de Boboli, ceux du Pacha Rhododendron), des rythmes de valse (par exemple dans la section rapide du duo de la séduction au second acte), des chœurs de femmes (tel celui, très beau, ouvrant l’oeuvre) ; une chanson à boire ; un final d’acte conséquent (celui du I, qui voit se succéder ladite chanson à boire : « Allons, foulez la grappe ! », un chœur et un ensemble) ; des couplets tendrement élégiaques (« Sous cet uniforme modeste / Palpite un vrai cœur de soldat », avec un délicieux accompagnement au violoncelle) ; un cancan endiablé (« C’est vilain, mademoiselle ! ») ; un chant de guerre (« Allons, femmes, serrons nos rangs / Et marchons en vrais conquérants. / À bas les hommes ! ») qui semble annoncer la révolte finale du Roi Carotte. Certaines pages sont d’un humour vraiment irrésistible, tels l’air d’entrée du Pacha Rhododendron : « Je suis Rhododendron / Pacha très en renom », l’énumération, sur un rythme irrésistiblement dansant, des supplices qui attendent Boboli (air de Rhododendron, acte III, scène 1), ou encore le chœur des (fausses) Bohémiennes du dernier acte, sur un rythme de boléro plus ou moins ‟espagnol” dont Offenbach a le secret. Notons enfin qu’il n’est pas interdit de voir dans le chœur des éclopés (les soldats faussement blessés rentrant dans leur foyer) une version burlesque de celui des ‟soldats” de Faust (créé quatre ans plus tôt), ou dans le personnage de Feroza, jeune femme en uniforme commandant ses troupes d’une main de fer, une préfiguration de La Grande-Duchesse de Gérolstein (la scène au cours de laquelle les Géorgiennes reçoivent des lettres de leurs maris donnant des nouvelles du front a au demeurant évidemment inspiré la première scène du second acte de La Grande-Duchesse !) […] Une reprise semble prévue l’an prochain : aucun offenbachien, aucun amateur de nouveautés ou de rire en musique ne voudra la manquer ! [4] »
Cette partition conséquente, souvent difficile, interprétée par une troupe d’amateurs aguerris se révèle être un des plus savoureux hommages, avec Barkouf, Madame Favart et Maître Péronilla, rendu au compositeur pour le bicentenaire de sa naissance. La découverte d’un Offenbach inconnu est toujours un grand bonheur. Le compositeur ne connaissait pas de fléchissement dans sa créativité, ce qui explique la permanence de sa suprématie sur les scènes de son vivant et aujourd’hui toujours !

L’enregistrement de La Sirène, opéra-comique en 3 actes (1844) de Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) arrive à point pour illuminer ce lundi où alternent passages pluvieux et modestes éclaircies laissant filtrer quelques rayons du trop rare soleil. Cet opéra-comique de 1844 est plein de charme et n’est pas sans faire songer à l’inventivité mélodique de Jacques Offenbach. C’est un enregistrement de 2018 réalisé au Théâtre Impérial de Compiègne qui a si souvent défendu ce compositeur très injustement délaissé, alors que de son vivant Auber jouissait d’une éblouissante renommée. Ce disque n’a retenu que les parties chantées, excluant les dialogues. Toute parution en disque d’œuvres de DFE Auber enchante le mélomane ! Le travail de redécouverte s’avère immense et pourrait concrétiser, après l’admirable investissement de Pierre Jourdan[5], le retour en grâce d’un de nos plus excellents compositeurs de la scène lyrique. ♦
[1] La station thermale de Bad Ems (située dans le duché de Nassau) est un des lieux de villégiatures affectionnés par Offenbach. Son premier séjour date de 1858 où « il retrouve le public élégant et cosmopolite qui est le sien et peut y assouvir sa passion du jeu. De 1862 à 1867, il y fait jouer, au Kursaal, huit ouvrages, en quelque sorte en ‟avant-première”, parmi lesquels en juillet 1864 Le Soldat magicien (qui deviendra à Paris Le Fifre enchanté) et Jeanne qui pleure et Jean qui rit… » (Note de Jean-Claude Yon, chapitre 30 de l’ouvrage, M. Offenbach nous écrit (lettres au Figaro et autres propos réunis et présentés par Jean-Claude Yon, Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 2019, p. 133. Depuis Étretat, dans sa lettre datée du 4 août 1864 à Villemessant, Offenbach confie : « J’avoue que j’ai pour Ems une prédilection toute particulière ; j’y puise à la fois la santé et une certaine inspiration. C’est à Ems que j’ai fait une partie d’Orphée, un peu de Fortunio, et beaucoup des Bavards… », Ibid., p. 134.
[2] Jules Moinaux, nom de plume de Joseph-Désiré Moineaux ou Moineau, est un écrivain et humoriste français, dramaturge, chroniqueur et librettiste, né le 24 octobre 1815 à Tours, mort le 4 décembre 1895 à Saint-Mandé. Il est le père de Georges Courteline dont le nom d’état-civil était Georges Moineaux (ou Moineau).
Fils de Joseph-Jacques Moineau, ébéniste à Tours, Jules Moinaux commence par apprendre le métier de son père. Mais rapidement, il préfère vivre de sa plume, et devient journaliste et rédacteur-sténographe au Palais de justice de Paris. Dès la fin des années 1840, il commence à écrire, très souvent en collaboration, des pièces comiques qui remportent un franc succès. En 1853, il écrit pour Jacques Offenbach, Pépito, opéra-comique, puis en 1855, Les Deux Aveugles, bouffonnerie musicale. En 1866, sa comédie Les Deux Sourds est créée au Théâtre des Variétés à Paris. Au cours de la Guerre Franco-Prussienne de 1870, il fait jouer aux Folies-Dramatiques avec un succès prolongé, un opéra-bouffe, Le Canard à trois becs, musique d’Émile Jonas.
Ses chroniques judiciaires du tribunal correctionnel, rédigées avec verve pour La Gazette des tribunaux, Le Charivari, etc., sont rassemblées en recueil, en 1881, sous le titre Les Tribunaux comiques. Son fils Courteline s’en est parfois inspiré pour certaines de ses pièces. Sa satire du milieu policier, Le Bureau du Commissaire, est publiée en 1886 avec une préface d’Alexandre Dumas fils. Le Monde ou l’on rit, son dernier ouvrage, parait en 1895. Dans cette suite de croquis on trouve entre autres Le Sourd qui n’avoue pas, On demande un malade gai, Le Rapia de Champigny, ou encore L’Homme aux goûts champêtres.
[3] Stéphane Lelièvre se montre justement explicite sur la hardiesse du Groupe Lyrique : « Et de fait, c’est un spectacle réjouissant de fraîcheur et d’humour qu’a présenté le Groupe Lyrique, qui met un point d’honneur à proposer régulièrement des titres rares et délaissés (on lui doit notamment les redécouvertes de Jeanne qui pleure et Jean qui rit ou La Foire Saint-Laurent d’Offenbach, La Fiancée du scaphandrier de Terrasse, ou encore Rita ou le mari battu de Donizetti). », Les Géorgiennes balancent leur Rhodo à la MPAA/Saint-Germain, Première-Loge.fr.
[4] Stéphane Lelièvre, Les Géorgiennes balancent leur Rhodo à la MPAA/Saint-Germain, Première-Loge.fr (http://premiere-loge.fr/LES-GEORGIENNES-%C3%80-LA-MPAA/SAINT-GERMAIN/?fbclid=IwAR2EvOXc4EHhuWBnlHrm2BF0iUok34zaOwfQFfUsBvMHWyDOhfwMN2rqP90).
[5] « C’est Auber avant tout qui a bénéficié d’un véritable travail de fond de la part de Pierre Jourdan : Gustave III, Le Domino noir, Fra Diavolo, Les Diamants de la couronne, tous ont connu des re-créations éclatantes de vie. Pierre Jourdan avait compris au plus intime la délicatesse de touche que réclame cette musique fragile, aérienne, légère sans être comique, toujours élégante, et il l’aimait avec sincérité. », Lionel Pons, Hommage à Pierre Jourdan, 2007, https://xn--lesamisdelamusiquefranaise-dkc.com/?texte=jourdan-pierre.