JOURNAL 2019 : Chant des jours (février-mars)
« L’écriture n’est pas un but en soi, mais une façon de chercher et de dire le sens même de la vie individuelle ou collective. »
Francis COMBES, Préface de Ce que signifie la vie pour moi de Jack LONDON.
JOURNAL 2019 : Chant des jours
« Prends partout ce que les choses — un objet, une couleur, un bruit — ou les êtres t’apportent. »
Jean SÉNAC, Lettre à son fils adoptif, Jacques MIEL, 1961
« J’ai horreur des sectes, des cloisonnements, des gens que presque rien ne sépare mais qui, pourtant, se regardent en chiens de faïence. […] Voulant être, si possible chez tous, avec tous, je voudrais, présomptueusement, réconcilier, rassembler. »
Daniel GUÉRIN, Front populaire révolution manquée, Maspero, 1970.
Dimanche 31 mars 2019
En salutation au soleil de Saint-Martin, la délicieuse Marie-Rose, depuis ce jardin qui exalte de ferveurs printanières. Je voudrais, Marie-Rose, que nous nous souvenions de José Casajuana, le petit tailleur de Périgueux, que, par l’intermédiaire de mon vieil ami, Jacques Grégoire[1], anarchiste, adepte de l’Espéranto… j’avais rencontré au début de ma trentaine, à la fin des années 70, ayant été troublé par son recueil publié aux Nouvelles Éditions Debresse.
Autant son ami Jacques était dans ses propos enveloppant, souple, autant José par la vigueur de son verbe m’avait impressionné, intrigué et même apeuré. Je n’étais pas, de toute évidence, encore prêt à comprendre le credo anarchiste ! Pour autant et sans avoir cherché à le rencontrer davantage, il m’avait définitivement conquis. C’était donc cela un Homme, un de ces rares lucides qui ne transigent pas avec la flétrissure élégamment ordonnée du monde. José assumait à prix coûtant sa magnifique clairvoyance.
José ou Anarin nous laisse, dédiées à sa fille Violette, des pensées d’une si grande acuité, qu’elles sont immortelles. Lui, le Républicain Espagnol, réfugié chez nous, à Périgueux, vivant dans un grand dénuement, doté d’une sagesse troublante derrière son aiguille et ses ciseaux.
 |
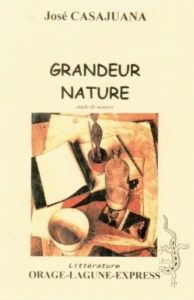 |
|
Bernard Deson[2], sur son blog [https://www.paperblog.fr/users/bdeson/] nous livre ses souvenirs : « Est-ce parce qu’il exerça le métier de tailleur pour hommes que José Casajuana put prendre la juste mesure de ses contemporains ? Homme d’exil, cet anarchiste a fui l’Espagne de 1936, constatant avec effarement que les idées tuent. Son premier contact avec la France aurait pu le détourner de notre culture et de notre langue : les camps de concentration de Léon Blum n’avaient rien à envier à ceux de Mussolini ou à ceux de Franco. Au contraire, devenu tailleur, l’exilé consacrera tous ses instants de liberté à l’étude de la littérature française. En 1970, il publiera à compte d’auteur un opuscule sobrement intitulé Pensées sous le pseudonyme d’Anarin. Étiemble en dira le plus grand bien vantant ses qualités de peintre de l’âme humaine. En 1979, j’en fis l’heureuse découverte dans un rayon de la bibliothèque de l’I.U.T. Michel de Montaigne.[3] »
Bernard Deson va enfin découvrir, en 1985, par l’entremise de sa sœur Marie-Hélène, qui est cet Anarin et ils vont se rencontrer : « Nous prîmes langue et nous rencontrâmes au café Gambetta, brasserie au-dessus de laquelle José Casajuana occupait un minuscule appartement. Sans qu’il n’en dise mot, j’avais deviné que cet homme vivait dans le plus grand dénuement. Il fut ému d’apprendre l’importance que son livre avait eue pour l’étudiant que je fus. Et c’est sans hésiter qu’il accepta ma proposition de le rééditer ou plus exactement de le rafraîchir en y ajoutant une couverture couleur, en changeant le titre et en le signant de son véritable nom. Il convint de la chose avec enthousiasme, me laissant seul maître à bord pour mener à bien cette métamorphose. Un auteur comme je les aime ![4] »
Comme toujours, le temps s’écoule, d’autres projets interfèrent, et le temps qui a passé vient nous surprendre, en nous laissant démunis : « De temps à autre, je recevais une lettre de José Casajuana, toujours patient et compréhensif, très patient et très compréhensif, trop peut-être […] Je pris le temps, presque quatre ans quand même, et Grandeur nature, nouveau titre de l’ouvrage, sortit des presses en novembre 1989. Malheureusement, cette publication arriva trop tard pour José Casajuana et le courrier qui la lui annonçait me revint avec la mention « destinataire décédé ». J’appris qu’il avait mis fin à ses jours quelques semaines auparavant. J’en ai gardé un sentiment de culpabilité, peu fier de ma négligence, même si je devine qu’une vieillesse vécue dans la pauvreté et la maladie ne convenait pas au libre-penseur qui écrivait : La mort serait un mal si la vie était un bien. »[5]
L’extrême modestie et la résignation de cet homme d’une lumineuse intelligence se heurtent à notre frilosité, à nos jeunesses douillettes. L’enfer de sa propre jeunesse l’avait contraint à se forger une extrême résistance, mais on sent à le lire, à méditer ses aphorismes aussi brefs que percutants qu’il était désabusé sur la fraternité humaine. Aujourd’hui et depuis des années, je regrette, ayant appris mieux mon métier d’homme, de ne pas avoir su lui apporter de l’amitié ; il l’aurait mérité plus qu’aucun autre ; auprès de lui j’aurais gagné vingt ans de maturité. Son petit ouvrage ne m’a jamais quitté, c’est un guide.
Si longtemps après, c’est de la tendresse et de la gratitude que j’éprouve pour celui que nous avons laissé privé de davantage de fraternité humaine ; fraternité qu’il avait mille fois gagnée.
Même si José Casajuana, Anarin, n’est plus là, il nous est permis de faire un bout de chemin avec lui, grâce à ses pensées qui allument en nous les étincelles d’une précieuse lucidité :
« Ceux qui ne valent pas cher font bon marché de la vie des autres. », p. 9.
« Si nous sommes si seuls dans le monde, c’est parce que chez les autres nous ne trouvons que l’égoïsme qui est aussi en nous. », p. 11.
« Si les petites gens ont l’air meilleur que les personnes importantes, c’est que, n’ayant pas le pouvoir d’en faire de grandes, ils ne font que de petites saletés. », p. 14.
« Le remords est un châtiment qui ne frappe que ceux qui ont une conscience intransigeante ; les autres trouvent toujours des justifications à leurs méchancetés et à leurs crimes. », p. 18.
« Aucune tyrannie ne peut nous empêcher de nous libérer des préjugés ni de raisonner juste. », p. 27.
« Les grands méprisent les petits ; et ceux-ci se vengent en se méprisant entre eux. », page 31.
« Chacun a autant de vanité que peu de lucidité. », p. 35.
« L’homme aspire au privilège, et non à la justice. », p. 47.
« Et l’homme créa dieu. Mais voyant que, seul, il s’ennuyait, il créa aussi le diable. », p. 49
« Immoral : celui qui n’agit pas selon mon intérêt ou mes principes. », p. 60.
« Les bons exemples sont peu suivis ; même par leurs auteurs. », p. 66.
« N’avoir pas de doutes devrait éveiller nos soupçons. », p. 73
« Quand on se tait, on ne dit pas de sottises ; mais on ne les pense pas moins. », p. 76.
« Les lois morales et juridiques protègent les fortunes, qui ne peuvent être bâties qu’en les violant. », p 85.
« Par la religion et la politique un grand nombre de personnes éminentes rejoignent la stupidité générale. », p. 89.
« Anarchie : mot employé à la place de ‟désordre”, et que tous ceux dont la politique est le vice ou le gagne-pain, agitent comme un épouvantail. », p. 104.
« De l’argent, juste de quoi vivre ; car mon bonheur, je le trouve ailleurs, gratis. », p. 123
« Je ne veux pas augmenter le mal que me font les autres en les haïssant. », p. 125.
« Comme les autres, j’ai aussi mes croyances, mes convictions, mes idées, ma philosophie, ma métaphysique. Les voici résumés en quelques mots : bla, bla, bla. », p. 127 ♦
___________________________
[1] Je croyais Jacques Grégoire disparu depuis quelques années, après le décès de son fils Michel. Mes messages étaient restés sans réponse. Sa maison était fermée. J’apprends en faisant des recherches pour ce texte qu’il est décédé tout récemment, en février 2019.
[2] Bernard Deson est formateur, écrivain, éditeur (Éditions ‟Germe de barbarie”, revue Instinct nomade).
[3] Bernard Deson, José Casajuana, tailleur pour hommes, https://www.paperblog.fr/8278501/jose-casajuana-tailleur-pour-hommes/
[4] Ibid.
[5] Ibid.
Samedi 30 mars 2019
Devant les jets d’eau, sur l’emplacement de l’ancien théâtre de Périgueux, tranquillement assis à regarder les passants, bourgeoises décaties, puis une débarquée flamboyante, toute de rouge vêtue, chevelure en feu, bas et bottines noires, portant, amarrés à son coude gauche, deux cabas, vous l’imaginez : un noir et l’autre rouge. C’était quand carnaval ? On pouvait imaginer, à l’observer attentivement, une morue desséchée. Elle vint vers le bassin, d’où un agent d’entretien de la Ville repêchait les saletés jetées là par d’indécents malpropres. Cette fulgurance cramoisie, surgissant d’anciennes marées, aujourd’hui recuite et asséchée, renonça, à ma grande déconvenue, à se jeter à l’eau pour tenter une réhydratation ! L’eau douce ne lui sembla pas idéalement propice…
Marie-Annick aurait bien fait un tour de manège sur un petit âne gris. Bien qu’en bleu marine, je pus remplacer l’ami de Francis Jammes pour jouer aux commères.
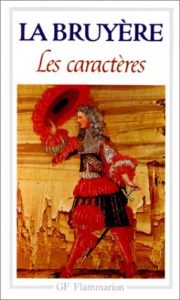 |
Plus sérieux, Les Caractères de Jean de La Bruyère[1] que je compulsais, étonné de constater que du XVIIe siècle au XXIe rien n’avait changé, la sottise humaine étant éternelle…
« Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il considère qu’il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte, et où tant de gens se trouvent pour le remplacer ?[2] »
« Il vit encore, quoique assez avancé en âge, et il use le reste de ses jours à travailler pour s’enrichir.[3] »
« Je découvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il en puisse coûter aux autres, pourvoir à lui seul, grossir sa fortune, et regorger de bien.[4] »
« Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou par sa propre industrie, ou par l’imbécillité des autres.[5] »
« Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu ; capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre ; curieuses et avides du dernier dix ; uniquement occupées de leurs débiteurs ; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri des monnaies ; enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes : ils ont de l’argent.[6] »
« Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leur condition les dispense si fort de tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites, que c’est modestie à eux de ne promettre pas encore plus largement.[7] »
« Faut-il opter ? Je ne balance pas : je veux être peuple.[8] »
Je ferais un même choix pour mon honneur et pour contrarier l’amoureux éperdu des Premiers de cordée ! Il faut vraiment n’avoir aucune dignité, aucun scrupule pour admirer des personnes qui tirent leur puissance financière de l’exploitation et de la misère de beaucoup d’autres. Ce n’est pas le marché, aussi déréglé soit-il, qui est criminel, ceux sont les donneurs d’ordres qui le sont. ♦
_______________________________
[1] Jean de La Bruyère (1645-1696) D’origine bourgeoise, La Bruyère fait ses humanités et obtient une licence en droit et achète une charge de trésorier général à Caen. À partir de 1684, et grâce à Bossuet (1627-1704), il est sous-précepteur dans la maison du Grand Condé, auprès du jeune duc de Bourbon, petit-fils du prince. À partir de 1687, son activité professorale cesse et il devient bibliothécaire chez les Condé. Il commence à rédiger Les Caractères dès 1670. C’est un livre qu’il a maintes fois remanié et augmenté. La première publication du livre est anonyme et porte le titre Les Caractères ou mœurs de ce siècle : le succès est rapide et l’ouvrage est réédité plusieurs fois du vivant de l’auteur. La Bruyère est désormais célèbre et son élévation sociale est indéniable. En 1693, il est élu à l’Académie française, notamment grâce à la protection des Condé et au soutien, à l’Académie, du parti des Anciens. En mai 1696, La Bruyère meurt suite à une attaque d’apoplexie, à moins que ce ne soit d’un empoisonnement. (D’après Étudeslittéraires : https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/la-bruyere.php).
[2] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Du mérite personnel », no 1, Bibebook. Édition du Kindle, p. 82.
[3] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des biens de fortune », no 27, Bibebook. Édition du Kindle, p. 150.
[4] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des biens de fortune », no 35, Bibebook. Édition du Kindle, p. 152.
[5] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des biens de fortune », no 52, Bibebook. Édition du Kindle, p. 155.
[6] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des biens de fortune », no 58. Bibebook. Édition du Kindle, p. 157.
[7] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des grands », n° 6. Bibebook. Édition du Kindle, p. 200.
[8] Jean de La Bruyère, Les caractères, « Des grands », n° 25. Bibebook. Édition du Kindle, p. 205.
Jeudi 28 mars 2019
Une famille éprouvée, les Amis de la poésie éplorés, mille amis ou admirateurs endeuillés accompagnent, en ce jour de plein soleil, la belle Annie qui alluma pour nous tant d’étoiles, moments heureux, inspirants. Comment ferons-nous sans elle pour raviver la flamme des festivités ? Il y faut une grande énergie et une magnifique abnégation !
Le marché du jeudi matin à Saint-Astier était printanier. Emmanuel qui vendait le pain de La Dynamo, lorsque ce n’était pas la jolie boulangère, Laura, devient en avril, le chef jardinier du Château de Neuvic. Retour de Françoise David tout sourire mais condamnée à prier assise ou debout ; ses genoux, si elle n’y prenait garde, la laisseraient tomber.
Deux ouvrages à moins d’un euro signé de Jean Chalon me parviennent : Chers contemporains et L’Ami des arbres (Journal d’Espagne 1973-1998).
Chers contemporains. Il y a de véritables perles dans ces portraits à la fois savoureux, drôles, parfois mélancoliques, car l’auteur se s’exclue pas de la galerie de ces 58 stéréotypes.
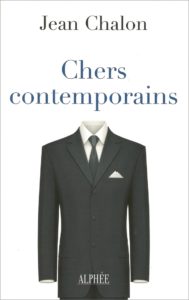 |
Déjà, le portrait de l’athée est fort désopilant : « Il nie le péché originel et répète volontiers cet aphorisme de Natalie Barney : ‟Si au moins, le péché originel avait pu être un péché original !”[1] ». Où encore : « Il déteste les souffrances inutiles que prônent tant de religions. » Si je puis me permettre d’ajouter que les souffrances inéluctables que nous rencontrons dans le cours de nos existences sont suffisamment nombreuses et âpres pour que nous n’ayons aucun désir de nous soumettre à un dolorisme gratuit, aussi céleste soit-il, qui incline à la peur et engendre la subordination !
Le retraité, quant à lui, n’a plus qu’une seule aspiration puisque : « La tranquillité est devenue sa dernière ambition[2]. » Ce n’est pas vraiment faux, ni tout à fait exact, mais constitue un paradoxe désabusé.
Que dire du râleur ? sauf à s’y reconnaître assez : « Il est né pour râler et ne s’en prive pas. Il râle contre l’euro qui le ruine, l’Europe qui le déçoit, le Vatican qui l’exaspère, l’Élysée qui l’indigne, les fruits qui n’ont plus de goût, les quatre saisons qui se réduisent maintenant à deux, un hiver trop froid et un été trop chaud[3]. »
« Il est jardinier et limite l’univers à son jardin… Il a une affection particulière pour ces roses de Noël qui profitent du froid et de la neige pour mieux s’épanouir… Il ne se mariera jamais puisqu’il a épousé son jardin, qui est tout son univers[4]. »
« Le promeneur » nous propose un quasi portrait du Piéton de Paris, le poète Léon-Paul Fargue : « Il marche lentement, s’arrêtant à chaque pas […] Il marche lentement. Il avoue même en riant qu’il marche avec les yeux. Ce sont ses yeux qui le guident vers les portes cochères, les corridors profonds, les jardins intérieurs, les usines désaffectées, des endroits où personne ne passe et qui sont devenus le royaume des chats presque sauvages et des lilas de Perse[5]. » ♦
_______________________________
[1] Jean Chalon, Chers contemporains, « L’athée », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 15.
[2] Jean Chalon, Chers contemporains, « Le retraité », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 100.
[3] Jean Chalon, Chers contemporains, « Le râleur », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 95.
[4] Jean Chalon, Chers contemporains, « Le jardinier », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 53-54.
[5] Jean Chalon, Chers contemporains, « Le promeneur », Paris, Éditions Alphée, 2011, p. 89.
Mercredi 27 mars 2019
« L’absence de désir peut engendrer une volupté subtile et intense. Si, comme l’affirment les bouddhistes, la béatitude se tient près du renoncement, elle réside aussi dans l’absence de désir[1]. »
Après les affres des inéluctables disparitions, faire le vide parait opportun, nécessaire, régénérateur. Le légitime programme de notre départ est désormais en marche, il y eut les malchanceux (que d’autres, les optimistes, nommeront les précurseurs !), il y a désormais la foule des programmés ; demeurera la panacée : le petit nombre de résistants qui observeront pensifs la prochaine génération débuter son propre effritement. Nous fûmes témoins de quelques-uns, ils seront témoins du grand nombre, comme de ceux qui s’éterniseront, zestes d’un temps révolu, invraisemblablement obsolète. Le pétrifié, vivant hors de son temps, existe au milieu d’un monde qui n’est plus le sien et qu’il ne saurait comprendre. Partir, un peu comme tout le monde, ou rester de manière quelque peu incongrue : alternative maussade, inévitablement désenchantée !
Cette ‟petite mort” ou l’absence de désir qu’évoque Jean Chalon me semble une manière d’accéder à l’acceptation de sa non-existence, au renoncement à soi-même, à son ego (générateur de toutes souffrances), à cet état de veille souvent inconfortable, parfois douloureux qui ne saurait rien contester à notre destin de voyageur furtif… Le pèlerin qui s’immobilise, se fige… Il faut une grande volonté pour trouver l’énergie d’être dans le Vivant après quatre-vingt-dix ans. Un tout petit nombre y parvient : c’est ce qu’on appelle la jeunesse éternelle ! ♦
_________________________
[1] Jean chalon, Journal d’un arbre 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 65.
Mardi 26 mars 2019
« Lorsqu’un homme s’en va, il importe de dire, avant qu’il ne s’efface, tout ce qu’il a représenté pour nous, ce qu’il nous a donné et le bien qu’il a fait[1]. »
Annie Delpérier qui prononçait ses mots, il y a un an, n’est plus.
Elle nous quittait alors que José Corréa nous offrait un magnifique portrait.
Quelques traits, le personnage est là et aussi sa personnalité, sa majesté, son attention aux autres, sa générosité. Ce que l’on ne voit pas, c’est son immense talent de poétesse ; j’espère que sa succession aura à cœur de publier ses écrits afin que nous la gardions longtemps avec nous encore, à travers la beauté de son écriture.
 |
| Portrait d’Annie Delpérier, 2019 © José Corréa |
Un mélange d’admiration et de crainte me fit appeler José.
Il ne put que me confirmer l’approche d’un deuil.
Deuil ressenti, je l’imagine, par tant de personnes avec lesquelles elle avait eu des relations au travers de ses activités culturelles, Les Amis de la poésie et l’Académie des Lettres et des Arts du Périgord (ALAP).
Après la disparition du poète et traducteur Bernard Lesfargues[2] en février 2018, proche d’Annie, c’est toute une époque féconde qui disparaît et nous laisse démunis. Une visite au poète[3], à l’éditeur, vers le début des années 2000, dans cette maison du grand-père « adossée à la grande forêt protectrice », débordant de livres, accompagné par Bernard Petit, me fascina et m’inspira, l’activité d’édition des Amis de la musique française.
 |
|
Bernard Lesfargues dans son bureau, Église-Neuve-d’Issac 2004 © Photo Jean Alain Joubert |
Les souvenirs surgissent, même si j’ai moins côtoyé Annie que bien d’autres qui étaient des fidèles des Amis de la poésie. Mon amie, la poétesse Marie-Hélène Douat[4], l’appréciait particulièrement. Marie-Hélène, a été publiée par les soins d’Annie dans Le Poémier de Plein Vent[5], je retrouve son recueil Blanche négritude (Prix Jean Michel Walzer 2007, de la Ville de Bergerac). Il y eut plus récemment, le Poémier no 146, Notes bleues, publié en 2015. Ces deux numéros de la collection rejoignaient ceux consacrés aux poésies de Catherine Guillery, Marcelle Delpastre, Danièle Labatsuzan, Madeleine Lenoble, Bernard Sintès, Bernard Lesfargues, Michel Lasserre, Bernard Duteuil…
En juin 2000, Annie était venue aux Rolphies, pour un moment poésie avec le petit cercle amical constitué de Renée Daubricourt, Denise Robin (assise à droite d’Annie sur la photo), d’Émilie Dalençon, de Lucienne Fabre-Doré… et, venue de Saint-Laurent d’Olt, la poétesse Marie-Hélène Douat (à la gauche d’Annie sur la photo).
 |
|
Aux Rolphies, Montrem, avec Annie Delpérier, Denise Robin, Marie-Hélène Douat. 25 juin 2000 © photo Jean Alain Joubert |
Je me souviens d’une visite à la Chartreuse de Pécharmant. Mais aussi d’une foule pour un hommage à Marcelle Delpastre[6] présente parmi nous avec son ami Jan dau Melhau[7]. Les rencontres au Couvent des Récollets ou au Caveau de la Vinée.
Je serais très ingrat si je ne parlais pas de la soirée qu’Annie avait organisée, en 2001, pour la première conférence donnée par un jeune musicologue de Marseille, mon ami Lionel Pons. Elle avait réuni au Caveau de la Vinée tous ses amis et Lionel nous présenta le compositeur Henri Sauguet, qui n’était pas un inconnu chez nous, puisque né à Bordeaux, il passait ses étés à Coutras dans La Maison des chants. Depuis Lionel est un conférencier émérite, un vaste public le suit fidèlement chaque semaine à Marseille.
Et il y eut, naissant ce jour-là, une amitié fédératrice avec Jeannine Lasserre, proche amie d’Annie. Pour celle-ci nous avions de la tendresse et elle en avait vraiment pour nous. Belle âme entre toutes. Jeannine Lasserre fut le plus beau cadeau que nous fit Annie Delpérier. Jeannine était par ailleurs l’amie de Marcelle Delpastre dont elle parlait toujours avec émotion.
Ce temps, celui de la cinquantaine, en ce qui me concerne, était celui des beaux jours, d’une certaine insouciance, du temps libéral et potentiellement créatif. Au cœur de ce jardin botanique qui atteignait son épanouissement, notre groupe culturel était florissant et affectif. La création de l’association Les Amis de la musique française avec de jeunes musicologues en herbe qui aujourd’hui ont fait magnifiquement leurs preuves, fut mon rêve qui devint réalité.
Annie était une amoureuse des mots et du Pays. Son soutient était presque sacrificiel et ardent pour les Artistes et les Gens de Lettres qu’elle affectionnait. Toute sa vie était dédiée à la poésie. Elle avait créé la revue trimestrielle La Toison d’or ainsi que sa propre maison d’édition dont les recueils Le Poémier de Plein Vent que j’évoque plus haut.
En 1987, elle avait pris la présidence de l’association des Amis de la Poésie à Bergerac et avait créé les Journées de la Poésie qui se déroulaient chaque année, en principe, le second week-end de juin.
En 2010, elle devint Présidente de l’Académie des Arts et des Lettres du Périgord qu’avait fondé, en 1963, Guy de Lanauve.
La poésie de Marie-Hélène Douat nous unira pour cet ultime hommage à une Grande Dame qui nous manque déjà, ayant emporté avec elle une part importante de ce que furent les belles années de nos vies. Merci Annie ! Demeurera notre indéfectible gratitude et affection.
Po-aime pour Annie
Puisque tu n’es plus là
Que la nuit a ravi ton sourire
Sous son écharpe de silence
Nous saurons désormais
Trier les graines d’espérance
Et garder dans l’Amour
Les années d’autrefois
Où ton absence sera toujours
Éternelle présence
Marie-Hélène Douat
♥
________________________________
[1] Annie Delpérier, Deuil Occitan, Bernard Lesfargues, 1924-2018, Cailloux blancs d’un itinéraire.
[2] Abel Bernard Lesfargues (1924-2018), poète, traducteur, défenseur des langues minoritaires des auteurs occitans, catalans et espagnols. « Poète, occitaniste, éditeur et traducteur considérable, Bernard Lesfargues s’est éteint le 23 février 2018, en début de matinée, au château de Bassy à Saint-Médard-de-Mussidan. Le jour de ses obsèques, sur la place de l’église du petit village d’Église-Neuve-d’Issac, jouxtant sa propriété, une foule d’amis connus et anonymes, venus de tous les horizons, se réunissait autour de sa famille, le cœur étreint, pour ce dernier rite de l’accompagnement, avant les mystères de la métamorphose et le silence de la nuit. » (Annie Delpérier, Deuil Occitan, Bernard Lesfargues, 1924-2018, Cailloux blancs d’un itinéraire.) Bernard Lesfargues avait 93 ans au moment de sa disparition. « Fils d’un marchand de bois et de charbon de Bergerac, il grandit dans un quartier populaire, vivant et animé, tout en suivant une scolarité solide au Petit Séminaire de la cité périgourdine. Très tôt, son goût pour la littérature l’affranchit du réel, lorsqu’il s’évade un livre à la main dans un cerisier comme dans une retraite idéale. » (Philippe-Jean Catinchi, le 28 février 2018, Le Monde.) Après de brillantes études, il enseignera à Paris (Janson-de-Sailly) puis à Lyon. Les rencontres vont se multiplier. Il se familiarise avec les phares de l’Institut d’Estudis Occitans (IEO), association culturelle fraîchement créée qui milite pour le maintien et le développement de la langue comme de la culture occitanes : Pierre Bec, Max Rouquette, Bernard Manciet, Robert Lafont… Obstinément sûr de ses choix, à la tête des éditions Fédérop (Les éditions Fédérop ont été reprises en 1999 par Bernadette Paringaux), fondées à Lyon en 1975 par un groupe d’amis, en reprenant le nom d’une librairie politique très liée aux italiens du Mouvement Fédéraliste Européen, il reprendra la collection ‟Solaire” créée par François-René Daillie, et publiera, en 160 titres, des textes rares et dignes de prendre place dans une littérature de classe internationale. Citons : Ouvrir les Yeux de Paul Gravillon, Journal d’un pèlerin vielleux et mendiant sur le chemin de Compostelle du troubadour limousin Jan dau Melhau : « qui use d’un français remarquable et sait se déshabiller » dira son éditeur, Les guerriers nus, de Jean-Marie Lamblard, Dix-huit petits poèmes pour la patrie amère, de Yannis Ritsos, Requiem pour un paysan espagnol de Ramon Sender… Aussi, lorsque Vicente Aleixandre obtiendra le Nobel en 1977, Fédérop sera le seul éditeur français à l’avoir édité, et Gallimard rachètera dans la nuit, les droits en catastrophe. » (Annie Delpérier, Deuil Occitan, Bernard Lesfargues, 1924-2018, Cailloux blancs d’un itinéraire). Il fut également le fondateur de la revue Taillefer, pour la mise en valeur du canton méconnu de Villamblard. « Traducteur du prix Nobel péruvien Vargas Llosa et du Catalan Joan Sales, Bernard Lesfargues excellait dans cet art tout de finesse et de sensibilité. Mais là où il mettait tout son cœur et ses tripes, c’était en poésie dans laquelle il faisait exploser le soleil intérieur qu’il transformait en un feu intérieur enivrant. Attaché à notre terroir et à sa thébaïde familiale, Bernard Lesfargues était un savant, un sachant, un maître et un ami précieux. » (Christian Régnier, Prix Bernard Lesfargues de la traduction de l’Académie des lettres et des arts du Périgord)
[3] « Connaître Bernard, dans sa vaste ‟librairie” tapissée d’ouvrages, dont la porte est ouverte en permanence à tous ceux qui viennent là, chaque jour, chercher un document, étudier, interroger, partager son immense savoir, c’est découvrir un homme à la générosité sans limite, aux souvenirs intarissables. Sa passion de former des êtres, de les élever, de leur faire prendre conscience de leur identité, de leur histoire, conduira le poète catalan Jep Gouzy, à proclamer, au cours d’une soirée de poésie au Caveau de la Vinée de Bergerac : “Nous sommes tous des enfants de Lesfargues”. » (Annie Delpérier, Deuil Occitan, Bernard Lesfargues, 1924-2018, Cailloux blancs d’un itinéraire).
[4] Marie-Hélène Douat, poétesse, habite l’Aveyron. Rapidement remarquée par Annie Delpérier elle avait reçu des prix en 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 et 2006 (Prix Fénelon, Prix des Armoises à deux reprises, Prix Sophie Decaux, Prix Simone Grignon). En 2003, elle avait reçu le Prix du Recueil de la Ville de Bergerac pour Transhumance, puis elle avait obtenu le prix Jean-Michel Walzer, en 2007, pour Blanche Négritude, édité par Annie dans sa collection Le Poémier de Plein Vent (no 101) ; en 2015, elle avait été récompensée par le prix Audrey Bernard de la Ville de Bergerac, pour l’ensemble de son œuvre.
[5] Le Poémier de Plein Vent existe nous dit Annie « en souvenir de ces arbres de plein vent, poiriers et pêchers dans nos vignes autrefois, qui portaient des fruits sauvages, menus, mais d’une saveur sans égale. »
[6] Marcelle Delpastre (1925-1998), native de Germont sur la commune de Chamberet (Corrèze), auteure Limousine de langues occitane et française. Fille, petite-fille, arrière-petite-fille de paysans limousins, elle naît au cœur de la civilisation paysanne. Chez elle Marcelle Delpastre entend et apprend deux langues, l’occitan et le français. Elle obtient le baccalauréat philosophie-littérature au collège de Brive-la-Gaillarde. Elle fait ensuite un passage à l’École des Arts décoratifs de Limoges. En 1945 Marcelle Delpastre retourne vivre dans la ferme familiale de Germont où elle sera paysanne tout le restant de sa vie. Tout en travaillant, qu’elle soit occupée à traire les vaches ou à conduire le tracteur, elle ne cesse de réfléchir à des sujets de poésie, à des vers, à des rimes. La poésie l’accompagne toute la journée et elle garde dans sa poche un carnet sur lequel elle note les vers et les idées qui lui viennent à l’esprit, idées qu’elle retravaille ensuite pendant la nuit. À la fin des années 1940 et au début des années 1950, alors que ses cahiers de poèmes et de notes commencent à s’entasser, Marcelle Delpastre envoie des textes à quelques revues et anthologies de poésie. Il faut dire que plusieurs de ses correspondances littéraires l’y encouragent depuis longtemps. De petites publications en petites participations, elle se fait peu à peu connaître et apprécier du milieu littéraire limousin. Au début des années 1960, Marcelle Delpastre constate avec douleur la mort de son petit village de Germont et avec lui de toute la civilisation paysanne pourtant millénaire en Limousin. Les tracteurs remplacent les bœufs, les machines remplacent les outils et la main de l’homme, la télévision remplace les veillées par lesquelles la tradition orale se transmettait… C’est à ce moment que la Marcela (comme l’appellent ses amis en occitan) commence à beaucoup s’intéresser aux contes, proverbes et traditions de son pays limousin. Elle fait à cette époque la rencontre de Robert Joudoux de la revue régionaliste Lemouzi et de Jean Mouzat (auteur occitan limousin). La première œuvre en occitan de Marcelle Delpastre est La lenga que tant me platz (La langue qui tant me plaît). À partir de ce moment, Marcelle Delpastre décide d’écrire en occitan limousin, du Limousin et sur le Limousin. Au milieu des années 1960, elle se met à collecter et à réécrire des contes traditionnels limousins. Le premier recueil est publié en 1970 sous le titre Los contes dau Pueg Gerjant (Les Contes du Mont Gargan), encore aujourd’hui souvent réédités dans des recueils de contes français. Parallèlement à cela elle commence à faire œuvre d’ethnologue de son pays avec Le tombeau des ancêtres : Coutumes et croyances autour des fêtes religieuses et des cultes locaux. Si elle n’était pas une grenouille de bénitier, Marcelle Delpastre avait cependant une très forte foi en Dieu tout en acceptant, comme la plupart des Limousins, différentes traditions païennes propres à ce pays. En 1968 est publié La vinha dins l’òrt, poème primé au concours Jaufré Rudel. Sa version française (La Vigne dans le jardin) sera mise en théâtre en 1969 par la troupe de Radio-Limoges, troupe qui montera dans les années 1970 d’autres textes de Delpastre (L’Homme éclaté, La Marche à l’étoile). Marcelle Delpastre continue d’écrire des poèmes et seulement quelques-uns d’entre eux sont publiés à l’époque dans les revues Lemouzi, Traces, Poésie 1, Vent Terral ou encore Oc. En 1974, Los Saumes pagans (Psaumes païens) sortent dans la collection Messatges de l’Institut d’Estudis Occitans. C’est ce recueil de poèmes qui la fit véritablement connaître de tout le milieu littéraire occitan. Dans Le bourgeois et le paysan, Delpastre continue d’étudier les coutumes, les croyances et la tradition orale du Limousin, cette fois sur le thème du feu. Plus tard ce sera le tour des bêtes sauvages et domestiques d’être à l’honneur dans son Bestiari lemosin, (Bestiaire limousin) naviguant entre réalité et mythologie. Dans les années 1970 Marcelle Delpastre fait deux rencontres importantes, celles de Michel Chadeuil et de Jan dau Melhau, deux jeunes auteurs en langue limousine. Elle participera régulièrement à leur revue Lo Leberaubre dont le titre est une contraction de leberon (loup-garou) et d’aubre (l’arbre). Marcelle Delpastre commence à être connue des Limousins pour ses interventions et ses entrevues dans la presse locale (Limousin Magazine, La Montagne, L’Écho du Centre, Le Populaire du Centre…) et aussi de tous les occitanistes grâce aux revues et surtout Connaissance des Pays d’Oc (par la plume d’Yves Rouquette). Dans ses dernières années, Marcelle Delpastre a beaucoup travaillé en compagnie de son ami Jan dau Melhau pour faire sortir de la poussière des centaines de textes inédits. Dans les années 1990, les éditions Payot publient les versions françaises de plusieurs de ses textes en prose et Bernard Pivot l’invite dans son émission Bouillon de Culture. Atteinte de la maladie de Charcot, Marcelle Delpastre décède le 6 février 1998 dans sa ferme de Germont où elle est née, où elle a toujours vécu, travaillé et écrit. Jan dau Melhau, son légataire universel, continue et termine d’éditer l’œuvre intégrale de Delpastre aux éditions Lo chamin de Sent Jaume (les ouvrages sont accessibles aux non-occitanophones car édités en version bilingue occitan-français). Les manuscrits de Marcelle Delpastre sont aujourd’hui conservés à la Médiathèque Municipale de Limoges. Poète, conteuse, romancière et ethnologue, Marcelle Delpastre est aujourd’hui reconnue comme l’un des plus grands écrivains occitans du XXe siècle (au côté de Joan Bodon, Bernard Manciet, René Nelli ou encore Max). Le message de cette femme, elle qui n’a jamais quitté sa terre limousine, s’étend à l’universel et parle pour tous les hommes, c’est ce qui fait la force et la beauté de son œuvre. (D’après la page WikipédiA consacré à Marcelle Delpastre).
[7]Jan dau Melhau, né Jean-Marie Maury en 1948 à Limoges est à la fois écrivain, musicien, chanteur, conteur, éditeur d’occitan du Limousin. Il est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse. Puis il obtiendra une ensuite une maîtrise de philosophie. Objecteur de conscience, dans les années 1970 il fait un retour à la terre en Haute-Vienne. Dans le même temps il devient une des têtes d’affiche de la chanson occitane, marginale par ses sujets de prédilection : la nature, les bêtes, les hommes et la mort. Auteur et éditeur des Belles Lettres Occitanes Limousines, avec Marcelle Delpastre, Paul-Louis Grenier, il s’intéresse surtout à la beauté de la langue occitane, à sa force littéraire. Il continue aujourd’hui d’œuvrer pour le Limousin avec sa maison d’édition Lo Chamin de Sent Jaume (le Chemin de Saint-Jacques) à Meuzac, avec ses propres écrits ainsi qu’avec ses spectacles de contes et de chansons. Il est également cofondateur, avec Micheu Chapduelh (Michel Chadeuil), de la revue limousino-périgourdine, Lo leberaubre. (D’après WikipédiA)
Lundi 25 mars 2019
« Il existe une cause majeure, la cause des causes, résumant l’histoire de la décadence. C’est la constitution d’une partie de la société en maîtresse de l’autre partie, c’est l’accaparement de la terre, des capitaux, du pouvoir, de l’instruction, des honneurs par un seul ou par une aristocratie[1]. »
Aux portes de la Dordogne naquit un personnage magnifique, un de ces humains qui surpasse et surclasse tous les autres, avec des décennies d’avance sur l’évolution des consciences. Lorsque je contrôlais les demandeurs d’emploi, un poste qui aurait pu être essentiellement nocif ‒ sous la vindicte d’un socialisme pourrissant ‒, et que je m’avançais jusqu’à Sainte-Foy-La-Grande qui jouxtait notre Port-Sainte-Foy périgourdin, sur la rive sud de la rivière Dordogne, si j’avais entendu le nom d’Élisée Reclus[2] et celui de son frère Élie[3], j’ignorais que naquirent sur cette terre, d’un père Pasteur protestant, ces deux personnages exceptionnels.
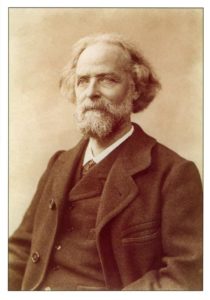 |
S’il se destinait à être Pasteur comme son père, Élisée va se passionner pour les langues étrangères ‒ il en parlera six ‒ et pour les voyages. Il va d’ailleurs découvrir la géographie auprès d’un professeur allemand réputé. Révolutionnaire en 1848 (il a dix-huit ans) il fuit la France pour l’Angleterre. Partout il rencontre les progressistes et forge sa conception sociale et politique. En Louisiane il est confronté à la pratique de l’esclavage.
« Dans une lettre à sa mère Zéline, il écrit peu après : ‟par goût, je préfère vivre pauvrement” ‒ l’austérité protestante dont il a hérité se meut en engagement quotidien[4]. » Avec les années, il devient militant anarchiste et communiste, naturiste, partisan végétarien de la cause animale, critique de la domination coloniale, défenseur de ‟la liberté de la femme” comme critère définitif de ce qu’est la tyrannie et précurseur écologiste. Reclus est l’homme de ce qu’il nommait la ‟lutte méthodique et sûre contre l’oppression”. Il est une boussole et, en définitive, un grand précurseur.
Proche de Bakounine qui disait de lui et de son frère aîné, Élie, qu’ils étaient « les hommes les plus modestes, les plus désintéressés, les plus purs, les plus religieusement dévoués à leurs principes » qu’il ait rencontrés au cours de sa vie. Après la mort de Bakounine, en 1876, il fait la connaissance du russe Kropotkine, géographe et anarchiste comme lui, avec lequel les rapports ne manquent pas de devenir fraternels, mais en toute indépendance. Son neveu (fils d’Élie) dira de lui : « Élisée n’a jamais été le disciple de personne et il n’a jamais admis que personne fût son disciple. »
En 1981, lors du ‟Congrès noir” du mouvement anarchiste à Londres, ‟La propagande par le fait” est adoptée, effrayant toute l’Europe. Reclus, pacifiste, récuse le terrorisme. Il soutiendra cependant les jeunes gens donnant leur vie pour leurs idées. De même les nihilistes russes l’impressionnent. Sa manière à lui d’être propagandiste, s’exerce par la plume et la parole. Il multiplie les articles et pamphlets libertaires : « c’est bien la lutte contre tout pouvoir officiel qui nous distingue officiellement », déclare-t-il lors d’une conférence à Bruxelles.
Dans sa conférence Évolution et Révolution, il n’exclut pas l’usage de la violence pour la cause : « De deux choses l’une ; ou bien la justice est l’idéal humain et, dans ce cas, nous la revendiquons pour tous ; ou bien la force seule gouverne les sociétés et, dans ce cas, nous userons de la force contre nos ennemis[5]. » Jusqu’à la fin du siècle, les attentats à la bombe ou à l’arme blanche se multiplient. Ils prennent symboliquement fin en 1894, à Lyon. Le président de la République française, Sadi Carnot, est assassiné par Caserio, un anarchiste italien.
La fin de vie d’Élisée Reclus se partage entre honneurs, voyages et défiance des autorités françaises vis-à-vis de son aura sociale et politique. Il occupe, par sa trajectoire, par ses ouvrages, une place de premier plan parmi les progressistes, les génies précurseurs de l’histoire de l’humanité.
« Le tigre peut se détourner de sa victime, mais les livres de banque prononcent des arrêts sans appels ; les hommes, les peuples sont écrasés sous ces pesantes archives, dont les pages silencieuses racontent en chiffre l’oeuvre impitoyable. Si le capital devait l’emporter, il serait temps de pleurer notre âge d’or, nous pourrions alors regarder derrière nous et voir, comme une lumière qui s’éteint, tout ce que la terre eut de doux et de bon, l’amour, la gaieté, l’espérance. L’Humanité aurait cessé de vivre[6]. » ♦
_______________________________
[1] Élisée Reclus, L’Évolution, la révolution et l’idéal anarchique [1902], Écrits sociaux, éditions Héros-Limite, 2012.
[2] Élisée Reclus (1830-1915), plus précisément Jacques-Élisée Reclus, géographe libertaire, militant anarchiste français, communard. Théoricien anarchiste, pédagogue et écrivain prolifique. Il obtient, en 1892, une chaire de géographie comparée à la Faculté des sciences de Bruxelles. Chaire suspendue avant son commencement fin 1893 suite à l’attentat d’Auguste Vaillant à Paris. Il donne alors ses premiers cours dans les locaux de la Loge maçonnique, Les Amis philanthropes. En octobre 1894, avec d’autres professeurs démissionnaires, il crée à Bruxelles l’Université Nouvelle ainsi que l’Institut des hautes études. Citoyen du monde avant l’heure, précurseur de la géographie sociale, de la géopolitique, de la géohistoire et de l’écologie. Favorable à une langue universelle, en 1897, il cite l’espéranto en exemple et se réjouit du fait que dix ans seulement après son invention, il réunisse déjà quelque 120 000 adeptes. Élisée Reclus pensait que la nudité était l’un des moyens de développer la socialisation entre individus, il en vantait les bienfaits hygiéniques moralement comme physiologiquement, et il la mettait en perspective dans de vastes vues englobantes sur l’histoire et la géographie des cultures. Certains le considèrent parmi les inspirateurs des fondateurs du mouvement Naturiste. Très tôt rebuté par la viande, Élisée Reclus pratique un végétarisme strict. Il fut un « légumiste » convaincu comme il aimait à le dire et partageait cette conception avec son frère Élie.
Ses ouvrages majeurs sont La Terre en 2 volumes, sa Géographie universelle en 19 volumes, L’Homme et la Terre en 6 volumes [La revue Herodote, le considère comme l’un des géographes les plus importants de son temps, au point d’avoir consacré deux numéros entiers à son œuvre en 1981 et 2005]. Parmi ses ouvrages, il est à noter Histoire d’un ruisseau et Histoire d’une montagne. Mais ce penseur qui vit de sa plume aura également publié environ 200 articles géographiques, 40 articles sur des thèmes divers, et 80 articles politiques dans des périodiques anarchistes. (D’après WikipédiA).
[3] Élie Reclus, de son vrai nom Jean-Pierre Michel Reclus, né à Sainte-Foy-La-Grande (Gironde) le 16 juin 1827, mort à Ixelles (banlieue de Bruxelles) le 11 février 1904. Il est journaliste, écrivain, ethnologue et militant anarchiste français de la fin du XIXe siècle. Porte-voix des ethnies minoritaires, il a beaucoup écrit en faveur de ce qu’on appelait alors les « peuples sauvages ». Franc-maçon, il est sous la Commune de Paris, directeur de la Bibliothèque Nationale. Il est issu de la dynastie Reclus dont les membres (ainsi que certains de leurs descendants et collatéraux) ont acquis une certaine notoriété comme journalistes, géographes, médecins, explorateurs, enseignants, militants associatifs ou politiques. (D’après WikipédiA).
[4] Élisée Reclus, vivre entre égaux, texte inédit de Roméo Bondon, Ballast.
[5] Élisée Reclus, Les produits de la terre, paru dans la revue La Société nouvelle, 1889.
[6] Élisée Reclus, L’Évolution, la révolution et l’idéal anarchique [1902], Écrits sociaux, éditions Héros- Limite, 2012. Ce discours prononcé, le 15 juillet 1902, dans une réunion publique à Genève, est depuis publié en brochures de diverses langues.
|
|
Dimanche 24 mars 2019
Jour anniversaire de ma mère, née en 1922, qui aurait donc aujourd’hui 97 ans. Il faut une santé de fer pour aborder des âges pareils. En principe on quitte le navire plus tôt, lassé des incessantes réductions de forces qu’offre l’âge.
Lorsqu’elle a compris le 15 septembre 2010, grâce à la stupidité inconcevable de la jeune cardiologue de l’hôpital de Périgueux, que sa vie allait s’interrompre, elle a eu ce mot : « J’ai compris, tant mieux » !
Aussi, il est possible d’entendre l’interjection de la mère de Josée de Chambrun[1] : « N’aie pas peur de mourir, c’est très bien. »
 |
 |
|
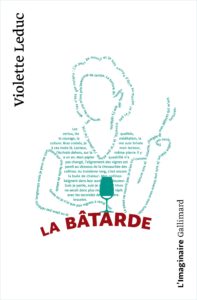 |
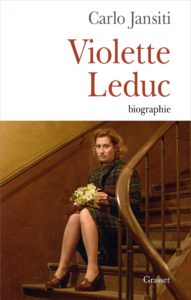 |
|
Jean Chalon apprécie les relations sulfureuses plus encore que les mondaines. Elles doivent susciter son inspiration. En voilà une preuve savoureuse venue de son Journal de Paris :
« Midi. Je vais chercher Violette Leduc[2] à Vogue. Elle est vêtue d’un ensemble Courrèges, jupette en toile cirée blanche, boléro en toile cirée verte, énorme casquette en toile cirée vert et blanc. Je ne peux pas imaginer un seul instant qu’elle va sortir dans un tel accoutrement. Elle sort et à mon bras.
Nous remontons le boulevard Saint-Germain sous un soleil radieux, la foule s’écarte comme la Mer Rouge devant les hébreux. Horrifiée, muette, la foule contemple l’étrange couple que nous devons former.
Chez Lipp où nous déjeunons, mon supplice continue. Violette menace d’ôter son dentier qui la gêne pour déguster tranquillement sa choucroute. C’est plus que je n’en peux supporter et je préviens Violette que, si elle le fait, je quitte la table. ‟Tu n’es qu’un petit bourgeois avec des préjugés”, me dit-elle méprisante. Mais elle n’enlève pas son dentier[3].»
Ouf ! Mais ce midi, il n’y aura pas de choucroute au menu !
Bien que ce soit dimanche, je ne vous proposerais pas un prêche sur Josée de Chambrun, ni sur Violette Leduc, mais sur un personnage plus périlleux encore, sur le jeune Nizan de vingt-cinq ans, et son Aden Arabie :
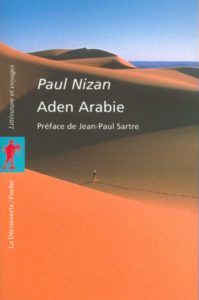 |
« En 1924, il y avait encore un homme : c’était Lucien Herr[4]. Quand on voyait ce géant penché sur une colline de livres, ces yeux sans brouillards au pied d’un front bossu, d’une sévère falaise de pensées, lorsqu’on entendait sa voix qui ne mentait jamais énoncer des jugements qui ne voulaient que cette fin juste : rendre à chacun ce qui lui revient, on savait qu’il n’était pas périlleux de vivre dans cette demeure crasseuse. Mais il mourut : il ne resta plus que l’École Normale, objet comique et plus souvent odieux, présidée par un petit vieillard patriote, hypocrite et puissant qui respectait les militaires[5]. »
Les liftings n’y faisant rien, je crois que nous avons aujourd’hui à la tête de l’État, un petit vieillard idéologique, patriote, hypocrite et puissant qui respecte les militaires ! Nous négligerons, pour ne pas froisser son Excellence, de demander au Général Pierre de Villiers, si la réciproque est vraie. ♦
_______________________________
[1] Josée de Chambrun, (1911-1992) fille unique de Pierre Laval, comédienne, elle épouse en 1935 le comte René de Chambrun, avocat international. Toute sa vie, Josée de Chambrun a soutenu son père, Pierre Laval. De l’ascension fulgurante au sommet de l’État jusqu’au procès dans la haine générale, elle a écrit, au jour le jour, dans des carnets intimes pleins d’admiration, le parcours d’un des acteurs les plus importants du régime de Vichy. En s’inspirant de ces notes, Yves Pourcher raconte à son tour cette passion exceptionnelle dans l’ouvrage historique Pierre Laval vu par sa fille.
[2] Violette Leduc (1907-1972) est une pionnière de l’autofiction, Violette Leduc fut une féministe, amie de Simone de Beauvoir. Elle a su dire les pièges et les faux-semblants dont étaient victimes les femmes de son temps. Succès tardif et éphémère en dépit d’une ‟sincérité intrépide” qui, d’après Simone de Beauvoir, a été sa marque de fabrique. Depuis L’Asphyxie (1946) jusqu’à La Chasse à l’amour (1973) elle publie, entre autres, L’Affamée (1948), La Bâtarde (1964), Le Taxi (1971).
[3] Jean Chalon, Journal de Paris 1963-1983, Vendredi 21 juin 1963, Paris, Plon, 2000, p. 24.
[4] Lucien Herr (1864-1926) bibliothécaire et intellectuel français. Bibliothécaire de l’École Normale Supérieure de 1888 à 1926, un des pionniers du socialisme.
[5] Paul Nizan, Aden Arabie, La Découverte/Poche & Syros, paris, 2002, p. 57-58.
Samedi 23 mars 2019
Marché à Neuvic de bonne heure et dans les nuages après une nuit assez étrange, plus peuplée de rêves que de sommeil !
Alaric est d’humeur joyeuse. Il me dit que sa fille est ravie du triple album d’Anne Sylvestre que je lui avais offert. Comme c’est la seconde fois qu’il évoque le plaisir de sa fille, je suppose qu’il aimerait bien que je trouve une autre friandise pour cette ravissante petite jeune fille. J’y ai songé, ce sera les cinq premières symphonies de Wolfgang Amadeus Mozart dont j’ai pu constater cette semaine que j’avais deux exemplaires du même disque. La première des symphonies composée par cet enfant prodige le fut à huit ans ! C’est le Mozart du ravissement.
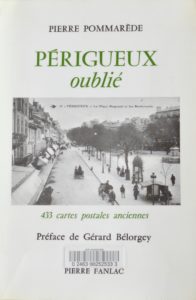  |
À la bibliothèque Charlotte Delbo de Montanceix où je me suis rendu en fin de matinée pour retirer Périgueux oublié[1] de Pierre Pommarède[2], préfacé par un ancien Préfet lettré de la Dordogne, Gérard Bélorgey[3], j’ai aussi emporté un ouvrage qui pèse 750 pages d’une fine écriture édité par La Lauze en 2018. En réalité, c’est le volume II, de cette étude intitulée Le rêve du sorcier, Antoine de Tounens, Roi d’Araucanie et de Patagonie (Une biographie) de Jean-François Gareyte[4]. Quel travail de fourmi pour réaliser deux volumes aussi conséquents sur ce personnage que je prenais pour un fac-similé des rois bouffons des ouvrages de Jacques Offenbach. Ainsi que l’écrivait Edgar Allan Poe : « Les hommes m’ont appelé fou, mais la science ne nous a pas encore appris si la folie est ou n’est pas le sublime de l’intelligence. » il n’est alors pas impossible que je me sois trompé sur le petit avoué de Périgueux qui repose au cimetière de Tourtoirac et qui demeure la gloire de ce beau village érigé entre Cubjac et Hautefort et que traverse l’Auvézère affluent de l’Isle. Antoine de Tounens[5] est encore, et pour longtemps, Roi de Tourtoirac !
 |
 |
|
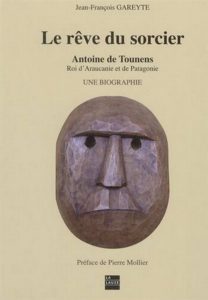 |
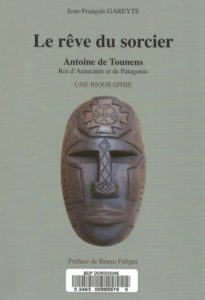 |
|
|
Merci à José Corréa pour nous autoriser la publication de son Antoine de Tounens Roi d’Araucanie et de Patagonie |
En évoquant hier, au téléphone, avec José Corréa, la belle Annie Delpérier (qui pour la première fois de sa vie s’apprête à nous faire de la peine) pour laquelle il avait posté le matin même un superbe portrait qui la caractérise magnifiquement dans sa rigueur, sa modestie (elle édite les autres, qui souvent ont bien moins de talent qu’elle en a pour écrire), sa bienveillance, il en vint à parler d’une récente invitation dans Périgueux, rue de la Clarté. Lorsqu’il fut sur les lieux, il comprit que cet appartement d’origine médiévale avait été celui de notre chère Lucienne Fabre-Doré, une artiste complète, au port royal. La beauté, le talent, le charme et toute la grâce de ces êtres qui traversent seulement une fois ou deux nos existences. Inoubliable Lucienne ! Je n’ai guère souvent désiré aussi impérieusement une relation. Nous restions toujours, en sa présence, sur les cimes du beau et du respect humain. Ce fut comme un beau conte de fée, cependant bien réel, et il n’est pas une seule personne pour l’oublier… Une autre fois je raconterai ce qu’elle fut pour moi et toutes nos amies qui adoraient sa compagnie.
 |
|
Lucienne Fabre-Doré dans son salon de Peyssard commune de Château-l’Évêque © photo Jean Alain Joubert |
Qui donc pourrait rivaliser avec les déesses que je viens d’évoquer ? ♦
_______________________________
[1] Pierre Pommarède, Périgueux oublié (433 cartes postales anciennes), préface de Gérard Bélorgey, Périgueux, Pierre Fanlac, 1988.
[2] Chanoine Pierre Pommarède (1929-2010), prêtre, érudit, président de la SHAP (Société Historique et Archéologique du Périgord de 1992 à 2007. Voir la page du site Les amis de la musique française.
[3] Gérard André Bélorgey (1933-2015), ancien élève de l’ENA, il a servi tour à tour dans des fonctions publiques et dans des responsabilités d’entreprises. Il a publié, sous des signatures variées, des ouvrages pédagogiques, des essais littéraires et diverses chroniques. Il fut préfet de la Dordogne de 1977 à 1980.
[4] Jean-François Gareyte est né à Paris en 1969. Il travaille actuellement comme médiateur culturel pour l’Agence Culturelle départementale de la Dordogne. Il est écrivain, auteur compositeur et interprète des chansons du groupe de Hard Rock « Sonoloco ». Dans la biographie indiquée au dos du volume II de son ouvrage sur Antoine de Tounens, on peut lire : « Il vient de passer ces dix dernières années à faire des allers-retours en Amérique du sud pour aller travailler dans les archives militaires, policières et diplomatiques Chiliennes à Santiago du Chili et Argentines à Buenos-Aires. II est parti à la rencontre des communautés Mapuches des deux côtés de la Cordillère des Andes, en Araucanie et en Patagonie pour écouter et récupérer les légendes qui sont, encore aujourd’hui, racontées par les « Machis » (sorcières), et les « Werken » (porte-paroles), du peuple Mapuche. Il a aussi longuement travaillé sur les documents d’archives de Périgueux, Bordeaux, Marseille, Paris, Londres et Montevideo et consulté des archives privées jalousement protégées depuis cette époque. Cette biographie sur Antoine de Tounens est le fruit de son travail. ». Jean-François Gareyte est aussi l’auteur de Gouffier de Lastours, seigneur de Hautefort (Périgueux, Éditions de La Lauze, 2002 – épuisé), L’Aube des Troubadours, la chanson d’Antioche du chevalier Béchade (Périgueux, Éditions de La Lauze, 2007 – épuisé).
[5] Antoine de Tounens (1825-1878), né Antoine Tounens le 12 mai 1825 à ‟La Chèze”, commune de Chourgnac. Cet avoué français devenu aventurier fut le fondateur de l’éphémère royaume d’Araucanie et de Patagonie et son premier roi sous le nom d’Orlie-Antoine 1er. Il était le dernier fils et le huitième des neuf enfants (cinq garçons et quatre filles) de Jean Tounens (1781-1862) et de son épouse Catherine Jardon (1787-1873). L’aisance relative de cette famille de paysans, lui permet de faire quelque étude, d’obtenir le baccalauréat et d’acheter une charge d’avoué à Périgueux. Son père Jean Tounens obtient en appel un jugement de la cour impériale de Bordeaux autorisant sa famille à rectifier son patronyme en y ajoutant une particule pour s’appeler désormais « de Tounens ». En 1857, Antoine de Tounens vend sa charge d’avoué et sa famille contracte un emprunt de 25 000 francs auprès du Crédit foncier de France en vue d’une expédition qu’il projette. Il est également reçu dans la franc-maçonnerie au sein du Grand Orient de France et de la loge « Les Amis persévérants et l’étoile de Vésone » de Périgueux, où il présente peu avant son départ pour le Chili son projet de création d’un royaume de la « Nouvelle France ». Après la fin du royaume en 1862, Antoine de Tounens s’exile en France. Bien que le royaume n’existe plus, il crée autour de lui une petite cour, attribuant ainsi décorations et titres ; il reprend également le titre de roi. Installé à Tourtoirac, il y meurt en 1878. N’ayant pas d’enfant, il laisse son héritage dynastique ainsi que ses titres à l’un de ses plus proches dignitaires, Achille Laviarde, après que son neveu, Adrien-Jean de Tounens ait renoncé à ses droits sur la succession de son oncle. Souce WikipédiA.
Vendredi 23 mars 2019
Est-il besoin d’écrire chaque jour ? C’est sans doute un excellent exercice pour la mémoire des mots, mais il est parfois contraignant.
Le printemps, le vrai ‒ pas le faux que nous eûmes en février ‒ s’impose royal et c’est une fête, un si joyeux rituel. Il nous fait croire que nous sommes éternels.
Je parlais hier des Joubert. Mon père adorait le coucou. Ce matin, pour la première fois de l’année, je l’entendais à l’ouverture des portes !
 |
| Jérémie Rhorer, chef d’orchestre©Jérémie Rhorer |
France musique. Du 21 au 30 mars, Jérémie Rhorer[1] dirige au théâtre des Champs-Élysées Ariane à Naxos de Richard Strauss. Ce jeune chef, co-fondateur du Cercle de l’harmonie, dit que la vibration du classique peut éveiller chez l’adolescent, y compris des milieux modestes ou défavorisés dont il est issu, une aspiration. Jeune homme, il admirait le ‟beau geste” des grands joueurs de tennis, comme McEnroe, Noah, ou Stefan Edberg. À la Maîtrise de Radio France, admirant Jessye Norman et Colin Davis, une magnifique vocation musicale se profilait…
On admire sa belle modestie, qui ne voudra pas imiter le côté sale petit bourgeois, d’enfant gâté et péteux, qu’incarne à la perfection “notre” président.
Le talent authentique est dépouillé de prétention. Il est plutôt fait de silence, de réflexion, d’intuition, excluant les démonstrations hautaines.
Ma trajectoire m’aura fait rencontrer des gens de tous autres milieux que le mien (fort modeste) parfaitement bien élevés, charmants, en définitive intelligents, mais aussi quelques vieilles mégères à la ride véloce, aux seins et aux fesses en déliquescence, qui tentaient, il se peut, de racheter un attrait désormais révolu par des minauderies et un mépris du pire aloi ! Pourquoi s’afficher en résidu vermoulu ? Multiplier les épouvantails “Belloubet” au jardin pourrait, il se peut, protéger la récolte 2019 de cerises, mais avec la mouche qu’attirent ces bouffissures en décomposition… le vers sera dans le fruit, pour lui conférer cette touche vinaigrée apparentée à leurs mauvaises manières !
Le vendredi 26 janvier 1973, Jean Chalon notait dans son Journal de Paris : « Florence Gould a été mordue au bras par un singe dans un restaurant de la Côte d’Azur. Voilà où conduisent les mauvaises fréquentations. Ce singe est devenu le plus célèbre de la Côte[2]. » ♦
__________________________________
[1] Jérémie Rhorer naît à Paris en juillet 1973. Il est l’un des chefs d’orchestre les plus enthousiasmants et polyvalents de sa génération, interprète reconnu de Mozart mais aussi d’oeuvres modernes. Il a fondé et dirige l’orchestre, Le Cercle de l’Harmonie, avec lequel il explore le répertoire des 18e et 19e siècles sur instruments d’époque et un diapason originel. Lauréat du Prix Pierre Cardin, Jérémie Rhorer est également un compositeur très respecté. Jérémie Rhorer a dirigé les orchestres internationaux les plus prestigieux. En tant que chef invité, on le retrouve dans les festivals internationaux les plus courus en Europe, comme Aix-en-Provence, Glyndebourne, Edimbourg, BBC Proms, le Festival de Salzbourg ou celui de Spolète. Avec Le Cercle de l’Harmonie, il défend de nouvelles interprétations d’oeuvres opératiques de référence dont, pendant l’été 2018, un Barbier de Séville de Rossini sur instruments d’époque au Festival International d’Edimbourg et au Musikfest Bremen. Source WikipédiA.
[2] Jean Chalon, Journal de Paris, 1963-1985, Paris, Plon, 2000, p. 124.
Mercredi 20 mars 2019
Premier jour du printemps, proclamé souverainement par un ciel limpide, tendu de bleu, illuminé par un soleil triomphant. « Dans la joie d’une journée ensoleillée, les idées cachées se matérialisent tranquillement. », August Macke.
René Depestre, est né en août 1926 en Haïti. Il poursuivit ses études en Sorbonne. Il a d’abord soutenu Fidel Castro en 1959, mais quittera l’île en 1978, suite à l’affaire du poète Heberto Padilla[1]. Dans les années 80, il s’installe à Lézignan-Corbières (Aude, Occitanie).
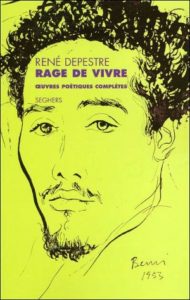 |
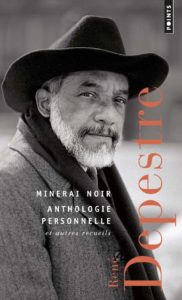 |
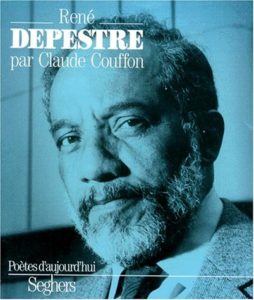 |
Aimé Césaire[2] préfaçant le recueil Végétations de Clarté en 1953, écrira : « René Depestre m’apparaît comme un Gouverneur de la Rosée. Il est le poète de la fraîcheur, de la sève qui monte, de la vie qui s’épanouit, du fleuve de l’espoir qui irrigue le terreau du présent et le travail des hommes… »
En 1968, dans sa Cantate d’octobre à la vie et à la mort du Commandant Ernesto Che Guevara[3], le poème intitulé Testament d’Ernesto Che Guevara est un hymne à la gloire de ce révolutionnaire qui inspire encore aujourd’hui les peuples en colères.
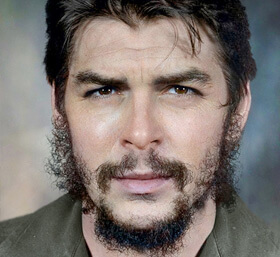 |
Long est le chemin du Che dans l’homme
Long le fleuve, long le sillon
Qui attend les semences, long
Le pas marin d’Ulysse, dans nos pas
Long le sabre végétal pour avancer dans la forêt inconnue !
En lui tout était mouvement
Explosion de lumière et de volonté.
À nos portes toujours nous aurons
Chaque matin son odeur de café fort
Et un grand besoin du Che toujours
Nous attendra dans l’arche du soir !
[…]
Il a parlé plus haut que les scandales de l’argent !
Plus haut que la Statue de la Liberté !
Plus haut que les actions achetées sur la santé de l’homme !
Il a parlé plus haut que les orgies des valeurs boursières !
Plus haut que la honte qui gratte le ciel de New York !
Plus haut que les mille espèces de fraudes et de mensonges
Qui ont écrasé contre son mur leurs fronts de rhinocéros ivres !
[…]
Il nous laisse un patio
Qui restera vert toute l’année
Il nous laisse un radar pour guider
Des roses vers le cœur de l’homme
Il nous laisse un écran où suivre
La marche de la beauté dans l’homme !
[…]
Il nous laisse un homme sans paix ni relâche avec lui-même
Tant qu’il y aura sur la terre
Un seul homme humilié !
[…]
En Périgord, nous eûmes un Jacquou le croquant insurgé contre une féodalité écrasante, sous la plume d’Eugène Le Roy. De tout temps se lèvent ceux qui contestent l’ordre abject du monde, l’inéquitable qui saigne le pauvre et goinfre le puissant. Eugène Le Roy fait déclarer à Jacquou, au dernier chapitre de son roman :
« La comparaison du passé et du présent nous enseigne que les gens ne se révoltent qu’à la dernière extrémité, par l’excès de la misère, et de désespoir de ne pouvoir obtenir justice[4]. » ♦
________________________________
[1] Heberto Padilla (1932-2000), poète cubain qui soutint la Révolution menée par Fidel Castro. Dans Fuera del Juego (Hors du jeu) il critique le régime de La Havane. Emprisonné en 1971, il fut contraint à une autocritique publique. René Depestre témoin de cette injustice, prendra la parole pour le défendre.
[2] Aimé Césaire (1913-2008), écrivain, poète, dramaturge, essayiste, homme politique français né à La Martinique. Fondateur du “Mouvement littéraire de la Négritude” avec Léopold-Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas, anticolonialiste déterminé, il sera député de la Martinique et maire de Fort de France de 1945 à 2001.
[3] René Depestre par Claude Couffon, Poètes d’aujourd’hui, Paris, Seghers, 1986, p. 146
[4] Eugène Le Roy, Jacquou le croquant. Bibebook. Édition du Kindle, chapitre 9.
Mardi 19 mars 2019
« Savoir, ce serait posséder le Père quand il nous fait si cruellement défaut[1]. »
Nous manifestions dans Périgueux aujourd’hui pour le maintien et la qualité des services publics, l’urgence sociale, avec les syndicats CGT, FO, FSU… Le cortège était passablement conséquent, ce dernier jour d’hiver affichant des bribes de soleil sans renoncer à la fraîcheur du vent… le printemps devra attendre un jour de plus pour claironner son avènement, lui qui nous rappelle combien nous fûmes jeunes et longtemps, peut-être encore, malgré les apparences ; si nous vivons dix ans de plus, il est probable qu’alors nous le penserons !
Le Père. L’absence du père, du père de notre père… Ce sentiment d’incomplétude taraude, me semble-t-il, beaucoup d’entre nous. On pourrait repenser à ce qu’en disait Madly Bamy, dernière compagne de Jacques Brel, bien des années plus tôt lors d’un symposium organisé par l’association Lune-Soleil à Plazac. Son propre père était un oiseau volage, le géniteur de toute une fratrie ; entre tous ces enfants et leur mère la cohésion était si grande que l’absent n’était qu’un paramètre d’ajustement !
Jamais nous ne pourrons définir et juger les caractéristiques profondes de cette absence : légèreté, séduction, peur, irresponsabilité, incertitude, immaturité…
Aussi je propose que ce qui fut, qui est un fait, sans doute souvent relativement mal interprété, soit reconnu comme tel et qu’en lieu et place d’amertume, de violence… nous invitions la gratitude et la tendresse pour ceux qui nous ont donné la vie.
Au retour de ce voyage tout autour de Périgueux, m’attendait le roman-témoignage de Jean Sénac sur celui qu’il qualifiait de « gitan violeur », Ébauche du père, pour en finir avec l’enfance (Gallimard, 1989).
 |
 |
Qui me connaît sait mon admiration pour l’écrivain Paul Nizan[2], or justement, la troisième citation en préambule à cet ouvrage, est de sa signature :
« Aussi longtemps que les hommes ne seront pas complets et libres, ils rêveront la nuit. » ♦
_________________________
[1] Jean Sénac, Ébauche du père, pour en finir avec l’enfance, Paris, Gallimard, 1989, p. 17.
[2] Paul-Yves Nizan (1905-1940), romancier, philosophe, journaliste français. Auteur de Aden Arabie (1931), Les chiens de garde (1932), Antoine Bloyé (1933), Le Cheval de Troie (1935), La Conspiration (1938), Chronique de septembre (1939).
Lundi 18 mars 2019
Henry David Thoreau, ce grand précurseur qu’il faudrait prendre l’habitude de fréquenter. Son Journal me parait être une source de méditations qui engagent à la sérénité autant qu’à de profondes réflexions.
Dans l’ouvrage de Thierry Gillyboeuf, Henri David Thoreau le célibataire de la nature[1] les citations extraites de ce Journal en tête de chapitres sont de toute beauté.
 |
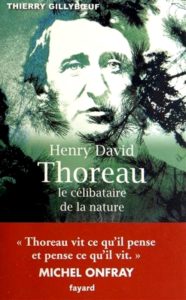 |
|
Chapitre I, Concord : « Je crois que je pourrais écrire un poème que j’intitulerais ‟Concord” [2].
Comme chapitres, j’aurais : la Rivière, les Bois, les Étangs, les Rues, les Édifices, et les Villageois. Et puis le Matin, le Midi, et le Soir, le Printemps, l’Été, l’Automne et l’Hiver, la Nuit, l’Été indien, et les Montagne à l’horizon.[3] »
Chapitre V, Sur le fleuve : « Comme le paysage le long de cette rivière est magnifique, comme il ressemble à ce que nous aimons lire des forêts de l’Amérique du Sud ! Quelle exubérance d’herbages, quelle profondeur d’alluvions sur ses berges ! Ces vieux rochers préhistoriques, géologiques, antédiluviens, seuls les échassiers, ces oiseaux primitifs qui s’attardent parmi nous, sont dignes de les fouler. La saison dans l’attente de laquelle il semble que nous vivons est arrivée. L’eau en vérité, ne reflète le ciel que parce que mon esprit le reflète ; lui sont semblables sa sérénité, sa transparence et sa tranquillité[4]. »
Chapitre VIII, Rien d’ancien ni de nouveau : « Y a-t-il une liberté désirable, si nous n’avons pas dans l’esprit la liberté et la paix, si notre être le plus profond, le plus intime n’est qu’un étang bourbeux et croupissant ? Souvent, nous sommes si ébranlés par les chagrins qui viennent du commerce des hommes que nous ne pouvons réfléchir. Tout ce qui est beau nous paraît se suffire à soi-même. Beaucoup de ceux qui se sont mêlés longtemps au monde et qui ont mal subi l’épreuve ne semblent n’offrir que des épines, n’être que dards et écorce, sans rien de tendre, de pur au fond d’eux-mêmes, sans que rien ne reste de l’homme.[5] »
Chapitre IX, La moelle de la vie : « C’est en vain que nous rêvons d’une solitude lointaine. Il n’en existe pas. C’est la tourbière dans notre esprit et nos entrailles, la vigueur primitive de la Nature en nous, qui nous inspire ce rêve. Je ne trouverai jamais dans les déserts du Labrador une solitude plus grande que dans certains coins de Concord, c’est-à-dire la solitude que j’y porte. Un peu de noblesse, un peu plus de vertu, rendrait la surface du globe partout émouvante, neuve, sauvage.[6] »
Il nous propose une autre manière d’envisager la vie dont il a fait en personne l’expérience concrète. Ne serait-il pas le créateur du fameux concept de ‟décroissance heureuse” :
« Il ne faut pas d’argent pour acheter ce qui est nécessaire à l’âme.[7] »
« Cultivez la pauvreté comme une herbe potagère, comme de la sauge. Ne vous souciez pas d’obtenir de nouvelles choses, que ce soient des habits ou des amis. Tournez-vous vers les anciens ; revenez vers eux. Les choses ne changent pas, nous changeons. Vendez vos habits et gardez vos pensées. Dieu verra que vous ne manquez pas de compagnie.[8] » ♦
________________________
[1] Thierry Gillyboeuf, Henry David Thoreau le célibataire de la nature, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2012.
[2] Concord est une ville historique, située dans le Massachusetts, dans le nord-est des Etats-Unis. On peut notamment y voir l’étang de Walden. Henri David Thoreau (1817-1862), essayiste, enseignant, philosophe, naturaliste amateur et poète américain, est né et est mort à Concord.
[3] Henry David Thoreau, Journal, 4 septembre 1841.
[4] Henry David Thoreau, Journal, 31 août 1851.
[5] Henry David Thoreau, Journal, 26 octobre 1853.
[6] Henry David Thoreau, Journal, 30 août 1856.
[7] Henry David Thoreau, La moelle de la vie, 500 aphorismes, anthologie établie par Thierry Gillyboeuf, aphorisme no 493, Mille et une Nuits no 500, 2009, p. 88
[8] Henry David Thoreau, La moelle de la vie, 500 aphorismes, anthologie établie par Thierry Gillyboeuf, aphorisme no 491, Mille et une Nuits no 500, 2009, p. 88
Dimanche 17 mars 2019
« Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur[1].»
Cette belle et calme propriété, à gauche, à la sortie du village de Montanceix lorsqu’on se dirige vers les Rolphies au sommet du plateau, était plus silencieuse depuis quelques mois. Sans doute à la manière dont le chanoine Pierre Pommarède l’écrivait pour évoquer le départ de notre amie Denise Robin, en 2001 : « le jour a baissé aux fenêtres, on a fermé la porte sur la route, avant que le fil ne se brise et que la corde ne se rompe au puits[2]. »
Depuis quelques semaines j’éprouvais une certaine inquiétude sur la solitude silencieuse de ces lieux. Mardi en fin de journée, en allant retirer l’ouvrage de Guy Desmaison à la Bibliothèque Charlotte Delbo, j’observais aux abords de la propriété un nombre inhabituel de véhicules. Hier matin, en ramenant cet ouvrage à la bibliothèque, le pressentiment se confirma, par la présence d’un grand nombre de véhicules. Ne recevant aucun des journaux locaux, j’ignorais donc que Guy Bastier s’était éteint mercredi 13 mars, le jour même où disparaissait le Père Roger Baret qui fut notre aumônier au Lycée Bertran de Born, ce que j’évoquerai un jour dans mes mémoires .
J’ai pu parler quelques minutes avec son plus jeune fils, Antoine Bastier, aujourd’hui Président du Conseil d’Administration et Administrateur de l’entreprise Chaux de Saint-Astier que je ne connaissais pas et qui préparait notre petite église, infiniment trop petite pour accueillir la foule qui, samedi après-midi, allait venir s’incliner devant cet homme qui fut le directeur des Usines à chaux de Saint-Astier et par ailleurs, et surtout, un authentique chrétien. C’est lui-même qui me disait : « J’ai mis ma foi en Christ et sans son intercession, il serait impossible d’atteindre au salut. » Il possédait une foi de charbonnier, mais si lumineuse qu’elle lui dictait toute sa conduite faite de gestes d’infinie bonté, d’attention aux plus modestes.
« Tout ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites[3]. »
Aujourd’hui je me suis rendu au cimetière de Montrem, devant la tombe familiale d’une grande simplicité qui accueillait ce serviteur de Dieu où il a rejoint son épouse décédée en 2002.
 |
Je l’avais rencontré parfois à des messes du Père Pommarède à l’École de Police ou à Montanceix, puis je lui avais rendu visite pour construire, sur le site des Amis de la musique française, un hommage à son ami le chanoine Pierre Pommarède. Le 9 août 2017, il m’avait confié ces quelques lignes : « J’ai rencontré Pierre Pommarède à la fin des années 40, à l’école Saint-Joseph à Périgueux. Notre amitié fut celle de toute une vie, le Père est le parrain d’un de mes enfants, et il était reçu dans cette maison tel un membre de la famille. Lors d’une fête réunissant la famille Bastier, le 10 juillet 2010, le père célébra une messe sous un chapiteau dans le parc. »
Ces dernières années, la santé du Père montrait des signes sérieux d’altération. Guy Bastier lui rendait visite rue Victor Hugo presque chaque jour au-delà de leurs échanges téléphoniques quotidiens. Le samedi 14 août, vers 18h00, alors qu’il arrivait chez lui, rue Victor Hugo, le Père lui avoua être très fatigué et avoir demandé au jeune remplaçant de son médecin de passer, ce qui advint assez tardivement. Guy Bastier devait, le lendemain, dimanche 15 août, trouver la pharmacie de garde pour se procurer la prescription médicale. Son ami le docteur Brachet lui fit aussi une visite dans la soirée et s’inquiéta de son état, tout en pensant que le médicament prescrit n’était pas adéquat à la situation qui lui semblait singulière. En le quittant, il l’invita à le rappeler si cela n’allait pas mieux, ce qu’il ne fit pas.
À 4h30 du matin, Guy Bastier fut réveillé par un appel du Père lui indiquant que se sentant beaucoup plus mal, il avait sollicité une hospitalisation, lui donnant quelques consignes pour son chien avant qu’il ne le rejoigne à l’hôpital en début de matinée.
C’est après avoir pris soin du chien vers 8h00, que Guy Bastier, arrivant à quelques mètres de l’entrée de l’hôpital reçut un appel l’informant du décès du Père, qui arrivé trop tardivement ne put subir l’intervention chirurgicale qui aurait pu le sauver d’une hémorragie interne. Le 15 août 2010 fut le jour de son rappel à Dieu.
Cette profonde compassion pour ses amis s’exprimait pour tous ceux qu’il savait dans les difficultés, le besoin, ne ménageant pas ses efforts pour servir avec humilité, générosité et discrétion son prochain. Une vraie vocation comme j’en ai peu connues. Disons, pour paraphraser le Père Pommarède, que sa préoccupation « c’était aussi pour visiter et se soucier, à l’hôpital ou chez elles, des personnes seules, âgées ou malades : des démarches, des attentions, une amitié que nous essayions, sans trop y parvenir, de lui rendre avec usure. C’était un Évangile qui se vivait au quotidien. »
Guy Bastier ne cachait pas que la disparition de son frère, il y a presque un an, l’avait beaucoup affecté. Il parlait volontiers et avec affection de son neveu, prêtre, qui a célébré, hier après-midi, l’office. J’ai toujours été étonné par son détachement, le peu de préoccupation qu’il avait de lui-même, il était humble et indifférent de tout ce qui agite les hommes. Sans doute même, comme il est dit dans Le Dialogue des Carmélites de Georges Bernanos : il était parvenu à être détaché de son propre détachement[4].
Il y a quelques années, j’ai vu toute cette famille prosternée, à genoux et en prière, pendant l’office, dans cette petite église, si simple, si modeste, à laquelle Guy Bastier a rendu hier un ultime hommage en signe d’affection.
Le lundi 20 février 2012, en la cathédrale Saint-Front de Périgueux, j’assistais à la messe de Sépulture du Père Jean Briquet que j’estimais comme nous tous qui le connaissions. Dans son homélie, Monseigneur Michel Mouïsse, Évêque de Périgueux et Sarlat, nous fit part de leur ultime rencontre : « Je n’oublierai jamais ses dernières paroles : c’était chez lui, dans sa maison familiale, rue Lamartine, le jeudi 9 février dernier vers 11 h 30, trois jours avant l’accident de santé qui l’a entraîné dans la mort. Alors que nous parlions fraternellement il eut, à la fin de notre échange, cette parole merveilleuse et qui trouve aujourd’hui son accomplissement : “Voyez-vous, j’en suis actuellement à une nouvelle étape de ma vie : c’est l’étape mystique dans laquelle je suis en lien avec le Père, par le Fils, dans l’Esprit et je Lui ouvre mon cœur pour qu’Il prenne toute la place en moi.” »
Ce fut, j’en ai la conviction, cette même union spirituelle que seul un homme de bonté et de prière peut avoir avant, pendant et après sa mort. Guy Bastier était et demeure avec Dieu. Dans sa vie comme dans sa mort il appartient au Seigneur. ♦
______________________________
[1] La Bible, Lettre de Saint Paul aux Romains, 14,8.
[2] La Bible, Ecclésiaste, 12, 2.
[3] La Bible, Matthieu, 25, 40.
[4] Le Dialogue des Carmélites, Georges Bernanos, Francis Poulenc. Première rencontre de la jeune postulante Blanche de la Force et de la très vieille Prieure du Couvent des Carmélites. Blanche : « Il doit être doux, ma Mère, de se sentir si avancée dans la voie du détachement qu’on ne saurait plus retourner en arrière. ». Réponse de la Prieure : « Ma pauvre enfant, l’habitude finit par détacher de tout. Mais à quoi bon, pour une religieuse, être détachée de tout, si elle n’est pas détachée de soi-même, c’est-à-dire de son propre détachement ? » C’est l’expression d’une forme extrême de l’engagement, forme dans laquelle l’engagement lui-même est engagé, c’est-à-dire remis entre les mains des hommes, et entre les mains de Dieu.
Samedi 16 mars 2019
Je n’évoque guère le nom de Chopin, si populaire cependant, davantage celui de Liszt, même si ses partitions orchestrales me gênent parfois par la sécheresse des percussions. Pour autant il y a dans l’immensité de ses œuvres pianistiques des pièces qui me troublent, telle cette Bénédiction de Dieu dans la Solitude, extraite des Harmonies Poétiques et Religieuses.
Je recevais avant-hier un double disque auquel je ne m’attendais absolument pas. Ce double album est cependant bien séduisant au premier regard et la pianiste, Ya-Fei Chuang, davantage encore.
 |
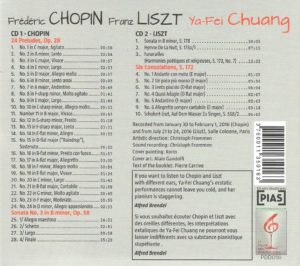 |
|
 |
 |
|
| Photos © Palais des Dégustateurs, Grenoble | ||
Un caviste passionné de musique, Eric Rouyer, du label Le Palais des Dégustateurs à Grenoble, m’adresse de temps à autre de pures merveilles, dont des enregistrements de musique française [Les Sonates pour violoncelle et piano de Gabriel Fauré, Charles Koechlin et le Chant élégiaque de Florent Schmitt, par Alain Meunier et Anne Le Bozec ; les Sonates pour violon et piano de Maurice Ravel, Francis Poulenc et Claude Debussy par le duo Gérard Poulet-Christian Ivaldi ; les Sonates pour violon et piano d’Albéric Magnard et César Franck interprétées par Gérard Poulet et Jean-Claude Vanden Eynden].
Puisque ce disque vient de sa cave enchanteresse, voyons de plus près… écoutons les 24 Préludes, opus 28 et la Sonate pour piano no 3 en si mineur, opus 58 de Chopin, puis la Sonate pour piano en si mineur de Liszt, Hymne de la Nuit, Funérailles et Six Consolations.
On s’éloigne vite de Bacchus pour s’asseoir à côté du Petit Prince de Saint-Exupéry à regarder passer les étoiles filantes, le temps est suspendu, presque irréel… aux confins de l’ineffable.
L’écoute se révèle de même nature que le concert Bach donné par Zhu Xiao-Mei à Paunat[1], il y a des années, où ‟la mécanique” se transforma en chant de louanges et de lumière atteignant des cimes insoupçonnées.
Pour autant, cette jeune femme n’aura pas eu à souffrir l’enfer traversé par Zhu Xiao-Mei.
C’est Alfred Brendel qui le dit : « Si vous souhaitez écouter Chopin et Liszt avec des oreilles différentes, les interprétations extatiques de Ya-Fei Chuang ne pourront vous laisser indifférents avec sa substance pianistique stupéfiante. »
Paraphrasant Jean Chalon, je dois avouer que ces pages de Chopin et de Liszt sous les doigts de Ya-Fei Chuang « me donnent parfois l’impression de boire un vin d’azur et de connaître enfin la griserie des cimes, une divine ivresse, celle que doivent éprouver les alpinistes parvenant au sommet des Himalayas[2]… » ♦
________________________
[1] « L’abbatiale de Paunat (Dordogne) s’enlisait dans une pâleur grise de déclin du jour après les foudres et les feux d’un orage de fin d’après-midi, ce vendredi 7 août 1998… les organisateurs s’affairaient, aucune nouvelle rassurante ne leur parvenant des mages attachés à la fée électricité, l’inspiration vint à leur secours : la Dame de lumière défaillante fut remplacée par une multitude de cierges. Dans cette atmosphère quasi religieuse, la pianiste Zhu Xiao-Mei fit son entrée et vint s’asseoir au piano. Son interprétation des Variations Golberg, à la lueur des cires ancestrales, dans un absolu silence, se fit communion intime. Immanence de l’indicible, du sacré. Je n’écoute pas volontiers Bach que mes sens auditifs perçoivent tel un mouvement de parfaite horlogerie. Mais j’avoue, ce soir-là, avoir été saisi par l’intense émotion qui jaillissait d’un jeu nourri de l’intérieur par une expérience humaine tragique et bouleversante. »
[2] Jean Chalon, Journal d’un arbre, 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 60.
|
|
Vendredi 15 mars 2019
« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire » écrivait Henri Bergson. La passivité de l’humanité, si maltraitée par ses gouvernants il est vrai, l’a conduite aujourd’hui, au seuil d’un gouffre, celui d’un risque majeur pour la planète.
L’artiste Stéphanie Moraly, maman d’un adorable petit Solal, partage dans un message ce proverbe Indien : « Nous n’héritons pas de la Terre de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. »
Quel usage avons-nous fait du prêt qui nous a été fait ? Quel usage en ont fait les grands prédateurs économiques de la planète, ces Premiers de Cordées aux mains sales ?
Les écologistes de tous bords et trop souvent de celui que j’appelle “l’extrême centre”, sujets prompts à se jeter dans la ruée vers l’or d’un ministère, finissant par plomber en définitive toutes les espérances écologiques qu’ils sont sensés défendre, ceux aussi qui aboient sur “l’extrême gauche” comme sur “l’extrême droite” tout en démontrant manifestement une agilité sans égale à trahir, vont entrer en action samedi. Les deux ministres “écologistes” d’Emmanuel Macron ‒ personnage schizophrénique, au langage variable et adapté à ses différents publics, affirmant une chose et réalisant son contraire avec une aisance stupéfiante – se sont déconsidérés et ne sont plus crédibles. Quant à lui, que ferions nous de cette sorte de “boule puante”, de ce nombriliste qui ne sert que des intérêts trop visiblement personnels ou catégoriels et indignes de cette fonction ?
Bien évidemment, nous nous sentons en adéquation avec des slogans habituels, tels que : « Le climat avant le profit » et bien entendu : « Macron, moins de com, plus d’action ! ». Je ne doute pas que certains écologistes aient des convictions et de l’honneur. Par contre, je ne pardonne pas à ceux qui, sachant quelles étaient les orientations désastreuses d’un ministre du budget, lui ont fait confiance au premier tour de l’élection présidentielle de 2017. Personne n’est obligé d’être aveugle à ce point qui relève soit d’une abjecte fourberie, soit d’une sacrée dose de crétinisme !
 |
||
Aussi ma confiance ne va globalement pas aux écologistes, qu’ils soient danseurs ou acrobates, mais aux lycéens et étudiants qui manifestent aujourd’hui. Eux sont conscients de l’urgence écologique, car leur futur en dépend irréversiblement. Ils n’attendent aucun poste ministériel, aucun profit personnel, aucune faveur, sauf celle de pouvoir continuer à vivre sur cette planète ; ils font uniquement entendre leur désarroi, leurs inquiétudes, malheureusement justifiées. Et nous n’aurions pas à cœur de leur offrir notre soutien de parents désenchantés autant que fautifs ? Télérama no 3609 du 16 au 22 mars 2019 pose la question, Les jeunes pousses vont-elles sauver la planète ?
Il est impératif qu’elles y parviennent nos « jeunes pousses », car oui elles seront là pour beaucoup d’entres elles quand nous n’y serons plus !
L’exemple de la jeune suédoise Greta Thunberg et de son idée de grève scolaire mondiale pour le climat est mobilisateur. L’objectif est de dénoncer l’inertie des gouvernants face à l’urgence climatique. Comment ne pas applaudir à sa déclaration à la COP24 en Pologne : « Pourquoi devrais-je étudier pour un avenir qui pourrait bientôt ne plus exister, alors que personne ne fait rien pour sauver cet avenir ? » La jeunesse se trouve confrontée à devoir assumer cette inaction révoltante, honteuse, calamiteuse devant l’irresponsabilité du capitalisme vorace.
Cette problématique n’est pas si récente, l’INA nous a rendu le document télévisuel de 1979 où Haroun Tazieff évoquait le réchauffement climatique face au commandant Cousteau qui contestait (?) la vision de cet observateur minutieux.
Pour Piero Amand[1], « il faut informer et déconstruire les mythes de notre société, comme l’importance de la consommation. » Une décroissance heureuse, assumée fait son chemin d’autant qu’elle ne saurait être désormais une alternative. L’effort ne saurait être modéré, « c’est un effort de guerre » dit Nicolas Hulot. Sont discutées les études de Pablo Servigne[2] sur l’effondrement de la civilisation industrielle. La défiance vis-à-vis des politiques s’exprime librement. Un étudiant en licence de Sciences Politiques à la Fac de Saint-Denis, Félix, déclare : « Il y a un siècle, les ouvriers se sont battus pour leurs droits sociaux, il va falloir nous battre pour le droit à un air pur, pour le droit à la beauté du monde[3]. »
Le système débridé et fou du capitalisme libéral est suicidaire et meurtrier vis-à-vis de populations entières, il est totalement incompatible avec l’écologie. Et Greta Thunberg de déclarer à la COP24 : « Si les solutions sont introuvables à l’intérieur du système, peut-être devons-nous en changer[4]. » ♦
_______________________________
[1] Piero Amand, 17 ans, a cofondé le collectif ‟Wallon Génération Climat”. Avec l’organisation flamande ‟Youth for Climate”, ils sont parvenus à faire descendre dans les rues, chaque jeudi depuis début janvier, des milliers de lycéens et étudiants belges. Un raz-de-marée. Les grévistes attendent peu des politiques
[2] Pablo Servigne, né en 1978, est un chercheur français indépendant et transdisciplinaire. Il est ingénieur agronome et docteur en sciences. En 2008, il quitte le monde universitaire pour se consacrer au mouvement de la transition écologique, à l’agriculture urbaine, la permaculture et l’agroécologie. Entre 2010 et 2014, Pablo Servigne travaille à l’association d’éducation populaire ‟Barricade” à Liège. Aujourd’hui indépendant, il écrit des articles et des livres, donne des conférences et des formations. (d’après WikipédiA).
[3] Télérama no 3609 du 16 au 22 mars 2019, p. 22.
[4] Ibid., p.22.
Jeudi 14 mars 2019
« Je me sais condamné par le rire des foules à des heures sans pain. », Jean Sénac.
La réédition chez Actes Sud (836 pages) des œuvres poétiques de Jean Sénac (1926-1973) rassemblées initialement en 1999, nous rappelle l’artiste engagé et sa mort tragique.
 |
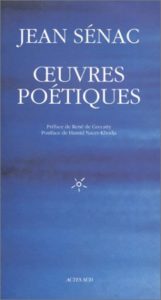 |
 |
 |
|||
Citoyen français, il est du nombre des poètes maudits, dont le destin fut violemment interrompu dans la nuit du 29 au 30 août 1973, sans que l’on sache qui en fut véritablement le ou les commanditaires[1], reclus dans sa ‟cave-vigie” qu’il occupait rue Elisée-Reclus, à Alger, « retrouvé poignardé, les bras en croix, sans qu’on puisse jamais déterminer avec certitude l’objet du crime[2]. ».
Né dans la région oranaise de père inconnu qu’il qualifiera de ‟gitan violeur”[3] et d’une mère catalane dont il portera le nom de Comma avant de prendre par adoption et gratitude celui de son beau-père temporaire Edmond Sénac, père de sa demi-sœur Laurette. Il se fera également appeler Yahia El Ouahrani (Jean l’Oranais), pseudonyme sous lequel il publia son recueil, Aux héros purs.
Défenseur de la première heure de l’Algérie indépendante[4] il se lie d’amitié avec des personnalités majeures du mouvement nationaliste dont Larbi Ben M’hidi qui deviendra l’un des principaux chefs de guerre du FLN, rêvant d’un pays multiculturel et tolérant, ce qui le rapprochera d’Albert Camus. Sorte de « héros sacrificiel de la liberté individuelle et, d’une certaine manière, de la libération du peuple colonisé auquel il a prêté sa voix[5]… »
Les fabricants d’honneur dans leurs néons sécrètent
Confetti, serpentins pour enrayer tes muscles.
Peuple, sur ta douleur ils arc-boutent leurs ruses,
Avec ton sang déjà ils fondent leurs privilèges.
Ils font de leurs erreurs, de leur inculture tes lois.
Ils te méprisent au point de te forger des rêves
pas plus audacieux que les larmes anciennes.[6]
À la fois libertaire, socialiste, chrétien, païen, panthéiste, homosexuel à la sensualité subversive, doté d’une passion solaire pour la fraternité, ‟médium marginal et prodigieux”, sa trajectoire et sa disparition préfigurent celle Pier Paolo Pasolini (1922-1975) et ne manquent pas de faire référence à celle du poète Federico Garcia Lorca (1888-1936).
Sénac, bon dessinateur, a toujours été sensible aux arts plastiques et a même envisagé une formation aux Beaux-Arts.
Ses références littéraires : Hugo, Camus, Char (son maître formel), Bonnefoy. Lorca demeure son mentor de lyrisme et du refus des discriminations. Il chemine volontiers avec Baudelaire et Verlaine (avec lequel il entretiendra peu à peu une ressemblance physique) Mais encore Genet et Ginsberg, Cavafy et Walt Whitman.
Chantre de l’Algérie en dureté et exaltation, l’irréductible jeunesse de cette poésie se nourrit de terroir et de soleil.
La phrase de Jean Renoir sur Pasolini est d’une percutante pertinence lorsqu’on évoque la trajectoire de Jean Sénac : « Ce qui fait scandale… c’est sa sincérité. » ♦
___________________________
[1] « Mohamed Briedj, qui est arrêté, était un ami de Sénac. Pourquoi l’aurait-il tué ? Toujours est-il que c’est lui qu’on interpelle, mais libère au bout de quelque temps. » À noter qu’« un an auparavant, son émission littéraire à la radio algérienne, rebaptisée Poésie sur tous les fronts, avait été suspendue. « Que me reproche-t-on au juste ? se demandait Sénac. De ne pas être dans mon travail, dans ma vie sociale, ma vie privée, un larbin apeuré et servile ? De ne pas manier la prose à reluire. » Ses amis français, Serge Tamagnot et Françoise d’Eaubonne, tenteront en vain d’attirer l’attention sur un procès bâclé. Après avoir placardé des affiches dans le Quartier latin, Serge Tamagnot sera victime d’une tentative d’assassinat à son tour. Le silence avait-il gagné ? », Jean Sénac par René de Ceccaty et Éric Sarner, Les Lettres Françaises no 93, 3 mai 2012, p. II.
[2] Marine Landrot, Œuvres poétiques, Jean Sénac, Télérama n° 3607 (du 2 au 8 mars 2019), p. 56.
[3] Jean Sénac, Ébauche du Père. Pour en finir avec l’enfance, Roman, Paris, Gallimard, 1989. « ‟Il faudra que j’écrive ce soir des non-sens superbes qui me délivrent de mon mal.” Jean est le Bâtard, un titre dont la scandaleuse musique a l’air de l’enivrer en même temps qu’elle le terrorise. Le vivre en risque de Sénac commence là, si c’est possible. » (Jean Sénac, poète assassiné, publié sur www.revue-ballast.fr).
[4] « Profondément engagé pour la lutte de la libération du peuple algérien, Jean Sénac ne joua pas de la même manière le rôle politique qu’avait tenu, presque au même moment, Pasolini en Italie : il était idéaliste, confiant dans son aspiration à la justice quand, chez Pasolini, le désespoir et le besoin de dénoncer primaient. », Les Lettres Françaises no 93, 3 mai 2012, p. II.
[5] Les Lettres Françaises no 93, 3 mai 2012, p. II.
[6] Jean Sénac, poème intégré au recueil Matinale de mon peuple.
|
|
Mercredi 13 mars 2019
Je m’entretenais téléphoniquement ce matin avec Guy Desmaison, l’auteur de L’enfant noir du camp américain de Chamiers[1].
L’actrice qui anime la bibliothèque Charlotte Delbo de Montrem-Montanceix m’a procuré hier, en fin d’après-midi, ce livre que je recherchais. Il nous arrive de la Bibliothèque de Mussidan avec une dédicace de son auteur. Je n’aurai pas besoin du délai habituel d’un mois pour le lire. Je l’ai dévoré d’une traite hier soir avant d’aller me coucher, bouleversé par ce récit.
C’est la seconde fois de ma vie que je ne lâche un livre seulement qu’une fois achevé. La première fois c’était le livre de Jacqueline Lang, La Rose et la Bleue, histoire du voyage périlleux de ses deux filles en train, pendant la Seconde Guerre Mondiale, dans une cachette sous le plancher d’un wagon Paris-Agen, afin de les soustraire aux rafles des enfants juifs dans Paris.
Guy Desmaison dans la dédicace qu’il fit à la Bibliothèque de Mussidan, le 10 décembre 2014, précise bien qu’il s’agit d’un « témoignage de l’émouvante histoire d’un camarade de travail de Mussidan ». D’ailleurs le préambule de l’auteur pour son ouvrage est parfaitement explicite : « À la mémoire d’un camarade de travail dont la vie tumultueuse et parfois douloureuse m’avait fortement impressionné et qu’au-delà de sa merveilleuse histoire d’amour, tout le racisme et l’incompréhension dont il fut victime puissent être bannis à tout jamais pour que les hommes puissent enfin vivre en toute égalité sans distinction de race ni de religion[2]. »
Guy me confirme que quelques lieux sont partiellement imaginaires et les noms propres sont masqués si ce n’est le prénom de l’enfant noir, Alphonse, et encore ceux de quelques-uns des soldats du second Camp américain que les sportifs ont pu applaudir au CAP et qui épousèrent parfois des françaises.
Alphonse et sa seconde épouse ne sont plus de ce monde depuis quelques années, mais Guy Desmaison nous conte une histoire sombre et belle, bien réelle. Il est à la fois historien d’un temps qui nous est commun et dont il fut le témoin direct et, ce qu’il ignore sans doute, doté d’un talent de romancier que je ne possède pas. Par exemple il m’avoue que le si sympathique et généreux personnage au prénom de Jean, grand frère de Marie, est une fiction. Il dit que ce n’est pas lui (dissimulé sous ce personnage), manifestant son estime et son amitié pour Alphonse, mais je gage qu’il incarne quelques unes de ses spécificités humaines, sorte d’ange libertaire et tendre.
L’intérêt de ce témoignage est déjà de retracer, dans sa première partie, l’historique de ce Camp.
 |
1918 : arrivée des américains (Yankees ou Sammies) à Chamiers lors de la Première Guerre Mondiale de 14-18. Un certain nombre d’entre eux furent logés à La Cité Bel Air où j’ai passé les 12 premières années de mon existence (1948-1960), rue des Américains, aujourd’hui rebaptisée rue John Kennedy ! Nous avions de la famille rue de la Somme. Les États-Unis nous cernaient : rues du Texas, de Chicago, de la Louisiane, de Floride, Franklin, Lindbergh, Edison…
1920 : départ des américains et installation des Ateliers Ferroviaires et de quelques entreprises, la S.O.M.U.A., la P.L.M. (Groupe Schneider) et la société F.O.R.C.L.U.M.
1952-1966 : Guerre Froide et le retour des américains. Seconde vie du Camp où travaillèrent de nombreux périgourdins. On conserve le souvenir de ses portes ouvertes avec distribution de chewing-gums, de Coca-Cola, cigarettes, corned-beef… Je connus un peu cette période puisque mes parents venaient de faire construire une maison, rue John Kennedy (une habitude), à ‟La Familiale” à Chamiers, en dessous de Castel Fadèze, où résidaient les officiers américains ! De ce temps me vient mon admiration pour les lignes fuselées des Studebaker, Chrysler, Chevrolet et autres Pontiac qui circulaient dans Périgueux. Les américains contribuèrent au succès de l’U.S.P. avec en particulier les basketteurs Charly Tucker, Langston et Antébi.
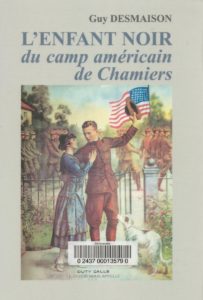 |
 |
|
La seconde partie de l’ouvrage est consacrée à la trajectoire d’Alphonse, l’enfant noir du premier Camp américain, fils d’un soldat noir américain qui repartit sans connaître sa paternité et d’une française, qui fille-mère (fait hautement réprouvé en ce temps) remit son fils à l’Assistance Publique où il passa ses quinze premières années, sous les quolibets de ses camarades. Dans ces années, la négritude était rarissime dans nos contrées !
Né en 1919, Alphonse fut alors placé dans une famille bourgeoise des environs de Mussidan que l’auteur dissimule sous le nom de Sardier. Il était affecté avec d’autres à l’entretien du grand parc et des terres de cette propriété. C’était une famille généreuse, profondément humaine qui fut une bénédiction pour le jeune orphelin et lui donna à la fois une structure, une dignité et beaucoup d’attention. Cette famille sera à ses côtés tout au long de son existence, comme d’excellents parents adoptifs.
Afin d’assumer sa vie d’adulte, il fit son entrée à la SNCF où il fut bien accueilli et où sa robustesse et son sérieux lui permirent d’être un élément remarqué et apprécié. C’est alors que l’amour se manifesta, « Je m’appelle Élisabeth et j’habite Saint-Louis », premier amour puissant et tendre, mais espoir cruellement déçu par un père borné : « …je ne m’attendais pas à ce que ma fille soit amoureuse d’un noir… tant que je serai en vie notre fille ne se mariera jamais avec un nègre, il en va de notre réputation, je n’oserais jamais vous présenter à notre famille ou à nos proches comme gendre et je ne voudrais pas qu’elle devienne la risée de tout le village avec des expressions dégradantes […] De plus, je ne me vois pas avec des petits-enfants noirs devenant la risée de leurs petits camarades dans la cour de l’école[3]. »
Ce coup de tonnerre anéanti les amoureux qui ne se virent plus. Alphonse demanda un poste de “taupier” sur la section de chemin de fer Bergerac-Saint-Foy-la-Grande afin de s’éloigner de Mussidan où il doubla, par des contraintes lourdes, son salaire.
Humiliation et sourde tristesse s’estompèrent un peu. Et, il y eut Marie, une belle jeune fille éperdument amoureuse de lui, des parents chaleureux et accueillants ; la belle église de Souzac accueillit leur mariage, fin 1941. Ils trouvèrent une jolie petite maison pour y loger leur amour.
1944-1945. Mussidan se trouva dans la tourmente de la fin de la guerre, sabotages, exécutions d’otages y compris d’enfants (52 victimes), assassinat du maire Raoul Grassin… la ville en fut gravement meurtrie et traumatisée.
Puis ce furent les premières vacances à Soulac et neuf mois après ce temps de liberté et de bonheur, naissait leur fils.
Élisabeth, son premier amour, de son côté avait obtenu une promotion professionnelle chez Marbot, à Neuvic, s’étant repliée sur cet impossible amour.
Marie, l’épouse aimée fut frappée par une leucémie qu’on traitait à cette époque uniquement par des transfusions sanguines. Une seule transfusion fut possible. Marie s’en alla doucement, laissant Alphonse et son fils de 11 ans dans une peine cruelle, entourés par la famille Sardier et les parents de Marie.
La vie d’Alphonse aurait pu être définitivement tragique.
Il y eut cependant une bonne étoile après les épreuves. Survinrent deux évènements qui illuminèrent la vie d’Alphonse.
Je laisse à Guy Desmaison le soin de vous les conter.
Si c’est une histoire vraie qui se passa entre Mussidan, Sourzac et Saint-Louis en l’Isle, il n’en demeure pas moins qu’elle est l’œuvre d’un romancier qui a l’art de vous troubler comme de vous enchanter. J’en ai fait l’expérience hier soir !
Je rends ce livre samedi à la bibliothécaire de Montanceix, alors n’hésitez pas à l’emprunter ! ♦
_____________________________
[1] Guy Desmaison, L’enfant noir du camp américain de Chamiers, Périgueux, Nouvelle Imprimerie Moderne, 2014, 110 pages.
[2] Guy Desmaison, Ibid., p. 5.
[3] Guy Desmaison, Ibid., p. 38-39.
|
En réfléchissant au livre de Guy Desmaison, je me dis que de rendre ainsi hommage aux gens simples qui, malgré leurs épreuves, parfois très lourdes, réussissent une vie heureuse et harmonieuse, est un devoir et une marque profonde d’attachement, pouvant prouver à toutes les lucioles prétentieuses et grotesques, ainsi qu’à ceux qui seraient tentés par les scintillements du miroir où se prend l’alouette, qu’il y a une authentique manière de vivre — avec simplicité, intelligence, amour, y compris dans une petite maison de garde-barrière — qui dépasse de beaucoup, par sa beauté, les fastes de Versailles. |
|
Ma Ville, magazine de la ville de Coulounieix-Chamiers, n° 97 de mars 2019, sous une photographie de Guy Desmaison, nous « informe que depuis début janvier 2019, huit seniors (de la commune et de l’agglomération) et quinze jeunes (classe de Segpa du collège Jean- Moulin) s’intéressent à l’histoire du Camp américain, dans le cadre du projet[1] piloté par l’association Ciné Cinéma ‟Bas-Chamiers, un parfum d’Amérique : du Camp US aux cultures urbaines”. Jusqu’en avril prochain, à travers des recueils de témoignages, des recherches d’archives, des rencontres avec des professionnels, des visites sur site, ils vont mener un travail qui s’attachera autant à l’histoire passée du site qu’à son devenir. Des vestiges gallo-romains, à l’occupation des lieux par les Américains lors des deux guerres mondiales, jusqu’au futur pôle de l’Economie sociale et solidaire et des cultures urbaines… la matière est dense ! Un projet à suivre sur les réseaux sociaux avant une projection sur grand écran. C’est en effet l’une des spécificités du projet, comme l’explique la coordinatrice Julia Caron : « les participants filment et photographient leur travail pour le partager au fur et à mesure sur Facebook, Instagram et Youtube. Ils ont reçu les conseils de Barbara Cassiau, vidéaste professionnelle, qui filme par ailleurs toutes les étapes du projet : un moyen-métrage sera diffusé au grand public avant l’été. Les groupes sont accompagnés par Isabelle Plénat, coordinatrice du Comité ‟Mieux Vivre Ensemble” (centre social St-Exupéry), Alain Daneau, formateur retraité spécialisé dans l’aménagement du territoire et Annick Bruchet, professeur d’histoire au collège. Au cours du projet, jeunes et seniors se rencontreront à plusieurs reprises pour partager les informations récoltées. » ___________________ [1] Projet retenu par la Drac Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’appel à projet « Je like mon patrimoine #3 ». Contact : Ciné Cinéma, 05.53.09.40.99 et à suivre sur les réseaux sociaux : bas-Chamiers |
Lundi 11 mars 2019
Visite hier après-midi de Marie Chantal accompagnée d’Ana, sa nouvelle voisine. Ce n’est pas tous les jours qu’il m’est donné d’évoquer Fernando Pessoa (1888-1935) et ses hétéronymes, le café A Brasileira à Lisbonne, l’Algarve, ses falaises où les vagues viennent se fracasser, la vallée du Douro et le trop oublié artiste Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918), disparu à l’âge de 30 ans au sommet de son art.
 |
|
|
| Fernando Pessoa, Café A Brasileira©Lisbonne.net | Amadeo de Souza-Cardoso©FCG Biblioteca de Arte | |
Nous avons évoqué auparavant les médecines naturelles, les remèdes pour le foie, la vésicule… et aujourd’hui avec Marie Annick nous causions d’un thérapeute qui est domicilié à Bourrou, non loin d’ici, praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise et enseignant de Qi Gong. Formé et diplômé par l’Académie Wang (Diplôme de Tui Na, diplôme de praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise, cursus de base et cursus supérieur), il est également Instructeur Associé de l’école de Qi Gong de Mantak Chia.
 |
||
Né en 1927, Michael Gielen, chef-d’orchestre, est décédé à 91 ans le vendredi 8 mars 2019. Mahlérien d’exception, comme Claudio Abbado, il laisse une intégrale de référence, rééditée en coffret, ainsi que ses autres enregistrements, publiés chez Hänssler Classic. Il avait par ailleurs dirigé la création mondiale de plusieurs œuvres importantes du XXe siècle, notamment le Requiem de Ligeti et, à Cologne en 1965, Die Soldaten de Zimmermann.
Considérée comme référence, j’avais déjà fait l’acquisition de sa version de la huitième symphonie de Mahler, dite des ‟Mille” enregistrée en 1981, diffusée dans la collection ‟Essential Classics” de Sony.
La création de la septième symphonie sous la direction du compositeur fut un succès incontestable, ce qui ne fut pas toujours le cas pour les autres. Les interprétations enregistrées que nous connaissons n’emportent pas une totale adhésion. Les deux « Nachtmusik » qui encadrent le scherzo sont souvent interprétées de manière fade ou ennuyeuse donnant l’impression d’inaboutissement, ce qui a pu faire classer cette symphonie au rang des mal-aimées.
La version de la septième symphonie de Mahler par Michael Gielen est une des rares à être convaincante, il lève tous les obstacles par une direction investie, fouillée, réhabilitant cette œuvre majeure du répertoire symphonique.
Malgré le vent, j’ai fait un retour sérieux et efficace au jardin pour la traditionnelle taille de printemps, bénéficiant du soleil comme j’en avais pris l’habitude depuis 1985 ! ♦
Samedi 9 mars & dimanche 10 mars 2019
Temps mouillé, ciel plombé.
Le marché du samedi matin à Neuvic ne manquait cependant pas d’agrément. J’y rencontrais le couple Biret. Maurice[1] est l’auteur, ou le co-auteur, de plusieurs ouvrages sur des personnages ou des villages du Périgord.
 |
||
Maurice Martin du Gard[2], dans un chapitre de ses Mémorables, intitulé « Derème[3], en passant » (octobre1920), trace un portrait de ce personnage infiniment attachant, quelque peu lunaire. Il apparaissait chez l’éditeur Paul assez régulièrement vers 18h00 soit pour une petite avance soit pour voir la progression de ses épreuves. Martin du Gard évoque ce personnage vêtu de sa pèlerine noire, un melon noir sur la tête, illuminant ainsi son portrait : « … les yeux vifs, le nez retroussé, une bouche malicieuse et gourmande, c’est Marmande où il naquit, et dès qu’il parle : le soleil. […] Avec Derème on se sent toujours un peu à la terrasse, jamais très loin de la Garonne. C’est à Toulouse – son père y était colonel – que Derème en 1909 publia ses Ironies Sentimentales, à Agen que Francis Carco stimula ses premiers essais, ah ! il est bien du Midi, mais d’un Midi qui ne chante pas à tue-tête, qui bavarderait à mi-voix[4]. »
J’ouvre un petit volume publié à Tarbes en 1925, La Bride et le cheval ou Le souvenir de Jean-Marc Bernard avec cette dédicace de Tristan Derème :
J’ai vu le jour au bord d’un fleuve
C’est la Garonne, à l’aube neuve.
Comme Léo Latil, poète et ami de jeunesse de Darius Milhaud, Émile Despax, tombera au front. « Derème, ce soir, m’a gentiment parlé d’Émile Despax, mort à la guerre, qui, sous-préfet d’Oloron, écrivit sous ses glycines des vers tendres et oppressés qui lui survivent[5]. »
Maurice Martin du Gard fait ensuite l’éloge du poète aimé de Claude Debussy, Paul-Jean Toulet, qui repose au cimetière de Guéthary où nous fûmes d’effrontés visiteurs. Martin du Gard l’évoque par une lecture de quatrains qu’il fit à Paul Valéry laudatif !
Emporté par la facilité, Derème n’ignore point les cimes qu’atteint son ami Paul-Jean Toulet et Martin du Gard d’ajouter : « Il s’amuse, lui, quand Toulet ne s’amuse plus depuis longtemps, c’est la compensation temporelle[6]. »
Nulle mention dans les Mémorables de Charles Derennes[7] qui repose au cimetière Sainte Catherine de Villeneuve-sur-Lot. Son Bestiaire sentimental, série de trois essais, Vie de Grillon (1920), La Chauve-Souris (1922), Émile et les autres (1924), l’avait popularisé auprès du grand public, succès confirmé par ses romans Mouti, chat de Paris (1926), et Mouti, fils de Mouti (1927), et de nouveaux récits réunis dans le volume Dieu, les Bêtes et Nous. Les Porte-Bonheur (1930). Son observation à la fois attentive, passionnée, tendre et émerveillée d’animaux qui ont peuplé son univers depuis l’enfance (grillons, chauves-souris, chats, grenouilles…) devrait suffire à lui attribuer une place dans la littérature française et plus encore dans nos cœurs, en un temps ou l’écologie revêt une importance primordiale.
Oubli impardonnable pour notre patrimoine que la non réédition de son récit autobiographique, L’Enfant dans l’herbe (Ferenczi, 1925), qui est un pur joyau. Au début des années 2000 les Éditions Yago avaient réédité Le Pèlerin de Gascogne (1918) contes et récits d’un amoureux des Landes, ouvrage riche d’anecdotes et de notes pittoresques.
Alors, l’heure ayant passée, Maurice Martin du Gard congédie, avec affection, le charmant Derème : « Il reprend ses papiers, ses journaux, ses revues, file sur un dernier calembour, la voix sonore, l’œil doré de gentillesse, bohème et bourgeois, chef de l’École fantaisiste, il est heureux, il a faim, il rentre à Passy qui pour lui, le jour, est une petite ville et, la nuit, un peu la lune. »
 |
 |
|
| Tombe de Tristan Derème (Philippe Huc), Saint-Pée d’en haut (Oloron Sainte-Marie) | Tombe de Jules Supervielle, cimetière de Saint-Pée d’en-Haut (Oloron Sainte-Marie) | |
Tristan Derème repose avec la famille Huc au cimetière de Saint-Pée-d’en-Haut à Oloron-Sainte-Marie. À proximité, dans le nouveau cimetière, c’est l’immense Jules Supervielle[8] qui doit nocturnement venir à sa rencontre pour discourir avec un des plus charmants poètes de ce temps ! ♦
____________________________
[1] Maurice Biret est né à Saint-Michel-Léparon, dans la maison où naquit Robert Tatin, l’auteur de Sylva Edobola.(La Double du Périgord, nouvelle édition, MARS-APS, imprimerie Delmas, Artigues-près-Bordeaux, 1980). Maurice Biret, instituteur retraité, est passionné d’histoire locale, il a fait paraître de nombreux articles sur l’histoire de la Double dans les bulletins de la Société Historique et Archéologique du Périgord (SHAP), du Cercle d’Histoire et de la Généalogie du Périgord (CHGP) et du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Coutras (GRAHC). Ses ouvrages : Trigant-Gautier, un maire protestant à La Roche-Chalais (1804-1808) (Sa vie, son œuvre : l’église Saint-Napoléon), Neuvic, Les Livres de l’Îlot, 2013 ; François Viault savant doublaud méconnu. (Maurice Biret, 2012) ; avec André Bernard, Manzac-sur-Vern au fil des siècles, (Maurice Biret, 2003) ; Quatre Paroisses : une Commune Saint-Michel-Lecluse-Et-Leparon Terre de Frontières (Maurice Biret, 2000).
[2] Maurice, Stanislas, Auguste Martin du Gard (1896-1970), écrivain et journaliste, fondateur et directeur des Nouvelles littéraires (1923-1936) est le cousin germain du romancier Roger Martin du Gard (1881-1958).
[3] Tristan Derème, de son véritable nom Philippe Huc (1889-1941) poète français, connu également sous les pseudonymes de Théodore Decalandre et de Philippe Raubert. Il est le fondateur de l’École fantaisiste avec Francis Carco, Paul-Jean Toulet et Robert de la Vaissière. Auteur de nombreux recueils de poèmes souvent humoristiques : Quelques vers de Feu M. Decalandre (Tarbes, Chez Lesbordes, 1921), La Bride et le cheval ou Le souvenir de Jean-Marc Bernard (Tarbes, 1925) ; aux Éditions Émile-Paul Frères (Paris) : La Verdure Dorée (poèmes, 1925), L’Enlèvement sans clair de lune (1925), Le Zodiaque (poèmes, 1927), Poèmes des Colombes (1929), Patachou petit garçon (1929), Les compliments en vers de Patachou (poèmes, 1931) ; chez Bernard Grasset, Le Violon des muses (1935), L’Escargot bleu (1936), La Tortue indigo (1937), L’Onagre orangé (1939), La Libellule violette (1942) ; chez Édouard Aubanel, Tourments Caprices et Délices ou Les Poètes et les Mots ((1941).
[4] Maurice Martin du Gard, Les Mémorables, Paris, Gallimard, 1999, p. 165-166.
[5] Maurice Martin du Gard, Les Mémorables, Paris, Gallimard, 1999, p. 166.
[6] Maurice Martin du Gard, Les Mémorables, Paris, Gallimard, 1999, p. 166.
[7] Charles Derennes (1882-1930), poète, écrivain.
[8] Jules Supervielle (1884-1960), poète et écrivain.
Vendredi 8 mars 2019
Journée Internationale de lutte pour les droits des femmes.
France Musique met à l’honneur des compositrices qui furent quasiment toutes, épouses de compositeurs ou non, souvent dépréciées et combattues dans leur milieu familial comme par l’ordre social, y compris par la sphère musicale généralement éminemment machiste.
Nous avons entendu des pièces de noms qui ne sont pas inconnus : Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Germaine Tailleferre, et de quelques autres moins ou pas du tout : Rita Strohl, Ethel Smyth, Cécile Chaminade, Emilie Mayer, Camille Pepin… Roselyne Bachelot nous avait auparavant entretenue d’une compositrice suisse totalement inconnue pour moi, Caroline Boissier-Butini !
Notre ignorance est totale et ces oubliées auxquelles s’ajoutent beaucoup d’autres démontre bien un ostracisme constant et pernicieux.
Personnellement j’ajouterais volontiers les noms de Lili Boulanger, Marguerite Canal, Jeanne Leleu, Elsa Barraine, Yvonne Desportes, Odette Gartenlaub, Adrienne Clostre… toutes Premier Grand Prix de Rome de musique et dont les partitions sont peu fréquentées. Cette liste est très incomplète au regard des créatrices, ne serait-ce qu’en France ! Je ne voudrais pas oublier notre amie Florentine Mulsant qui possède tous les dons qui pourraient faire s’enorgueillir un homme compositeur.
Jean Chalon évoque dans son Journal d’un arbre, la figure aussi célèbre que remisée de Colette, loin d’être la facilité qu’on lui reproche : « contrairement à la légende, Colette n’est pas un auteur facile. Plusieurs lectures sont nécessaires pour pénétrer dans son monde qui se donne les apparences du quotidien mais vous entraîne beaucoup plus loin. Il m’aura fallu presque un demi-siècle de lectures assidues pour m’en rendre compte. Colette, Racine, Balzac et certaines pages de Proust me donnent parfois l’impression de boire un vin d’azur et de connaître enfin la griserie des cimes, une divine ivresse, celle que doivent éprouver les alpinistes parvenant au sommet des Himalayas[1]. »
Mais au-delà de celles qui peignent (et magnifiquement comme Berthe Morisot, Eva Gonzales, Mary Cassatt, Frida Kahlo…), qui composent, écrivent, il y a celles si nombreuses qui élèvent leurs enfants, travaillent dans des métiers difficiles ou exigeants et finalement les femmes de ma famille qui étaient dix heures par jour aux champs, tout en assurant dans le fracas et les deuils la survie d’une métairie ou d’une ferme pour que vivent ceux qui allaient partir lors de la prochaine guerre.
Un homme qui n’a pas de respect pour ces femmes-là, est comme ces petits employeurs parvenus qui insultent et abusent de leurs salariés.
Que les hommes n’installent pas dans leur maison le système d’exploitation du capitalisme et de ses dérives criminelles.
C’est une injure de dire que le droit des femmes progresse. Sans un crétinisme religieux, de caste, jamais cette longue reconquête n’aurait dû être et démontre explicitement une domination honteuse. ♦
___________________
[1] Jean Chalon, Journal d’un arbre, 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 60.
Jeudi 7 mars 2019
Une bonne et belle âme m’avait offert un cadeau précieux en février 2011. L’ouvrage intitulé Cinq méditations sur la beauté de François Cheng aura été un des livres majeurs que j’ai eus entre mes mains.
Déjà définissait-il dans sa « Première méditation » une manière d’être qu’il me plait à suivre : « Une seule règle me guide : ne rien négliger de ce que la vie comporte ; ne jamais se dispenser d’écouter les autres et de penser par soi-même. »
 |
||
Le numéro 3608 de Télérama, du 9 au 15 mars 2019, publie un entretien de Marine Landrot avec le poète, Pourquoi les arbres poussent-ils vers le haut ?
À 90 ans, il nous donne une leçon de vie, de sagesse, toute de discrétion.

Son dernier recueil publié, Enfin le royaume, se clos sur ces vers :
Ne quémande rien. N’attends pas
D’être un jour payé de retour
Ce que tu donnes trace une voie
te menant plus loin que tes pas[1].
Accueil de ce qui advient surprenant pour cet homme qui entre dans le grand âge. Ce n’est pas une volonté de paraître dans le coup, de vouloir rester de ce temps, lorsqu’il affirme être « attaché au double sens du mot ‟neuf” en français. À chaque seconde de mon existence, j’ai eu l’impression de faire peau neuve. »
Comme l’exposait souvent Krishnamurti il existe une manière de s’extirper des cendres de la pensée, de la mémoire et d’être neuf chaque jour à ce que nous offre la vie.
Dans cet entretien il retrace ses débuts à Paris en 1949, particulièrement difficiles avec déjà la barrière de la langue. Ses errements à Montparnasse à la fin de sa période glorieuse rappellent la description savoureuse de Léon-Paul Fargue dans son Piéton de Paris (voir ce journal à la date du 1er mars 2019) : « Je traînais dans des cafés à Montparnasse, parmi des Argentins, des Autrichiens, des Hongrois, des Italiens. Mais je n’avais pas d’ami français. L’exercice oral m’a beaucoup manqué[2]. ».
L’art de la poésie est d’une exigence absolue, elle n’est pas le poétique que sans doute nous pratiquons parfois. C’est comme peindre, créer, cela demande l’épure : « La poésie est la quintessence d’une vision, incarnée par la quintessence du verbe. Cela exige, de la part du poète, un dépouillement, une ascèse, un combat sans merci avec l’ange. Le poétique est le contraire de la poésie…[3] »
François Cheng a publié son premier livre, intitulé Vide et plein, à 50 ans. On peut comprendre son exigence et même sa dureté avec lui-même : « J’ai donc une forte conscience du temps perdu, qui pousse mon cerveau à fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre[4]. » Sa jeunesse comme celle de beaucoup d’entre-nous fut plus ou moins agitée, instable et lui a fait perdre de précieuses années. « J’ai été souvent blessé et j’ai moi-même blessé de nombreuses personnes, ce qui m’a donné beaucoup de remords. J’en ressens un grand tourment personnel, mais je suis aussi travaillé par la souffrance générale qui mine notre société. Aujourd’hui, il n’y a plus jamais de repos en moi[5]. »
Le paragraphe final intitulé Jeunesse montre que François Cheng voudrait partager ses expériences indicibles, sa manière à lui d’exprimer à la jeunesse fraternité et tendresse. Désir donc d’accompagner les jeunes générations sur un chemin qui sera probablement semé d’épreuves. L’ouvrage est commencé, si le temps qui reste lui permet de l’achever, ce sera son testament.
Nonobstant, il n’attend pas la fin, mais demeure tendu vers ce qu’il nomme « l’ouvert » : ouverture au monde, ouverture aux autres. Il existe une forme de jeunesse pérenne, inaltérable. François Cheng la possède et nous en offre le partage. ♦
_________________
[1] Entretien de François Cheng avec Marine Landrot, Télérama n°3608, p. 32.
[2] Ibid., p. 32.
[3] Ibid., p. 32.
[4] Ibid., p. 33.
[5] Ibid., p. 33.
Mercredi 6 mars 2019
Jean Chalon débutait l’année 1999 par la lecture des Mémoires de Francis Jammes. Il note en son Journal : « Ce pauvre Jammes est bien oublié aujourd’hui, alors qu’il était l’un des dieux de son époque[1]… »
Yourcenar conseillait à Chalon fasciné par la Belle Époque de n’en pas devenir le forçat. Je suis moi-même tellement nostalgique des arts de cette période, et il me semble que les écrivains de ce temps savaient écrire.
Chalon écrit quelques lignes plus loin : « Un vent violent vient de se lever, qui secoue l’arbre de la cour[2]… ». Ici, il est sorti de nuit et ne s’est pas encore lassé de souffler !
Hier, Olivier était au jardin. Les cinq lauriers roses ont trouvé un emplacement en pleine terre. Je leur souhaite d’y trouver plus d’expansion que dans ces conteneurs sclérosants qui furent leurs prisons des années durant. Marie-Annick me rappelait le merveilleux laurier-rose admiré et photographié, en 2018, contre une des belles demeures au cœur du village de Saint-Avit-Sénieur.

|
||
 |
Le laurier rose du village de Saint-Avit-Sénieur (dordogne) © Clichés Jean Alain Joubert
Francis Jammes : désuet, démodé, j’accepte tous ces qualificatifs, mais d’un charme suranné, difficilement égalable, dans ces quatrains libres extraits du poème intitulé Le vieux village… dédié à André Gide :
Le vieux village était rempli de roses
et je marchais dans la grande chaleur
et puis ensuite dans la grande froideur
de vieux chemins où les feuilles s’endorment.
Puis je longeai un mur long et usé ;
c’était un parc où étaient de grands arbres,
et je sentis une odeur du passé,
dans les grands arbres et dans les roses blanches…
Personne ne devait l’habiter plus…
Dans ce grand parc, sans doute on avait lu…
Et maintenant, comme s’il avait plu,
les ébéniers luisaient au soleil cru.
Ah ! des enfants des autrefois, sans doute,
s’amusèrent dans ce parc si ombreux…
On avait fait venir des plantes rouges
des pays loin, aux fruits très dangereux.
[…]
Mais à présent où est cette famille ?
A-t-elle existé ? A-t-elle existé ?
Il n’y a plus que des feuilles qui luisent,
aux arbres drôles, comme empoisonnés…
Et tout s’endort dans la grande chaleur…
Les noyers noirs pleins de grande froideur…
Personne là n’habite plus…
Les ébéniers luisent au soleil cru[3]
Certes l’univers poétique de Jammes appartient à son époque, ce qui ne lui retire pas, me semble-t-il, une saveur qui lui est propre et qui nous interpelle aujourd’hui encore, malgré un siècle écoulé. Ses œuvres ne connaissent cependant aucune réédition alors que François Mauriac, dans le Figaro Littéraire du 14 septembre 1951 y invitait : « Hasparren a vu l’agonie et la mort du poète ; Hasparren garde sa tombe. Nous ne la laisserons pas recouvrir par les ronces de l’oubli. » ♦
_____________________________
[1] Jean Chalon, Journal d’un arbre 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 58.
[2] Jean Chalon, Journal d’un arbre 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 59.
[3] Francis Jammes, Choix de Poèmes, « Le vieux village », Paris, Mercure de France, 1941, p. 52
Lundi 4 mars 2019
« Chaque matin était une invitation à faire en sorte que ma vie soit d’une simplicité, et je puis dire aussi d’une innocence, égale à la nature elle-même[1]. »
Premier retour au jardin de l’année pour la taille de printemps dans l’après-midi de ce dimanche venté, mais ensoleillé.
Autre victoire que la reprise d’une marche d’une raisonnable durée : 45 minutes.
En fin de journée, lors de son appel hebdomadaire, Lionel me récitait avec une parfaite fluidité deux poèmes, La Montagne de Ferrat (exode de la paysannerie vers la ville) et l’hommage d’Aragon à Robert Desnos alors que nous évoquions le poète ainsi que Jean Cocteau, Philippe Soupault et André Breton, pape des Surréalistes.
Je pense à toi Desnos qui partis de Compiègne
Comme un soir en dormant tu nous en fis récit
Accomplir jusqu’au bout ta propre prophétie
Là-bas où le destin de notre siècle saigne[2]
Nous avions auparavant évoqué la double disparition, en novembre 1998, de Jean Marais et d’Edwige Feuillère. Le premier avait confié à Jean Chalon lors d’un déjeuner en tête à tête à la Coupole, malgré une brillante carrière de soixante-cinq années, « J’ai raté ma carrière, j’aurais dû me contenter d’être le serviteur de Cocteau[3]. » Le 18 novembre Chalon note : « Edwige Feuillère vient de mourir. On dirait qu’elle n’a pas survécu à la mort de Jean Marais qui fut son partenaire dans L’Aigle à deux têtes. On disait aussi qu’elle aurait rempli les salles rien qu’en lisant l’annuaire du téléphone. Comme la voix de Lola Florès, la sienne était particulière et inimitable. Feuillère avait de délectables intonations…[4] »
Deux vieillards d’une grande beauté, celle de la noblesse d’âme.
Quelle conversation avec Jean-Pierre au sujet de son épouse licenciée pour inaptitude après avoir subi humiliations, discrimination et exploitation ! Vous me direz, sans doute comme tant de salariés. Ce n’est pas toujours vrai, mais selon mon expérience bien trop commun. C’est révoltant et montre assez la nature humaine qui développe ces cancers de l’âme chez de petits parvenus qui deviennent les prédateurs de leurs semblables. Et ce afin de satisfaire cette soif inextinguible de fric, de la puissance toute illusoire. Rien n’est évincé de ce processus d’enrichissement : l’exploitation des humains clandestine ou déclarée, heures non payés, règles d’hygiène bafouées, pressions morales indécentes et répétées.
Triste, triste monde ! ♦
_______________________
[1] Henry David Thoreau, La moelle de la vie, 500 aphorismes, Mille et Une Nuits, n° 500, 2009, p. 79
[2] Louis Aragon, Complainte de Robert le diable.
[3] Jean Chalon, Journal d’un arbre, 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 50-51.
[4] Jean Chalon, Journal d’un arbre, 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 50-51.[1]
Dimanche 3 mars 2019
On ne peut qu’être impressionné pas le corpus symphonique de Charles Tournemire (1870-1939) et en particulier par sa septième symphonie, Les danses de la vie, son opus 49. Univers que l’on peut rapprocher de celui de Gustav Mahler. Il n’existe pas beaucoup de symphonistes français de cette magistrale envergure. L’opus 51, huitième symphonie, Le triomphe de la mort, clos ce cycle.
Le 22 octobre 1998, Jean Chalon notait dans son Journal d’un arbre (1998-2001) : « Ce que j’aimerai dans la mort, c’est le silence, l’absence de paroles inutiles et de bruit. La mort aura le dernier mot[1]. » La trajectoire du bateau silencieux me convient idéalement.
Je me suis rendu hier matin sur le marché de Neuvic après une semaine d’absence due à cette grippe épuisante. La pharmacienne de Saint-Léon sur l’Isle a fini par me proposer Ergyphilus (lactobaciles et bifidobactéries) pour combattre l’effrayante fatigue qui à mon sens a plus été le fait de l’antibiotique Amoxicilline/Acide clavulanique avec le cancérigène excipient à effet notoire comme ils s’autorisent à l’annoncer : aspartam ! Dès la première prise du contre-poison intestinal une amélioration se fit sentir, confirmée par la seconde vers 16h00. Le crétinisme médicamenteux n’a pas de limite.
En début d’après-midi Jean Michel m’a entassé sous les bâches deux stères de cœur de chêne pour les trois mois qui viennent. Effort physique que je n’aurais pu soutenir contrairement au précédent arrivage.
Ils arrivaient d’un séjour dans le Massif Central. Voici Guilhem, Colline et leurs parents Nathalie et Laurent, mes neveux et petits-neveux. Un moment tendre et rafraîchissant. Colline a réalisé de beaux dessins en direct et Guilhem, qui aura trois ans en juillet, m’a offert, avec son adorable sourire, sa jolie carte de trois chiots en relief ! Elle trône sur la cheminée.
« Je rêve d’un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisserait croître les forêts ![2] » ♦
______________________
[1] Jean Chalon, Journal d’un arbre 1998-2001, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 47.
[2] Henry David Thoreau, La moelle de la vie, 500 aphorismes, Mille et Une Nuits, n° 500, 2009, p. 39
Samedi 2 mars 2019
« Renard[1] fréquentait ses contemporains dont il dénonçait les travers avec exaspération et jubilation à la fois. Thoreau[2] n’aime que la compagnie des arbres et des animaux. Il passe deux ans dans une cabane, au bord de l’étang de Walden[3]. »
Alternatives considérables devant l’absurdité des sociétés, des comportements humains.
Ainsi Jules Renard confie à son Journal : « Mais pourquoi Claudel écrit-il d’une façon Tête d’Or, La Ville, et d’une autre ses compositions pour obtenir le poste de vice-consul à New York ? L’artiste doit être le même quand il prie et quand il mange[4]. »
Tandis que Henry David Thoreau fusionne, en heureux misanthrope, avec la nature : « Soir délicieux, où le corps entier n’est plus qu’un sens, et par tous les pores absorbe le délice. Je vais et viens avec une étrange liberté dans la Nature, devenu partie d’elle-même[5]. » Cette fusion historique avec la nature se retrouve dans d’autres textes comme dans Balade d’hiver, couleurs d’automne (Mille et Une Nuits n°529).
La synthèse nous est offerte par Jules Renard : « Il faut aimer la nature et les hommes malgré la boue[6]. »
 |
Baptême de Patrick Martinet, août 1977, de gauche à droite, Christiane Rivière, Andrée Girardeau, Paul Rivière
Visite hier matin de ma cousine Pierrette Martinet et de son époux Jean-Pierre. Pierrette m’apporte des documents et des photos dont celles du baptême de son fils Patrick, en août 1977, avec Andrée et son frère Paul, père de Pierrette. Scan et travail sur le brunissement de ces photos précieuses où je retrouve ceux que j’aimais (excellents cousins). Paul, beau gars comme le montre la photo, père de sept enfants, y figure aussi sa jolie épouse Christiane. En 1985, moins de dix ans plus tard, Paul est parti, épuisé par la maladie avant même sa retraite ; Christiane l’a rejoint en 2015 après avoir vu grandir ses petits enfants et ses arrières petites-filles.
« Et les heures où, se sentant un peu serin, on aime les oiseaux[7]. » Pour taquiner Jules Renard, j’ose croire que nous le pouvons mieux encore en étant serein et en paix. ♦
__________________________
[1] Jules Renard (1864-1910), écrivain et auteur dramatique, L’Écornifleur (1892), Poil de Carotte (1894), Histoires naturelles (1894), Journal 1887-1910.
[2] Henry David Thoreau (1817-1862), philosophe, naturaliste et poète américain, Walden ou la vie des bois, Journal, Ballades, La Désobéissance civile, De la marche, La Vie sans principe, Le Paradis à reconquérir, Résister, de L’Esclavage (La plupart de ces titres sont disponibles dans la collection Mille et Une Nuits).
[3] Jean Chalon, Journal d’un arbre (1998-2001), Paris, Librairie Arthème Fayard, 2003, p. 12.
[4] Jules Renard, Ses Oeuvres, Journal 1893-1898, 16 mars 1893, Bellanger. Édition du Kindle.
[5] Thoreau, Henry David. Walden ou la vie dans les bois, L’Imaginaire, chapitre « Solitude » (p. 110). République des Lettres. Édition du Kindle.
[6] Jules Renard, Ses Œuvres, Journal 1893-1898, 27 mars 1893. Bellanger. Édition du Kindle.
[7] Jules Renard, Ses Œuvres, Journal 1893-1898, 4 mai 1893. Bellanger, Édition du Kindle.
Vendredi 1er mars 2019
Regarder Les heures chaudes de Montparnasse, est comme un éblouissement devant tant de fertilité créative, de génies réunis dans la Ville Lumière, Paris, artistes s’en venant de l’Oural au Mississipi. Ces documentaires passionnants recèlent les témoignages précieux d’artistes au talent parfois plus discret, tel celui de la sculptrice Chana Orloff (1888-1968) ; artistes témoignant dans leurs vieux jours de la magnificence explosive du printemps de Montparnasse.
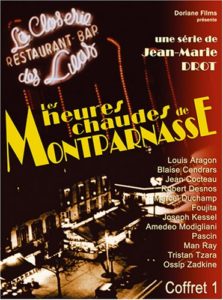 |
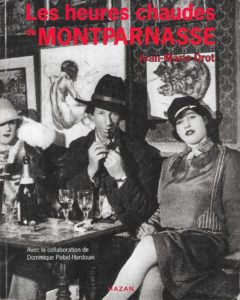 |
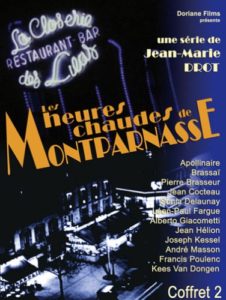 |
||
Le temps ayant accompli son œuvre de décantation, Jean-Marie Drot pouvait en extraire la substantifique moelle, l’élixir d’un temps désormais consacré. Mais avant épuration, cette félicité créatrice apparaissait plus ambiguë aux yeux des contemporains habitués aux pires caricatures comme à la fulgurance de génies dont on n’avait sans doute pas encore l’assurance. Le discernement entre transgression, génie, folie et charlatanerie n’était pas aussi aisé. Au temps de la genèse de cette orgie de nombrilisme, de ce grouillement de pseudo-artistes comme de génies, il y fallait l’esprit d’un Léon-Paul Fargue, au vocabulaire volcanique, pour nous faire appréhender les arcanes de ce qui devint une légende :
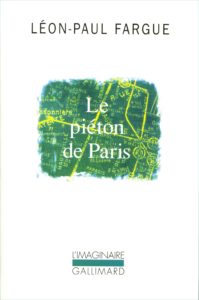 |
« Il y a deux Montparnasse. Celui qui se livre sans discrétion, sans retenue, celui de la rue. Celui du carrefour Montparnasse-Raspail, où s’étale tout le déchet – et parfois l’élite – de l’Europe ‟intellectuelle et artistique”. Tel poète obscur, tel peintre qui veut réussir à Bucarest ou à Séville, doit nécessairement, dans l’état actuel du Vieux Continent, avoir fait un peu de service militaire à la Rotonde ou à la Coupole, deux académies de trottoir où s’enseignent la vie de bohème, le mépris du bourgeois, l’humour et la soulographie. La crise a porté un assez sérieux coup à Montparnasse. Mais nous y connûmes une agitation qui tenait du déluge, du grand siècle et de la fin du monde. Des taxis ont véhiculé des nuits durant rue Delambre, rue Vavin ou rue Campagne-Première, des Lithuaniens, faiseurs de vers hirsutes, des Chiliens en chandail qui peignaient avec des fourchettes à escargots, des nègres agrégés, des philosophes abyssins, des réfugiés russes experts dans l’art d’inventer des soporifiques, des loteries ou des maisons de couture. Cette atmosphère de maisons de fous n’était pas toute déplaisante.[1] » ♦
______________________
[1] Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris, Paris, L’imaginaire Gallimard, 2007, p. 140s.
Jeudi 28 février 2019
La grippe s’éloigne alors que le temps revient à une plus raisonnable conjoncture. Voilà qui sera moins agréable pour débuter la taille de printemps. Je viens d’allumer l’insert pour assainir l’air plus humide.
La tragédie de Marcel Rivière et de sa descendance n’aura pas manqué de me troubler, ayant toujours eu une profonde aversion pour l’injustice. Les rares bruits familiaux, remplaçant une honnête transmission des éléments du drame, font que ce ‟suicide” est suspecté, peut-être indûment, d’avoir été le résultat d’un pari malheureux, d’une bagarre, d’un règlement de compte et en définitive d’un meurtre dont un petit notable de Sorges aura peut-être été tranquillement disculpé, laissant la misère à la misère, se lavant les mains du sang d’un autre.
Il faut rejoindre Sénèque pour retrouver la sérénité qu’appelle la vieillesse : « Je ne t’invite pas à un repos stérile et apathique, ni à noyer dans le sommeil et les plaisirs chers à la plus grande masse des gens ce qu’il y a en toi de vitalité naturelle ; ce n’est pas cela, se reposer : tu découvriras, plus vastes que toutes celles auxquelles tu as pu consacrer ton énergie, des tâches que tu pourras accomplir dans l’isolement et la tranquillité[1]. »
 |
| Dr. Vandana Shiva©Dr. Vandana Shiva |
Vandana Shiva, militante écologiste, interroge sur l’incohérence qui fait que des entreprises vendant des médicaments soient les mêmes que celles qui produisent des pesticides. Elle est en guerre contre « le cartel du poison », dénonçant une « logique meurtrière ». Elle nous appelle toutes et tous à nous lever pour notre liberté, notre santé et notre planète :
« Nous devons nous libérer du cartel du poison pour la liberté et la vie sur Terre, pour la liberté de tous les peuples, pour se libérer des maladies, et pour se libérer d’une nouvelle forme d’esclavagisme. […] On a entre nos mains le pouvoir de soigner la Terre, on a entre nos mains le pouvoir de soigner nos corps, et de réparer nos démocraties en souffrance en enlevant le pouvoir au cartel du poison. » ♦
__________________
[1] Sénèque, Sur la brièveté de la vie, XVIII, Éditions Mille et une nuits, vol. 18, 1994, p. 49.
Mercredi 27 février 2019
Affronter la vérité ou jouer à l’autruche ?
Dans les familles le goût du secret, de la dissimulation est souvent conséquent. Rarement sont énoncées clairement les situations faisant exception à la généralité d’une vie ordinaire. On ne voit pas là de grande différence avec les drames cachés qui déchirent les familles bourgeoises. Le secret de la confession catholique y aura, me semble-t-il, contribué. Aujourd’hui où le confesseur est mis à jour, confondu, on comprend tout le rôle dominateur du silence.
Ces inconforts sournois, parfois cruels peuvent s’étendre sur plusieurs générations. Ils sont générateurs de troubles psychologiques et de souffrances que l’on ne partage pas volontiers. J’ai tellement entendu les plaintes de mon père jusqu’à la veille de son suicide concernant ses incertitudes génitrices et la violence de son sentiment d’injustice de n’être fils de personne que moi-même en ai ressenti un sentiment d’orphelinat, d’incomplétude.
Pour aller victorieusement de l’avant, il faut conquérir son passé, le comprendre, l’admettre et l’assumer. Ayant suivi une psychanalyse au long court, je me sens autorisé à dire combien cette thérapie des profondeurs, infiniment patiente, est, en définitive, libératrice. Si elle ne résout pas tout, elle nous donne pourvoir sur nos interrogations, nos incertitudes, nos peurs.
Marcel Rivière, né en août 1891 était l’aîné de la fratrie, âgé de 6 ans lorsque naquit le second enfant, ma grand-mère Clotilde en mars 1897, et de 8 ans lorsque Mathilde parut en 1899. Ses trois autres frères, Gaston, Henri et André vinrent au monde sur les marches du siècle nouveau. Nous les aimions tous et Marcel ne saurait faire exception à la règle. Ma mère confirmait qu’il était aussi gentil que ses frères.
Il était marié à une parisienne Georgette Agnès Renault (1895-1956) que probablement nous voyons à ses côtés sur la photo de mariage de son frère Henri et où figurent les parents Rivière (Jean et Françoise) avec tous leurs enfants vivants : Marcel, Clotilde, Gaston, Henri et André. Mathilde ayant succombé à la typhoïde, sans doute en 1913.
Au cours des années trente, Georgette avait fait, semble-t-il, un voyage en train depuis Paris pour abandonner ses trois enfants devant la mairie d’Agonac et reprendre tout aussitôt le train pour Paris. Marcel se retrouvait donc seul avec trois enfants en bas âge : Andrée, Arlette et Paul, alors qu’il était ouvrier agricole. Au moment de sa mort il travaillait à Sorges.
Marie-Annick fut hier l’heureuse intermédiaire par qui nous connûmes, en quelques échanges avec les services de l’état civil de la mairie de Périgueux, toutes les informations sur la disparition de Marcel Rivière, disparition qualifiée de “suicide” dans L’Avenir de la Dordogne du 12 décembre 1937. Il mourrait à l’hôpital de Périgueux[1] situé alors 6 rue Wilson à une heure du matin, le 5 décembre 1937, à l’âge de 46 ans.
Sa sépulture reste inconnue. L’ouverture de registre pour les fosses communes des cimetières date de 1939. Seules des indiscrétions familiales susurrées peuvent nous laisser penser qu’il fut mis dans la fosse commune du cimetière du Nord. Le suicide était alors rejeté par l’église. Il n’y eut donc aucune cérémonie religieuse et probablement pas de sacrement d’extrême-onction. On peut supposer qu’il fut donc également rejeté par son père et tenu à l’écart du caveau familial d’Eyvirat… sauf secret bien gardé.
On ne peut imaginer plus illégitime violence vis-à-vis de cet homme que tout abandonnait et dont les enfants eurent cruellement à souffrir de sa disparition. Andrée fut prise en charge par son oncle Parcellier (frère de sa grand-mère), Arlette et Paul par Henri et Marie Rivière à Saigne-Bœuf. La vie dure et âpre commença tôt pour eux. ♦
_______________________
[1] Il s’agit de l’hôpital général de la Manufacture qui ouvrait sur l’actuelle rue du Président Wilson et occupait une partie de l’esplanade du théâtre et des immeubles qui la borde. Ancienne filature de coton, l’hôpital fut inauguré en 1669. Les bâtiments furent démolis de 1955 à 1957 lors du percement de l’ancienne avenue d’Aquitaine, après que la ville soit redevenue propriétaire des lieux. Guy Penaud, Le Grand Livre de Périgueux, La Lauze (Périgueux), 2003, p. 318-319.
Mardi 26 février 2019
« Newman[1] croyait que, si les champs et le ciel nous donnent cette impression de pureté et d’innocence, c’est que la nature fut créée avant l’homme pécheur et qu’elle n’a pas de part au crime d’Adam. Mais depuis le temps que l’homme vit de la terre, s’y couche pour dormir ou pour pleurer, jusqu’à ce qu’il s’y abîme et retourne en poussière, la nature est devenue humaine ; elle est faite de la cendre du péché humain et ne ressemble en rien à ce qu’elle était lorsqu’elle naquit dans la pensée de Dieu. Son seul aspect trahit d’abord les besoins de l’homme : ces blés et cette vigne, c’est notre faim et notre soif, et plus que notre soif : notre inguérissable désir d’ivresse, de sommeil et d’oubli. Devant les maisons les plus pauvres, fleurit la part du rêve : ce pied de géranium, cette verveine et les résédas le long du mur[2]. »
L’Anti-Média publiait cette réflexion : « Certaines personnes sont tellement pauvres que tout ce qu’elles possèdent, c’est de l’argent. » Fait totalement défaut alors cette part du rêve à laquelle fait référence François Mauriac.
Retour hier sur les voies du stade de Saint-Astier pour une demi-heure de soleil. Le jeune père en rouge poussait sur la passerelle ses jumeaux pour ensuite les déposer à jouer sur la pelouse du terrain de rugby. Ils incarnaient le printemps conquérant et moi la décrépitude combative.
Au retour, une entreprise de travaux publics du Pays Basque creusait dans ma haie de lauriers palmes un trou pour enterrer à 1,70 mètre de profondeur, un poteau neuf devant supporter les lignes électriques et téléphoniques. La tempête qui avait couché le poteau initial date de septembre 2016. La nouvelle organisation des différents services qui remplacent EDF est d’une telle complexité que j’aurais vu d’abord trois fois les services d’EDF, puis suite à un courrier adressé par le maire de Montrem au président du Syndicat d’électrification de la Dordogne, au moins deux visites d’Enedis, venu prendre des photos, concevoir un premier plan surréaliste qui prévoyait l’implantation chez un voisin… ensuite un passage vendredi dernier du responsable de l’entreprise privée afin de marquer au sol les passages de l’eau… sans qu’il se soit présenté chez moi pour me prévenir de l’imminence des travaux. En raison de la grippe je n’étais pas sorti de chez moi depuis ma visite chez le médecin à Périgueux mercredi en fin de matinée. Le poteau attendu n’ayant pas été livré comme prévu, les deux manœuvres sont repartis chercher avec un camion d’une longueur impressionnante un poteau dans leurs réserves à Périgueux ! Si bien que ce chantier aura immobilisé quatre salariés avec un matériel fou, toute un après-midi. Autrefois EDF venait deux fois, la première pour constater les dégâts, la seconde avec son matériel, pour retirer le poteau défectueux et le remplacer. Mon poteau si longuement attendu aura sans doute coûté trois fois son prix réel. Le libéralisme nous ruine. ♦
_______________________
[1] John Henry Newman (1801-1890), prêtre et théologien anglican, converti au catholicisme, élevé au cardinalat en 1873.
[2] François Mauriac, « Grêle », Journal Mémoires politiques, Bouquins Robert Laffont, 2008, p. 25.
Lundi 25 février 2019
Passée la semaine des anniversaires de deuils cumulés. Elle flambait sous un soleil inépuisablement printanier, mais la grippe dont je fis l’expérience ne me laissa que peu d’enthousiasme et aucune énergie.
Ce matin, le soleil s’impose toujours me donnant le désir de reprendre mes marches quotidiennes tellement salutaires. Un petit rien qui vaut tout.
Reprendre encore l’habitude d’un journal, assorties de brèves lectures qui ne manquent jamais d’alimenter mes réflexions est, en douce, une invite de Lionel. Il est toujours possible de remplir des pages pour un usage incertain, de peu d’intérêt.
On se démarque difficilement de ce qui va inéluctablement vers sa fin avec une tranquille indifférence.
Georges Rouault n’est pas un de nos peintres les plus fêtés ou reconnus, il laisse cependant une trace irréversible dans l’histoire de l’art. J’aime lorsqu’il dit : « Un mot de tendresse, vrai et sensible, donné à Michel-Ange vieux et aveugle, à Beethoven sourd, à Rembrandt ruiné, vaudra à jamais les pouvoirs fugitifs et les honneurs vantés du monde[1]. » ♦
________________________
[1] Georges Rouault, Sur l’art et sur la vie, Gallimard, folio essais, 2008, p. 48. (Éditions Denoël/Gonthier, 1971).
Dimanche 24 février 2019
À l’invitation de Lionel, je vais publier sur mon site, mon journal de 2005, Frère des oiseaux. Recherchant pour compléter un texte laissé inachevé de ce Journal de 2005, une appréciation de Louis Émié sur Francis Jammes publiée initialement, en 1936, dans ‟La Petite Gironde”, reprise dans un petit ouvrage édité par l’association Francis Jammes d’Orthez sur les différentes résidences du poète, je fouille étagères et box de la maison, en vain pour l’instant !
Aujourd’hui, à Brantôme ma cousine Jackie fête les cinquante ans de sa fille aînée Laetitia qui n’en parait même pas quarante, entourée de sa petite-fille Manon, de sa seconde fille Sandrine et de Marion son autre petite petite-fille . Vie de labeur, construite et finalement heureuse. L’amour de sa vie, Jean-Pierre s’en est allé en 2013 et ce fut une grande épreuve, mais Jackie est mère de trois enfants superbes qui ont une descendance tout aussi florissante, alors il serait difficile de ne pas parler d’une vie accomplie.
Lorsque l’amour est au centre d’une vie, la lumière ne peut que se manifester. ♦
